Vous pouvez lire le billet sur le blog La Minute pour plus d'informations sur les RSS !
Canaux
5191 éléments (27 non lus) dans 55 canaux
 Dans la presse
(11 non lus)
Dans la presse
(11 non lus)
 Toile géomatique francophone
(16 non lus)
Toile géomatique francophone
(16 non lus)
 Toile géomatique francophone (12 non lus)
Toile géomatique francophone (12 non lus)
-
sur La mondialisation appréhendée à travers un indice de connectivité mondiale
Publié: 18 February 2025, 5:25pm CET
Source : Steven A. Altman & Caroline R. Bastian, DHL Global Connectedness Report 2024 : An In-Depth Analysis of the State of Globalization.
Récemment, une attention particulière a été portée à la question de savoir si la mondialisation progressait ou reculait à l’échelle mondiale. La plupart des entreprises et des pays interagissent avec quelques autres et non avec le monde entier. C’est pourquoi les mesures de la mondialisation au niveau national, en particulier celles qui concernent chaque pays et ses principaux partenaires dans les échanges internationaux, sont particulièrement importantes pour l’analyse économique et politique.
L’indice de connectivité mondiale DHL classe les pays en fonction de leurs échanges internationaux, de leurs capitaux, de leurs informations et de leurs flux de personnes. Il évalue ces flux selon deux dimensions : la profondeur (taille des flux internationaux par rapport à l’activité nationale) et l’ampleur (répartition des flux entre les pays d’origine et pays de destination). La connectivité mondiale reste à un niveau record, malgré les tensions et les incertitudes géopolitiques.
Flux globaux par région en 2022 (source : DHL Global Connectedness Report 2024)
L'étude conduite par la Stern School of Business de l’université de New York et la société de transport DHL fait ressortir 10 points clés concernant la mondialisation qui n'a jamais été aussi forte en dépit des tensions et incertitudes :
- La connectivité mondiale a atteint un niveau record en 2022. Elle est restée proche de ce niveau en 2023. La résilience et la croissance des flux internationaux d’échanges commerciaux, de capitaux, d’informations et de personnes face aux crises récentes vont à l'encontre de l’idée selon laquelle la mondialisation auarait fait marche arrière.
- Singapour est le pays le plus connecté au monde, suivi des Pays-Bas et de l’Irlande. Singapour a les flux internationaux les plus importants par rapport à l’activité nationale, tandis que les flux du Royaume-Uni sont les plus répartis dans le monde.
- Les liens entre les États-Unis et la Chine continuent de diminuer. Les parts des flux des deux pays impliquant l’autre ont diminué d’environ un quart depuis 2016. Le recul des échanges directs entre les États-Unis et la Chine s’est accéléré en 2023. Mais les États-Unis et la Chine sont toujours connectés par des flux plus importants que presque toutes les autres pays.
- La Russie et l’Europe se sont découplées, rompant des liens autrefois considérés comme essentiels pour les deux partenaires. Les échanges commerciaux de la Russie se sont éloignés des pays alignés sur l’Occident et les investissements étrangers en Russie se sont effondrés. Parmi les principales économies du G20, la Russie a connu en 2022 la plus forte baisse annuelle de connectivité mondiale jamais enregistrée.
- Les flux mondiaux ne montrent aucune division générale de l’économie mondiale entre les blocs géopolitiques rivaux. La part des échanges entre les blocs alignés sur les États-Unis et ceux alignés sur la Chine a augmenté pendant la pandémie de Covid-19, puis a diminué après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie. Si l’on exclut la Russie, elle est désormais revenue à peu près à son niveau d’avant la pandémie.
- La mondialisation des entreprises continue de progresser. Les entreprises réalisent une plus grande partie de leurs ventes à l’étranger et la valeur de leurs projets d’expansion internationale annoncés est à son plus haut niveau par rapport au PIB mondial depuis plus d’une décennie. La part transfrontalière des fusions et acquisitions reste stable, tout comme la part de la production mondiale que les entreprises produisent en dehors de leur pays d’origine.
- La mondialisation n’a pas cédé la place à la régionalisation. La plupart des flux internationaux se déroulent sur des distances stables voire plus longues, avec une part en baisse au sein des principales régions géographiques. Si l’on se concentre spécifiquement sur le commerce, seule l’Amérique du Nord affiche une tendance claire à la délocalisation.
- La mondialisation des flux d’informations a augmenté plus que tous les autres aspects de la mondialisation au cours des deux dernières décennies, mais les dernières données montrent que cette tendance stagne.
- Les tensions entre les États-Unis et la Chine ont pesé sur la collaboration internationale en matière de recherche, et de nombreux pays ont imposé des restrictions sur les flux internationaux de données.
- Le niveau absolu de mondialisation du monde reste limité ; les flux nationaux dépassent toujours de loin les flux internationaux. La profondeur actuelle de la connectivité mondiale n’est que de 25 % sur une échelle allant de 0 % (aucun flux ne traverse les frontières nationales) à 100 % (les frontières et la distance n’ont plus aucune importance).
Rapport et annexes à télécharger en pdf
Données à télécharger en xls
Outre les données récentes, l'intérêt de cette étude est de fournir des cartes par anamorphoses montrant chaque pays avec ses 10 principaux partenaires commerciaux. Avec le retour de Trump et de sa politique douanière, l'orientation de ces flux pourrait être en partie modifiée dans les années qui viennent. Le modèle de Bloomberg Economics sur les droits de douane proposés par Trump prévoit que les autres pays compenseront la majeure partie de leurs pertes commerciales avec les États-Unis simplement en échangeant davantage entre eux. Cela laisse entrevoir la possibilité que la mondialisation continue de bourdonner, mais sans les États-Unis en son centre (What's left of Globalization without the US ? Bloomberg)
Comparaison Etats-Unis et Chine (source : DHL Global Connectedness Report 2024)
Comparaison France et Royaume-Uni (source : DHL Global Connectedness Report 2024)
Pour compléter
« La mondialisation n’a jamais été aussi forte qu’en 2024 » (Le Grand Continent)
« Mondialisation : vers un capitalisme anti-libéral » (France Culture)
Articles connexes
Cartographie des pays ayant les États-Unis ou la Chine comme principal partenaire commercial (2001-2023)
Carte de l'influence mondiale de la Chine et des États-Unis
Mesurer le rayonnement des grandes puissances à travers leurs réseaux diplomatiques
Comment la Chine finance des méga-projets dans le monde
Les investissements de la Chine dans les secteurs de l'Intelligence artificielle et de la surveillance
Les pays bénéficiaires de l'aide des Etats-Unis depuis 1945
Les câbles sous-marins, enjeu majeur de la mondialisation de l’information
Entre maritimisation des échanges et mondialisation de l'information : de quoi l’incident de l'Ever-Given est-il le nom ?
La route maritime de la soie. Connectivités mondiales, nœuds régionaux, localités (ouvrage en open edition)
- La connectivité mondiale a atteint un niveau record en 2022. Elle est restée proche de ce niveau en 2023. La résilience et la croissance des flux internationaux d’échanges commerciaux, de capitaux, d’informations et de personnes face aux crises récentes vont à l'encontre de l’idée selon laquelle la mondialisation auarait fait marche arrière.
-
sur Déboguer des triggers SQL en cascade : une approche visuelle avec Matplotlib
Publié: 18 February 2025, 9:33am CET par Célia Prat
Dans cet article, je vais partager mon expérience de débogage à l’aide de Matplotlib, un outil de visualisation Python puissant et flexible.
-
sur Les évolutions de Python 3.9 à 3.13 : Typage
Publié: 18 February 2025, 8:57am CET par admin
Si on peut dire que la librairie standard Python est stable, on ne peut pas en dire autant de la partie typage qui est en pleine effervescence.
Pour mémoire, le typage en Python est optionnel, et c’est très bien pour les petits projets et les scripts. Dès que le projet prend de l’envergure, le typage des paramètres des fonctions aide à la rigueur et force à se poser les bonnes questions sur les flux de données dans le programme.
Version 3.9Dans la version 3.9 de Python, il y a une seule évolution dans le typage, mais qui va considérablement améliorer la lisibilité et simplifier le code dédié au typage : on peut désormais utiliser les types « built-ins » (list, disc…) pour déclarer notre typage.

class Foo: def add_items(self, items: list[str]) -> None: ...Je ne sais pas pour vous, mais pour moi ça réduit tellement le ticket d’entrée du typage que ça ne me dérangerais pas de l’intégrer même dans des petits scripts.
Version 3.10Depuis la version 3.10 de Python, on peut désormais utiliser l’opérateur | pour déclarer des unions de types (la fonction accepte plusieurs types différents, voir les rendre optionnels) :
class Foo: def set_color(self, color: str|Color|None) -> None: ... def get_color(self) -> Color|None: ...Un gros effort a également été fait dans cette version pour proposer une généricité dans le typage. Par exemple quand on défini un décorateur, on ne connaît pas toujours à l’avance le type de la fonction décorée. Dorénavant, on peut utiliser ParamSpec pour dire que c’est un type qu’on ne connaît pas.
Un peu de clarté a aussi été apportée avec l’ajout de TypeAlias qui permet de donner un nom explicite à un type complexe.
StrCache: TypeAlias = 'Cache[str]'Pour créer des petites fonctions qui vérifient le type (is_bool, is_string, etc…), les TypeGuards ont été introduits. Les TypeGuards sont utilisés pour une pratique assez complexe appelée rétrécissement de type. Cette dernière est utilisée pour les fonctions qui acceptent des variables d’entrée avec plusieurs types possibles. TypeGuard permet alors de mettre en place une vérification de type sur les variables d’entrée de la fonction.
Version 3.11 L’utilisation des TypeGuards n’est pas très simple, je vous invite donc à aller regarder la documentation Python plus en détails si cela vous intéresse.
L’utilisation des TypeGuards n’est pas très simple, je vous invite donc à aller regarder la documentation Python plus en détails si cela vous intéresse. Toujours dans les ajouts complexes, la version 3.11 a introduit des Variadic générique pour gérer des ensembles d’éléments avec une taille fixes (un tenseur avec une taille fixée par exemple).
Un générique permet de préserver un type entre l’entrée et la sortie d’une fonction. Par exemple, si l’on prend la fonction de copie d’une variable, celle-ci prend une variable en entrée et cette dernière peut être de tout type, on la typera donc Any. Comme la fonction retourne une copie de la variable d’entrée, le type de retour de la fonction sera le même que celui de la variable en entrée (Any).
Le problème est qu’avec Any, on a aucun moyen de vérifier que les types de l’entrée et de la sortie sont les mêmes, et c’est ici que le générique entre en jeu.
def copy_of_1(value: Any) -> Any: # Le Any d'entrée et # le Any de sortie # ne sont pas forcés # d'être du même type return deepcopy(value) T = TypeVar("T") def copy_of_2(value: T) -> T: # Les variables en entrée # et en sortie sont forcées # d'être du même type return deepcopy(value)Le Variadic générique, quant à lui, est plus complexe et permet de gérer des types multi-dimensionnels.
 Là encore la mise en œuvre est subtile, je vous invite à aller lire la documentation officielle.
Là encore la mise en œuvre est subtile, je vous invite à aller lire la documentation officielle. Par contre dans les petits ajouts qui peuvent servir à tout le monde, il y a les types Required et NotRequired dans les TypedDict :
class Shape(TypedDict): x: Required[int] y: Required[int] color: NotRequired[int]Il y aussi le type Self qui a été ajouté, très pratique pour faire un constructeur :
class Shape: @classmethod def new(cls, x: int, y: int) -> Self: ...Il y a aussi un type LiteralString ajouté. Il peut être utilisé pour indiquer qu’un paramètre de fonction peut être de n’importe quel type de chaîne littérale (chaîne de caractères écrite en dur dans le code, comme « Hello World ! »).
Ce type est principalement utile pour renforcer la sécurité
 car il indique qu’une variable doit être codée en dur. Contrairement à un simple str, ce type garantit donc que la valeur provient directement du code source, sans transformation dynamique. Ainsi, LiteralString établit une distinction importante entre les chaînes définies explicitement dans le code et celles obtenues dynamiquement.
car il indique qu’une variable doit être codée en dur. Contrairement à un simple str, ce type garantit donc que la valeur provient directement du code source, sans transformation dynamique. Ainsi, LiteralString établit une distinction importante entre les chaînes définies explicitement dans le code et celles obtenues dynamiquement. Si vous êtes du genre à aimer creuser (ou que vous êtes simplement têtu·e comme moi), voici ce que j’ai compris sur le fonctionnement de LiteralString :
Si vous êtes du genre à aimer creuser (ou que vous êtes simplement têtu·e comme moi), voici ce que j’ai compris sur le fonctionnement de LiteralString :Le LiteralString vous permet d’ajouter un peu de sécurité et de rigueur dans votre code sans pour autant avoir un typage trop drastique. Pour mieux visualiser, on peut prendre en exemple une fonction d’affichage des logs.
def log(level: str, message: str): if level == "Error": print(message) level = "Error" + "\u200b" # "Error" avec un caractère invisible (Zero Width Space) log(level, "Ce message s'affiche !")Avec cette version de la fonction, on peut voir qu’il y a un problème de sécurité car notre message s’affichera alors que la variable level n’est pas exactement égale à Error. Pas bien grave me direz-vous. Et, en effet, ce n’est pas très important pour une fonction de logs, mais s’il s’agissait de la gestion de vos bases de données …
À l’inverse, on le Literal à l’extrême du typage :
from typing import Literal ERROR: Literal["Error"] = "Error" def log(level: Literal["Error"], message: str): if level == ERROR: print(message) log(ERROR, "Ce message s'affiche !") # Pas d'alert sur le type level = "Error" + "\u200b" # "Erreur" avec un caractère invisible (Zero Width Space) log(level, "Ce message ne s'affichera pas !") # Une erreur de type sera indiquéeAvec cette version de la fonction, on contrôle strictement le type de la variable level en entrée. Par contre, dès lors que l’on augmente le nombre de types possibles en entrée, la syntaxe devient laborieuse. De même, il est possible de ne pas connaître à l’avance tous les types d’entrée possible (dans le cas de composants extérieurs).
from typing import Literal INFO: Literal["Info"] = "Info" WARNING: Literal["Warning"] = "Warning" ERROR: Literal["Error"] = "Error" def log(external_component: ???, # Le type n'est pas connu level: Literal["Info", "Warning", "Error", ...], # On pourrait avoir beaucoup de types possibles message: str): if level == ERROR: print(message)Pour remédier à ces deux situations, on a donc trouvé le compromis du LiteralString :
from typing import LiteralString, Literal INFO: Literal["Info"] = "Info" WARNING: Literal["Warning"] = "Warning" ERROR: Literal["Error"] = "Error" def log(external_component: LiteralString, level: LiteralString, message: str): if level == ERROR: print(message) log(INFO, "Ce message ne s'affichera pas !") # Pas d'alert sur le type log(WARNING, "Ce message ne s'affichera pas !") # Pas d'alert sur le type log(ERROR, "Ce message s'affiche !") # Pas d'alert sur le typeIl est également possible d’utiliser à la fois le Literal et le LiteralString :
from typing import LiteralString, Literal INFO: LiteralString = "Info" # On définit INFO avec un type moins précis WARNING: Literal["Warning"] = "Warning" ERROR: Literal["Error"] = "Error" def log(external_component: LiteralString, level: Literal["Warning", "Error"], # Level est soit du type Literal["Warning"] soit du type Literal["Error"] message: str): if level == ERROR: print(message) log(INFO, "Ce message ne s'affichera pas !") # Alerte sur le type log(WARNING, "Ce message ne s'affichera pas !") # Pas d'alerte sur le type log(ERROR, "Ce message s'affiche !") # Pas d'alerte sur le type log(WARNING+ERROR, "Ce message ne s'affichera pas !") # Pas d'alerte sur le type. Pas très intéressant mais pourquoi pas ...Grâce aux deux exemples précédents, on peut donc en conclure que LiteralString regroupe tous les Literal[<…>] où <…> est une chaîne de caractères. Ainsi, on en déduit que LiteralString est le supertype de tous les types de chaînes littérales.
 Donc, tout « sous-type » de LiteralString (Literal[« Error »] ou bien encore Literal[« Warning »]) est compatible avec LiteralString , mais pas l’inverse (se référer à la variable INFO de l’exemple précédent).
Donc, tout « sous-type » de LiteralString (Literal[« Error »] ou bien encore Literal[« Warning »]) est compatible avec LiteralString , mais pas l’inverse (se référer à la variable INFO de l’exemple précédent).  De même, le supertype LiteralString est lui-même un str, faisant de str un super supertype.
De même, le supertype LiteralString est lui-même un str, faisant de str un super supertype.  Finalement, avec la même logique que précédemment, on en déduit bien qu’un str n’est pas compatible avec un LiteralString . On entend par là qu’il est possible d’assigner un LiteralString à un str, mais pas l’inverse.
Finalement, avec la même logique que précédemment, on en déduit bien qu’un str n’est pas compatible avec un LiteralString . On entend par là qu’il est possible d’assigner un LiteralString à un str, mais pas l’inverse. literal_string: LiteralString s: str = literal_string # OK literal_string: LiteralString = s # Erreur : # On attendait un # LiteralString, # on a un str literal_string: LiteralString = "hello" # OKUne chaîne créée en composant des objets typés LiteralString est, quant-à-elle, acceptable en tant que LiteralString (comme pour les Literal).
literal_string_1: LiteralString = "Hello" literal_string_2: LiteralString = " World" composed_string: LiteralString = literal_string_1 + literal_string_2 + " !" # Toujours un LiteralStringCe type est utile pour les API sensibles où des chaînes arbitraires générées par l’utilisateur peuvent générer des problèmes.
 Pour plus d’exemples, vous pouvez vous référer à la documentation officielle de Python.
Pour plus d’exemples, vous pouvez vous référer à la documentation officielle de Python.Du côté des décorateurs, la version 3.11 ajoute dataclass_transform qui est applicable à une classe, une métaclasse ou un décorateur. Ce décorateur permet de marquer un objet comme offrant un comportement de type dataclass tout en effectuant la vérification des types.
Pour rappel, le décorateur dataclass ajoute des méthodes générées et spéciales à une classe. On aura par exemple des méthodes comme __init__, __repr__ ou encore __eq__.
Version 3.12# Le décorateur create_model est défini par une bibliothèque. @typing.dataclass_transform() def create_model(cls: Type[T]) -> Type[T]: cls.__init__ = ... cls.__eq__ = ... cls.__ne__ = ... return cls # Le décorateur create_model peut désormais être utilisé # pour créer de nouvelles classes de modèles : @create_model class CustomerModel: id: int name: str c = CustomerModel(id=327, name="Eric Idle")La version 3.12 quant à elle introduit l’utilisation du type dictionnaire TypedDict pour avoir un typage plus précis des arguments (**kwargs).
Avant cet ajout, les **kwargs pouvaient être typés à condition que tous les arguments de mot-clé qu’ils spécifient soient du même type. Or, ce comportement était très limitant. Par exemple, annoter **kwargs avec un type str signifie que le type **kwargs est en fait un dict[str, str] et donc que tous les arguments de mot-clé dans foo sont des chaînes de caractères.
def foo(**kwargs: str) -> None: ...Malheureusement, il arrive souvent que les arguments de mots-clés véhiculés par **kwargs aient des types différents qui dépendent du nom du mot-clé. Dans ce cas, il n’était pas possible d’annoter le type des **kwargs.
Maintenant, en utilisant TypedDict pour typer les **kwargs, il est possible d’assigner un dictionnaire comme type des **kwargs. Ainsi, les **kwargs peuvent être typés séparément (par clé du dictionnaire).
from typing import TypedDict, Unpack class Movie(TypedDict): name: str year: int def foo(**kwargs: Unpack[Movie]): ... Pour plus de détails, je vous invite à consulter la documentation officiel de Python.
Pour plus de détails, je vous invite à consulter la documentation officiel de Python. La version 3.12 offre aussi un nouveau décorateur override qui sera sans doute utile pour une grande majorité. Ce dernier indique qu’une méthode dans une sous-classe est destinée à remplacer une méthode (ou un attribut) dans une classe parente.
 Cette version apporte également de nouvelles caractéristiques syntaxiques pour créer des classes génériques et des fonctions de façon explicite et compacte.
Cette version apporte également de nouvelles caractéristiques syntaxiques pour créer des classes génériques et des fonctions de façon explicite et compacte. def max[T](args: Iterable[T]) -> T: ... class list[T]: def __getitem__(self, index: int, /) -> T: ... def append(self, element: T) -> None: ...De plus, une nouvelle façon de déclarer des alias de type est introduite. Comme présenté sur l’exemple suivant, l’instruction type est utilisée, ce qui crée une instance de TypeAliasType et rend la déclaration explicite.
Version 3.13type Point = tuple[float, float]Avec la version 3.13, il est maintenant possible de définir une valeur par défaut pour les paramètres de type (TypeVar, ParamSpec, et TypeVarTuple).
T = TypeVar("T", default=int) # Si aucun type n'est spécifié, # T sera de type int @dataclass class Box(Generic[T]): value: T | None = None reveal_type(Box()) # Le type est Box[int] reveal_type(Box(value="Hello World!")) # Le type est Box[str]Il également possible, depuis cette version, de marquer une classe ou une fonction comme dépréciée à l’aide du nouveau décorateur deprecated. Ainsi, on peut informer les développeurs lorsqu’ils utilisent ces classes et fonctions pour qu’ils mettent en place les migrations nécessaires.
Autre petit ajout très utile, le qualificatif ReadOnly pour le type TypedDict qui permet de définir certaines clés comme étant en lecture seule. L’utilisation correcte de ces clés en lecture seule est destinée à être appliquée uniquement par les vérificateurs de type statique et non pas par Python lui-même au moment de l’exécution.
Finalement, la version 3.13 revient sur son ajout de TypeGuard dans la version 3.10. Cette version propose une alternative plus intuitive à TypeGuard : TypeIs. Cette nouvelle forme permet l’annotation de fonctions pouvant être utilisées pour affiner le type d’une valeur.
from typing import assert_type, final, TypeIs class Parent: pass class Child(Parent): pass @final class Unrelated: pass def is_parent(val: object) -> TypeIs[Parent]: return isinstance(val, Parent) def run(arg: Child | Unrelated): if is_parent(arg): # Le type de ``arg`` est réduit à l'intersection entre # ``Parent`` et ``Child``, # ce qui équivaut à ``Child``. assert_type(arg, Child) else: # Le type de ``arg`` est réduit pour exclure ``Parent``, # de sorte qu'il ne reste que ``Unrelated``. assert_type(arg, Unrelated)Contrairement à la forme spéciale TypeGuard existante, TypeIs peut affiner le type dans les branches if et else d’une condition. Cependant, TypeIs ne peut pas être utilisé lorsque les types d’entrée et de sortie sont incompatibles (par exemple, list[object] vers list[int]), ou lorsque la fonction ne renvoie pas True pour toutes les instances du type rétréci.
Conclusion Pour plus de précisions, je vous renvoie vers la documentation officielle.
Pour plus de précisions, je vous renvoie vers la documentation officielle.  On constate que le typage en Python est en pleine évolution, avec chaque version apportant son lot d’améliorations pour le rendre plus expressif, plus robuste et plus facile à utiliser.
On constate que le typage en Python est en pleine évolution, avec chaque version apportant son lot d’améliorations pour le rendre plus expressif, plus robuste et plus facile à utiliser. Les ajouts récents, comme Self, LiteralString, TypedDict ou encore override, montrent une volonté de rendre le typage plus intuitif et utile dans des scénarios concrets.
Avec la version 3.13, Python continue sur cette lancée en offrant des outils plus flexibles et en réajustant certaines décisions, comme l’alternative TypeIs pour TypeGuard.
 En résumé, le typage en Python présente des avantages (et aussi, parfois, des inconvénients) qui méritent d’être pris en compte dans vos développements.
En résumé, le typage en Python présente des avantages (et aussi, parfois, des inconvénients) qui méritent d’être pris en compte dans vos développements. D’un côté, il apporte une meilleure sécurité en réduisant le risque de bugs et les attaques. En imposant des types clairs, il permet également une meilleure lisibilité du code, notamment lorsque les structures et les workflows deviennent plus complexes. Cela facilite non seulement la maintenance, mais aussi la reprise du code par d’autres développeurs, rendant ainsi la collaboration plus fluide.
D’un côté, il apporte une meilleure sécurité en réduisant le risque de bugs et les attaques. En imposant des types clairs, il permet également une meilleure lisibilité du code, notamment lorsque les structures et les workflows deviennent plus complexes. Cela facilite non seulement la maintenance, mais aussi la reprise du code par d’autres développeurs, rendant ainsi la collaboration plus fluide. Cependant, le typage en Python présente aussi quelques limites. Certains types ou fonctionnalités, comme TypeGuard, peuvent être difficiles à prendre en main. De plus, certains types, tels que LiteralString, n’apportent pas toujours une réelle valeur ajoutée au regard de leur complexité d’utilisation. Enfin, l’ajout de types peut parfois alourdir visuellement le code, ce qui peut nuire à sa lisibilité.
Cependant, le typage en Python présente aussi quelques limites. Certains types ou fonctionnalités, comme TypeGuard, peuvent être difficiles à prendre en main. De plus, certains types, tels que LiteralString, n’apportent pas toujours une réelle valeur ajoutée au regard de leur complexité d’utilisation. Enfin, l’ajout de types peut parfois alourdir visuellement le code, ce qui peut nuire à sa lisibilité.Pour ma part, je pense qu’il est essentiel de prêter attention au typage. Il contribue grandement à la compréhension et à la maintenance du code, notamment lorsqu’il s’agit de reprendre le travail de quelqu’un d’autre. À mon sens, il est au minimum nécessaire de typer les prototypes de méthodes, en précisant clairement les types des entrées et des sorties. Au final, le plus important reste de discuter des normes de typage avec son équipe afin d’adopter une approche cohérente et adaptée aux besoins du projet.
Quoi qu’il en soit, le langage Python gagne en maturité, mais le typage demeure un terrain d’innovation. Il nous tarde de découvrir ses prochaines évolutions !
P.S. : Pour en apprendre plus sur les évolutions de Python (hors typage), je vous invite à consulter notre article intitulé « Découvrez les évolutions majeures de Python de 3.9 à 3.13 ».
Auteur : Mathilde Pommier
-
sur Cartographie collaborative des dispositifs d'indésirabilité
Publié: 17 February 2025, 4:49pm CET
Source : Milan Bonté (17 janvier 2025). « Une cartographie collaborative du mobilier urbain hostile ». Du béton et des plumes. Carnet de recherche sur le genre, les territoires et les minorités. [https:]]
A l’université de Lille, les étudiant-es de M2 Urbanisme et Aménagement disposent, début janvier, d’une semaine de formation en outils (SIG, croquis, dessin d’architecture, etc.) dans la perspective de leur très prochaine entrée dans le monde professionnel. Milan Bonté était chargé du module intitulé “Outils numériques au service des approches participatives“, dans lequel il avait pour mission d’initier un petit groupe d’étudiant-es aux outils cartographiques numériques qui peuvent être mobilisés lors de démarches de participation citoyenne. Il a saisi l’occasion d’inscrire ce module dans un vaste projet de recherche portant sur la “fabrique urbaine de l’indésirabilité” dans les espaces publics, financé par la défenseure des droits et coordonné par Muriel Froment-Meurice et Claire Hancock.
Durant l’ensemble de la semaine, le petit groupe s’est affairé à la création d’une application qui permette au grand public de cartographier, dans la France entière, les dispositifs qui contraignent les usages de l’espace public et produisent de facto des usages et usagers indésirables. On connait, à ce propos, le mobilier anti-SDF, qui vise à empêcher les siestes par des bancs à accoudoirs centraux ou des ornements rendant impossible toute tentative de se réfugier sous un porche pour une nuit.
Une cartographie collaborative du mobilier urbain hostile (source : Du béton et des plumes)

Vous pouvez consulter la carte et contribuer directement ici :
[https:]]L’application finale comprend une page d’accueil, sur laquelle le projet est expliqué, une carte qui recense l’ensemble des contributions et un formulaire, qui permet à n’importe qui de proposer l’ajout d’un dispositif. Ainsi, si vous avez connaissance d’un élément de mobilier urbain hostile, vous pouvez le prendre en photo et l’ajouter à la carte en cliquant sur “Ajouter un élément”.
Cartographie collaborative des dispositifs d'indésirabilité
[https:]]L’espace public, lieu de sociabilité et de diversité, reflète également les tensions sociales et les inégalités structurelles. Sa gestion et son aménagement peuvent générer des effets différenciés sur les individus, certains rencontrant des obstacles à s’y sentir légitimes ou à l'aise, modelant ainsi les usages de l’espace public. Ces ressentis sont façonnés par une combinaison de facteurs, qu’ils soient liés aux caractéristiques physiques des lieux, aux dispositifs de sécurité, ou aux dynamiques sociales et normatives qui s’y déploient.
En mars 2023, la Défenseure des droits a lancé un appel à recherche sur la gestion de l’espace public et les stratégies d’éviction des populations dites "indésirables". Cet appel vise à étudier les mécanismes formels et informels – qu’ils relèvent des infrastructures, des politiques urbaines ou des interactions sociales – qui participent à l’exclusion de certains usagers des espaces publics.
Dans le cadre du projet de recherche "La fabrique urbaine de l’indésirabilité", le site propose une démarche participative pour recueillir les dynamiques d’exclusion dans l’espace public. Le grand public est invité à contribuer à une cartographie participative recensant les dispositifs que chacun perçoit comme excluants, manquants ou ayant disparus et pouvant évincer certains individus.
Pour en savoir plus
Milan Bonté, Associé – jeune docteur auprès de l’UMR Géographie-cités, explique dans cet article comment, dans le cadre d’un cours de géomatique de niveau avancé, il a développé avec ses élèves une base de données collective portant sur le thème du mal logement dans la Métropole Européenne de Lille (MEL). [https:]]
Articles connexes
Atlas du mobilier urbain de Paris (APUR)
Visualiser l'orientation des rues dans n'importe quelle ville du monde
Dans ma rue : une application qui donne à voir les problèmes et incivilités en milieu urbain ?
Signaler les enfants bruyants dans sa rue : Dorozoku, un site cartographique controversé au Japon
Le forum d'OpenstreetMap, un lieu d'échange autour des enjeux de la cartographie collaborative et de l'open data
Cartes des pistes cyclables en Europe et en France : vers une cartographie collaborative
-
sur Cartographie électorale et big data. Pourquoi les clivages politiques urbains-ruraux ne sont pas généralisables
Publié: 16 February 2025, 8:28am CET
Source : Noah Dasanaike (2025). Why Urban-Rural Political Cleavages Do Not (document de travail)
Les clivages entre zones urbaines et zones rurales sont considérés comme une division politique déterminante, principalement en Occident et aux Etats-Unis. Mais cette polarisation est-elle valable à l’échelle mondiale ? Noah Dasanaike étudie cette question en utilisant un ensemble de données originales de résultats électoraux granulaires et géocodés provenant de 106 pays (au niveau des bureaux de vote dans 70 pays). Dans cet ensemble de données qu'il appelle Small-Area Global Elections (SAGE), il teste des résultats standardisés correspondant à des limites spatiales artificielles ou réelles dans chaque démocratie et aux élections démocratiques précédentes de plusieurs autocraties actuelles.
Les résultats des élections sont collectés et compilés sur une période de 3 ans. Il fusionne ces 10 milliards de votes avec 2,3 milliards d'empreintes de bâtiments pour mesurer l'urbanité, une approche qui permet de mieux appréhender la façon dont les gens perçoivent les zones urbaines et rurales. Il valide cela par rapport à la densité de population. Les résultats révèlent des variations considérables entre les pays. Dans de nombreux pays, les différences entre les zones urbaines et rurales sont faibles, voire inversées idéologiquement (zones rurales de gauche, zones urbaines de droite), et cela ne s'explique pas uniquement par le développement économique ou l'activité industrielle. Pour expliquer en partie ces résultats, l'auteur élabore une théorie dans laquelle les clivages urbains-ruraux proviennent du regroupement spatial d’attributs distincts des électeurs qui permettent aux partis de recourir à des votes géographiquement ciblés. D’abord à l’échelle mondiale, puis dans un test à grande échelle du comportement électoral à travers l’Europe, Dasanaike constate que la dispersion géographique des conditions économiques structurelles, à savoir l’agrarisme, l’industrialisation et l’agglomération des connaissances, explique en partie la disposition idéologique des villes vis-à-vis des campagnes.
Urban–rural cleavages are seen as a defining political divide. But does this polarization hold worldwide? My new working paper tests this question using an original dataset of granular, geocoded election returns from 106 countries (polling station-level in 70). (1/8) pic.twitter.com/pb2dP00goe
— Noah Dasanaike (@dasanaike) February 14, 2025If you're interested in seeing any detailed election results from the Small-Area Global Elections (SAGE) archive, let me know in the replies. I'll start with parliamentary elections in Poland in 1991 and 2023. pic.twitter.com/emsFyPuJMw
— Noah Dasanaike (@dasanaike) February 14, 2025Articles connexes
S'initier à la cartographie électorale à travers l'exemple des élections présidentielles de novembre 2020 aux Etats-Unis
Cartographie électorale, gerrymandering et fake-news aux Etats-Unis
Cartes et simulateur de votes de l'Observatoire électoral du Grand Continent
Bureaux de vote et adresses de leurs électeurs en France (Répertoire électoral unique - INSEE)
L'Insee propose un nouveau gradient de la ruralité (La France et ses territoires, édition 2021)
Cartographie des bassins urbains et ruraux à l'échelle mondiale (URCA - FAO)
Étude sur la diversité des ruralités (ANCT - Observatoire des territoires)Quand les cartes révèlent les frontières fantômes
-
sur Cartographie critique de l'intelligence artificielle générative (collectif Estampa)
Publié: 15 February 2025, 12:02pm CET
Le collectif Estampa propose une cartographie de l'intelligence artificielle générative. La carte met bien en évidence le parcours long et complexe des données lorsqu'on interroge une IA générative, avec tout ce que cela représente en termes de coût financier et de coût environnemental. Traduite en différentes langues (dont le français), la carte est téléchargeable en haute définition sur le site du projet Generative AI Mapping.
Cartographie de l'IA générative (source : Generative AI Mapping)
L’ensemble des relations présentées ici forme une mosaïque difficile à appréhender car elle implique la mise en relation d’objets et de connaissances de types et d’échelles différents. Les discours sur l’IA sont souvent mythiques et accompagnés d’une série de métaphores et d’images récurrentes : des agents algorithmiques déconnectés de l’action humaine, une technologie non négociable imposée par le futur, l’universalité des données ou la capacité de produire des modèles exempts de préjugés ou de visions du monde. L’ensemble des discours qui entourent ces technologies, qu’ils soient spécialisés ou plus populaires, finissent par les façonner d’une manière ou d’une autre.
La carte, très détaillée, décrit les étapes sucessives de regroupement, filtrage, hébergement et distribution des données, avec à chaque étape les coûts induits que cela représente. Elle montre que l'IA repose dans ses fondements sur un modèle extraviviste de données (il faut beaucoup de données d'entraînement au départ), qu'elle nécessite de gros investissements de la part de start-ups capables de construire de gigantesques datacenters pour héberger les serveurs et fournir la puissance de calcul. Outre le coût financier, le côut environnemental est faramineux. Il faut des matériaux conducteurs (principalement de l'or), mais aussi du lithium pour les batteries, de l'eau pour refroidir les ordinateurs, ce qui se traduit par une forte pression sur les ressources.
Le projet Generative AI Mapping est motivé par la volonté d'offrir une carte conceptuelle qui couvre une grande partie des acteurs et des ressources impliqués dans cet objet complexe et multiforme qu'est l'IA générative. À partir d’une longue série de cartographies critiques vouées à montrer la fonction des cartes comme productrices de vérités hégémoniques, cette visualisation vise à cartographier le phénomène en tenant compte des tensions, des controverses et des écosystèmes qui le rendent possible. Les outils d’IA générative sont utilisés pour automatiser des tâches telles que l’écriture ou la génération d’images. On peut dire d'une certaine façon que les outils d’IA générative désassemblent le langage (visuel, textuel) pour le réassembler sur la base d’un calcul de probabilité. Cette capacité de généralisation est due au traitement d'ensembles de données beaucoup plus grands et hétérogènes qui lui permettent de répondre à tous types d'instructions. En conséquence, l’ampleur du changement dans l’IA générative est si grande qu’elle nécessite l’impulsion de nouvelles économies et une dépendance accélérée à l’égard de différents écosystèmes. En ce sens, Generative AI Mapping se veut un projet de contre-cartographie visant à dénoncer le "colonialisme numérique", qui aboutit à la domination des pays en avance en matière d'IA par rapport aux autres pays et territoires de fait dominés.
Estampa est un collectif de programmeurs, cinéastes et chercheurs travaillant dans les domaines de l’audiovisuel et des environnements numériques. Leur pratique se base sur une approche critique et archéologique des technologies audiovisuelles, sur la recherche des outils et des idéologies de l’intelligence artificielle et sur les ressources de l’animation expérimentale. Ce travail a été soutenu par les subventions pour la recherche et l'innovation dans les arts visuels de la Generalitat de Catalunya - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC).
Pour aller plus loin
Crawford, K. (2021). Atlas of AI: power, politics, and the planetary costs of artificial intelligence. New Haven, Yale University Press.
« Que se passe-t-il lorsque l’intelligence artificielle sature la vie politique et épuise la planète ? Comment l’IA façonne-t-elle notre compréhension de nous-mêmes et de nos sociétés ? Dans ce livre, Kate Crawford révèle comment ce réseau planétaire alimente une évolution vers une gouvernance antidémocratique et une augmentation des inégalités. S’appuyant sur plus d’une décennie de recherche, de sciences et de technologies primées, Crawford révèle comment l’IA est une technologie d’extraction : de l’énergie et des minéraux nécessaires à la construction et à l’entretien de son infrastructure, aux travailleurs exploités derrière les services « automatisés », aux données que l’IA collecte auprès de nous. Plutôt que de se concentrer sur le code et les algorithmes, Crawford nous offre une perspective politique et matérielle sur ce qu’il faut pour créer une intelligence artificielle et sur les points sur lesquels elle se trompe. Si les systèmes techniques présentent un vernis d’objectivité, ils sont toujours des systèmes de pouvoir. Il s’agit d’un compte rendu urgent de ce qui est en jeu lorsque les entreprises technologiques utilisent l’intelligence artificielle pour remodeler le monde. »
Espinoza, M. I., Aronczyk, M. (2021). Big data for climate action or climate action for big data? Big Data & Society, 8(1). [https:]]
Sous la bannière « Data for Good », les entreprises des secteurs de la technologie, de la finance et de la vente au détail fournissent leurs propres ensembles de données aux agences de développement, aux ONG et aux organisations intergouvernementales pour les aider à résoudre toute une série de problèmes sociaux. l'ouvrage se concentre sur les activités et les implications de la campagne Data for Climate Action, un ensemble de collaborations public-privé qui exploitent les données des utilisateurs pour concevoir des réponses innovantes à la crise climatique mondiale. En s'appuyant sur des entretiens approfondis, des observations de première main lors d’événements « Data for Good », des rapports d’organisations intergouvernementales et internationales et sur la publicité médiatique, les auteurs évaluent la logique qui sous-tend les initiatives Data for Climate Action, en examinant les implications de l’application d’ensembles de données et d’expertises commerciales aux problèmes environnementaux. Malgré l’adoption croissante des paradigmes Data for Climate Action dans les efforts des gouvernements et du secteur public pour lutter contre le changement climatique, l'ouvrage montre que Data for Climate Action peut être considéré comme une stratégie visant à légitimer les pratiques d’extraction de données à but lucratif des entreprises plutôt que comme un moyen d’atteindre les objectifs mondiaux de durabilité environnementale.
« Référentiel de compétences IA pour les apprenants et pour les enseignants » (UNESCO)
L’intelligence artificielle (IA) offre des potentialités pour relever nombre de défis majeurs dans l’éducation, innover dans les pratiques d’enseignement et d’apprentissage et accélérer les progrès de l’ODD 4. Cependant, les évolutions technologiques rapides engendrent inévitablement de multiples risques et défis, car leur rythme a jusqu’à présent dépassé celui des débats politiques et des cadres réglementaires. L’UNESCO s’engage à aider les États membres à exploiter les potentialités des technologies d’IA pour réaliser l’Agenda Éducation 2030, tout en veillant à ce que son application dans le domaine éducatif réponde aux principes fondamentaux d’inclusion et d’équité. Étant donné l’opacité de la « boîte noire » qui sous-tend les méthodes utilisées par les systèmes d’IA, les enseignants doivent comprendre à la fois comment l’IA est entraînée et comment elle fonctionne. Ils doivent également être en mesure d’examiner d’un oeil critique l’exactitude des contenus générés par l’IA et de concevoir des méthodes pédagogiques appropriées pour guider l’utilisation du contenu synthétisé par l’IA dans l’enseignement et l’apprentissage.
« L'intelligence artificielle, une arme géopolitique » (France Culture)
Duel États-Unis-Chine, à coup de milliards de dollars et de modèles de langage toujours plus révolutionnaires. Sommet à Paris coprésidé par l'Inde et annonces d'ambitions démesurées dans le monde entier. L'IA est devenue une arme géopolitique majeure. Voici les clés historiques de ce développement crucial dans une série audio de la rédaction de France Culture, en 6 volets.
« Les sacrifiés de l'IA » (France 2).
Magiques, autonomes, toutes puissantes : les intelligences artificielles nourrissent les rêves comme les cauchemars. Tandis que les géants de la tech promettent l'avènement d'une nouvelle humanité, la réalité de leur production reste totalement occultée. Pendant que les data centers bétonnent les paysages et assèchent les rivières, des millions de travailleurs à travers le monde préparent les milliards de données qui alimenteront les algorithmes voraces des Big Tech, au prix de leur santé mentale et émotionnelle. Seraient-ils les dommages collatéraux dommages collatéraux de l'idéologie du "long-termisme" qui couve dans la Silicon Valley depuis quelques années ?Articles connexes
Géographie des datacenters dans le monde
Les investissements de la Chine dans les secteurs de l'Intelligence artificielle et de la surveillance
Telegeography met à jour sa carte des câbles sous-marins (version 2020 à 2023)
Les câbles sous-marins, enjeu majeur de la mondialisation de l'information
Le monde de l'Internet en 2021 représenté comme un planisphère par Martin Vargic
Une vidéo sur l'évolution du réseau Internet (1997-2021) à partir des données du projet Opte
Une cartographie mondiale des points de connexion Wi-Fi réalisée dans le cadre du projet WiGLE
-
sur La Commission européenne lance une consultation sur le GreenData4All et l'évolution d'INSPIRE
Publié: 14 February 2025, 9:41am CET
La Commission européenne lance une consultation sur le GreenData4All et l'évolution d'INSPIRE
-
sur Étude d’aide à la décision stratégique et technique / centre CEA de Grenoble
Publié: 14 February 2025, 6:46am CET par Caroline Chanlon

Oslandia a réalisé en 2024 une étude d’aide à la décision stratégique et technique pour le centre CEA de Grenoble, avec une prestation de nos consultants portant sur le système d’information géographique et la pertinence des outils OpenSource pour répondre aux besoins fonctionnels tout en prenant en compte les aspects budgétaires et organisationnels.
Nathalie TUR : « L’audit fonctionnel et technique réalisé par Oslandia a permis d’identifier les dysfonctionnements et les axes d’amélioration de notre SIG. Les consultants se sont distingués de par leur expertise et leur capacité à appréhender les contraintes et spécificités des périmètres Métiers du centre CEA de Grenoble »
-
sur ASIE CENTRALE (300-850) Des routes et des royaumes – Etienne de la Vaissière
Publié: 13 February 2025, 8:31pm CET par r.a.
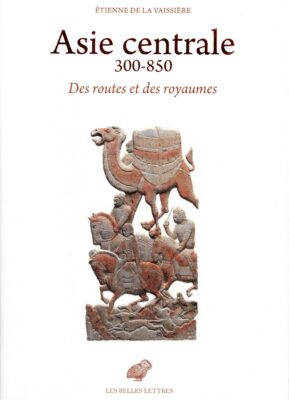
Caravane sogdienne et gardes turcs. Lit funéraire du Musée Miho, Chine, VIè siècle
Ecoutez ce que nous dit Etienne de la Vaissière, en guise d’introduction : « Cher lecteur, tu vas entrer en eaux profondes et rien ne sera familier, rien ne sera connu, de peuples étrangers en toponymes abscons. Plonge ! Accepte d’être perdu, va de carte en carte … tu découvriras un monde immense ».
Cet ouvrage exceptionnel ne compte pas moins de 125 cartes et illustrations diverses : peintures, miniatures, manuscrits, estampes et statues. Je ne résiste pas au plaisir de vous faire partager la carte ci-dessous. Elle vous sera nécessaire pour comprendre l’importance que cette région a et a eue depuis la nuit des temps.
A la fin de l’ouvrage, de cette somme devrais-je dire, qui compte plus de 600 pages, Etienne de la Vaissière nous propose une chronologie (en 6 pages) des faits essentiels qui se sont produits entre 300 et 850 de notre ère et un additif intitulé « Coulisses » de 30 pages dans lesquelles il explique sur quelles bases et avec quels outils, il a œuvré pour relier des textes très dispersés de Dunhuang à la Bactriane.
L’ouvrage compte 7 parties, précédées de l’analyse d’une lettre extraordinaire datant du IV ème siècle de notre ère, retrouvée en 1907 par l’explorateur Aurel Stein. Elle avait voyagé sur 2 600 km de pistes caravanières depuis le Gansu (actuelle province de Chine), jusqu’en Ouzbékistan. Rédigée en 303 par un marchand de Samarcande, elle témoigne de l’existence d’un commerce transasiatique de très grand rayon, reliant la Chine au monde iranien. Sogdiens, Indiens, Chinois, nomades s’y croisent, auxquels s’ajoutent à partir du VII ème siècle Arabes et Tibétains. Déjà le commerce de la soie est mentionné, de même que celui du précieux musc tibétain.
Tout cela sera bouleversé par l’arrivée des Huns, qui viennent de Mongolie à la fin du IV ème siècle. Puis le commerce repart, en suivant le sillage de la diffusion du bouddhisme et aux denrées précédentes s’ajoutent le lapis-lazuli et les fourrures de l’Oural.
Les grands géographes arabes et persans des IX et X ème siècles nommaient leurs ouvrages, « Livres des routes et des royaumes » et c’est bien de cela que le livre d’Etienne va nous parler.? Les maîtres de l’eau
L’Asie centrale peut-être définie comme une vaste interface, une zone de contact entre nomades et sédentaires. Les oasis se sont ceinturées de longs murs, de Samarcande à Boukhara. Ici, les cultivateurs s’aidaient souvent d’esclaves achetés par milliers sur les marchés centrasiatiques. Marchés sur lesquels on trouvait, outre les produits agricoles,des objets issus de la métallurgie (cuivre, argent, or, plomb, lapis-lazuli). Il est possible que l’oasis de Samarcande ait abrité jusqu’à 100 000 foyers, soit 500 000 personnes.
Tout nous est relaté aussi :
– de la mer d’Aral qui a maintes fois disparu avant que l’homme n’en soit responsable ;
– des routes de commerce disparues, comme de celles qui fonctionnent encore ;
– des riches terres irriguées déjà vers 2 000 ans av.n.ère, mises en valeur par des monastères ou colonisées par des envahisseurs successifs, oubliées parfois lorsque des pasteurs nomades venus de Mongolie, de Chine ou de Turquie, à cheval ou à dos de chameau, ne s’en souciaient guère.
L’Asie centrale fut aussi presque oubliée lorsque des variations climatiques intenses contribuèrent à la disparition des empires.Si l’historien fonde son travail sur l’archéologie, les textes retrouvés, la numismatique (les monnaies), il s’intéresse aussi à l’évolution économique et sociale.
Les nomades ont été perçus comme des clans familiaux regroupés en tribus, elles mêmes confédérées sous la coupe de grandes « seigneuries ». Ils se déplacent entre pâturages d’été et d’hiver, mais ils effectuent parfois de véritables migrations, lorsqu’un pouvoir militaire suffisamment fort peut aller conquérir des terres de sédentaires. Nul n’ignore le mouvement des Huns jusqu’à la Volga, ou celui des Turcs jusqu’en Sogdiane.
Les nomades conquérants vont édifier des châteaux forteresses, véritables nids d’aigles qui balisent leurs routes.Cependant l’espace centrasiatique reste discontinu, chaque oasis conserve la trace de son récit fondateur. La diversité linguistique (17 langues) atteste aussi des isolements. A l’ouest, les groupes linguistiques sont Khorezmien, Pehlevi, Sogdien, Bactrien. Ils dérivent des langues iraniennes. A l’est on va parler le Turc, le Chinois, le Mongol ou même le Tibétain.
? Le Grand Jeu : l’irruption des Turcs puis des Chinois et des Tibétains
Bien avant le « Grand Jeu Russo-Britannique » très connu du début du XX ème siècle, (opposant à Kachgar l’empire Britannique à la Russie), on a pu ici aussi, parler de Grand Jeu.
Au VI ème siècle, toute la steppe, de la Crimée à la Mandchourie est contrôlée par l’empire Turc, la plupart des élites en proviennent. Le commerce entre cet empire et la Chine est florissant. Au VII ème siècle, la Chine prend le dessus et les Turcs doivent reculer (640-670). Commence alors la période des raids impériaux qui pillent et massacrent ou exigent tribut.
Le millefeuille social hérité du peuplement iranien et des nomades se complexifie avec la turquisation. Au zoroastrisme se superpose le bouddhisme qui décore des grottes et de prestigieux monastères qui conserveront, entre autres, de nombreux manuscrits en chinois.A partir de 660, un empire Tibétain devient très puissant, son apogée date de 692. Puis les Chinois reprennent le dessus jusqu’en 750. En 751 se déroule la très célèbre bataille de Talas qui fait basculer la région dans l’islam et le monde Arabe (651-738).
Dans un premier temps, les structures de contrôle mises en place par les Chinois sont conservées : régime foncier, impôts, monnaie. Puis la soie reprend son rôle de monnaie d’échange dans le grand commerce eurasiatique.
? Epilogue
Les quatre empires, appelés ici « Les rois du monde » qui conquièrent tout ou partie de l’Asie centrale ont chacun des buts qui divergent, mais les méthodes de conquête et de contrôle sont les mêmes.
Il faut avoir des bases solides (forteresses, tours) situées au centre de zones de raids qui leur permettent de tenir des territoires sans commune mesure avec leurs effectifs militaires. Ensuite il faut disposer de garnisons sur les grandes routes qui sont autant routes de commerce que réseaux d’information. Il faut avoir enfin des fonctionnaires pour lever le tribut.Le chapitre sur Le livre des routes analyse minutieusement : les temps de parcours des caravanes de chameaux et des groupes de voyageurs, d’éclaireurs, mais aussi des « pillards professionnels » de ces convois. Des textes relatent la difficulté du passage des cols et des gués.
Ensuite vient l’étude de l’action des Etats qui contrôlent les déplacements entre steppes et oasis. Il fallait des laissez-passer et à chaque tour de gué était vérifié la composition de la caravane. Parfois des murailles étaient édifiées, comme en Chine. Enfin il fallait des temps de repos aux caravanes. Les caravansérails sont des lieux qui ont toujours attiré les curieux, historiens ou pas, car ici les échanges étaient aussi intellectuels et religieux.
Si du IV ème au IX ème siècle, se sont les marchands Sogdiens (Samarkand, Boukhara) qui dominent le monde des échanges, on a pu prouver qu’avant eux (dès le II è siècle avant n.è.) les marchands les plus influents étaient venus de l’actuel Afghanistan et du Nord-Ouest de l’Inde. Ils sont à l’origine de la diffusion du bouddhisme.Le chapitre suivant, intitulé Economie globale, remet en cause tous les à priori à l’aide de peintures, de textes surtout, mais aussi de reproduction de monnaies et de pièces d’orfèvrerie.
Cela représente un travail de titan, « une somme » captivante.
Etienne de la Vaissière insiste sur le sens Est – Ouest des échanges. L’Inde a fourni les épices (poivre, clou de girofle) ; Byzance fut fournisseur de corail et l’Iran d’argenterie. La fabrication du verre fut romaine puis iranienne. Le sucre raffiné fut produit d’abord par le savoir-faire indien. Le coton ne devient que tardivement un produit centrasiatique. Le papier arrive de Chine et atteint d’abord l’Est de l’Asie Centrale où il est fabriqué à partir du X ème siècle. A l’inverse la vigne ne connut longtemps aucun succès en Chine.? Figures des dieux
Les deux faces du ciel. Aux côtés des religions missionnaires (manichéisme, bouddhisme, christianisme) deux grands systèmes de croyances se partagent le monde centrasiatique, l’un régit par le culte du feu (zoroastrisme) et appartenant au domaine iranien et l’autre régi par le culte du ciel, répandu dans les steppes. Ils semblent n’avoir rien en commun, mais en réalité, un continuum, de plusieurs strates historiques se sont entrelacées avec des objets communs.
Les religions missionnaires ont laissé beaucoup plus de traces que ce soit le bouddhisme venu d’Inde depuis le Gandhara puis diffusé en Chine puis au Proche-Orient ; le judaïsme implanté à Merv depuis le IVème siècle puis diffusé jusqu’au nord-est de l’Afghanistan où l’on a retrouvé des ossuaires ou le christianisme.
Mais sait-on exactement à quoi servaient les temples et les stupas, les monastères, les sanctuaires rupestres des montagnes, ou les grottes extraordinaires découvertes par une expédition allemande au début du XX ème siècle ?L’économie bouddhique des mérites peut retenir l’attention. Elle fonctionne sur le don, le don qui vous apporte une protection spirituelle, qu’il soit modeste ou grandiose. En échange ont lieu des prêches aux laïcs, des cérémonies grandioses. Aux rois donateurs les bouddhistes fournissent des conseillers qui orientent la vie politique de l’Asie centrale…cela a-t-il changé ?
Comme partout les monastères sont de grands propriétaires terriens et leurs terres sont travaillées par des esclaves qui défrichent puis gèrent les domaines avant de construire des canalisations, des moulins et des pressoirs. Dans ce monde les moines sont autorisés à se marier, ils sont aussi marchands et accompagnent les caravanes. Ils peuvent aussi être artisans et artistes et produire sculptures, peintures, autels portatifs.Palimpsestes
Il s’agit de parchemins manuscrits dont on a effacé la première écriture pour pouvoir écrire un nouveau texte. Certains objets superposent les influences : une boite peinte, une enluminure, un manuscrit, etc.
Les reliques et les reliquaires ont servi de support ainsi que des masques et des instruments de musique. Les ventes et les vols de reliques sont innombrables surtouts si un bol ou un ongle ont appartenu à Bouddha !La boite, reproduite ci-après, est un reliquaire de Koutcha. Il est en bois de peuplier tourné, recouvert de tissu de chanvre peint. Il a été retrouvé à Kouchan, par une mission japonaise en 1903. Il date du VI ou VII ème siècle. Il s’agit d’un travail extraordinaire qui présente les amusements d’une ville.

Puis vint l’art du livre avec le rôle croissant de l’islam
Les livres écrits par les missionnaires comportent beaucoup d’images car chaque missionnaire était accompagné d’un peintre. Le livre était un objet luxueux, avant de devenir un objet de transmission de savoirs et de cultures : il fut rouleau, replié en accordéon, ou feuilles superposées, avant d’être imprimé au IX ème siècle.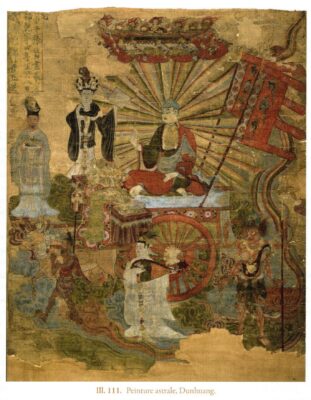
Sur cette peinture sur soie de Dunhuang, (fin IX ème siècle) on voit autour d’un Bouddha astral rayonnant de lumière, les cinq planètes : le guerrier de Mars, la belle Vénus, qui joue du luth pipa, le vieux Saturne, Jupiter et Mercure tenant une tablette. Quatre d’entre eux ont gardé dans leur coiffe leurs attributs égyptiens, l’âne pour Mars, le phénix pour Vénus, le bœuf d’Horus pour Saturne, le singe de Toth, dieu des scribes, pour Mercure. Seul le cochon qui sert de coiffe à Jupiter est d’origine inconnue.
Ce rouleau et cette peinture ouvrent sur une histoire véritablement mondiale des circulations de savoirs.La musique joue aussi un rôle important et au VII ème, la moitié des orchestres officiels de la cour de Chine sont centre-asiatiques : on y écoute luth, harpe, orgue à bouche, flûte de paon, percussions.
L’astrologie est alors la reine des sciences, reposant sur le mouvement des astres, surplombant tous les pays et chaque homme, répondant (ou pas) aux angoisses.
? Ruptures 738-840
- Trois dates sont essentielles pour comprendre la suite des événements :
742 : défaite des Turcs face à une coalition de leurs sujets,
749 : installation sur le trône califal, en Irak, pour un millénaire, de la dynastie des Abbassides, descendants de l’oncle de Mahomet, par une armée centre asiatique,
755 : rébellion d’An Lushan, général turco-sogdien, qui bouleverse l’empire des Tang.
A la fin du X ème, le géographe Muqaddasî écrit qu’en Asie centrale, tout le monde est musulman, à l’exception des juifs et de quelques chrétiens.
Un réseau de mosquées urbaines se met en place. A Boukhara, un temple préislamique de la Lune est remplacé par une mosquée. Pour ceux qui ne devenaient pas musulmans, existait le statut de dhimmi : ils étaient protégés en échange du paiement de la capitation. Appliqué d’abord aux juifs et chrétiens, il le fut ensuite aux bouddhistes. Beaucoup d’historiens ont souligné que si les temples bouddhistes avaient disparu, beaucoup de madrasas musulmanes s’étaient inspirées de leur plan et de leur architecture.Nouvelles frontières : confrontation Chinois / Ouïghours / Tibétains
De 744 à 840, un puissant empire Ouighour se met en place en Asie centrale et s’étend jusqu’à Kachgar à partir de 802. Les chevaux (du Ferghana) sont échangés contre de la soie. Cette période ouïghoure dans les steppes correspond à un changement majeur dans la façon d’habiter l’espace. Ils construisent des villes fortifiées, des palais et des lignes de fortins frontaliers. Mais des camps de tentes subsistent à l’extérieur et une « tente d’or, peut être dressée sur les terrasses du palais !
Un empire Tibétain partage l’Asie centrale avec l’empire Ouighour, lorsque le savoir faire dans le travail des métaux devient acquis, en particulier la confection des armures. Le commerce du musc reste aussi très lucratif.
La Chine inonde les routes maritimes avec un nouveau savoir faire : celui des céramiques. Le grès fut très apprécié avant que les porcelaines ne l’emportent.
Mais bientôt les routes maritimes se firent plus sûres et les routes terrestres entrèrent dans l’oubli.
Je cite Etienne de la Vaissière, en guise de conclusion :« L’Asie centrale est tout à la fois, un intermédiaire, dominé par les immenses pôles de ses voisins – production intellectuelle indienne, immense richesse, puissance et prestige de l’Etat chinois, légitimités et machines militaires turques et iraniennes – et un acteur.
A vous tous qui lisez ce compte rendu, si dans l’âme vous êtes un géographe, un voyageur, alors partez ! Vous découvrirez mille choses encore inconnues puis vous nous les apprendrez.
Maryse Verfaillie -février 2025
Je rappelle que l’ouvrage d’Etienne de la Vaissière est non seulement « une somme » magnifique sur le fond, mais qu’il est aussi sur la forme : plaisir des yeux, plaisir du toucher car le papier de ce volume sort, en décembre 2023 de l’imprimerie SEPEC à Péronnas (01960). Et l’ouvrage a été édité par la Société Les Belles Lettres, en 2024.
Au-delà de l’immense bibliographie contenue dans ce livre, je m’autorise à indiquer quelques liens sur des textes publiés récemment sur l’Asie centrale.( [cafe-geo.net] )
Bibliographie
Atlas des mondes musulmans médiévaux- CNRS Editions- Sylvie Denoix et Vanessa Van Renterghem-2022
Une carte par jour- Frank Tétart- autrement- 2018
L’Atlas des Civilisations – Le Monde Hors Série 2009
Les Empires en cartes – Le Monde Hors Série 2024
L’Asie centrale, des empires à la mondialisation, Julien Thorez Les Cafés Géo- mai 2016
L’Asie centrale- Renaissance et recomposition d’un espace régional oublié- Alain Cariou – Echogéo- septembre 2009
Le rêve chinois en Asie centrale Emmanuel Lincot // asialyst.com/fr/2024.
-
sur Cycle de conférences en histoire de la cartographie à la BnF – Saison 3
Publié: 13 February 2025, 6:53pm CET par Thibault de Warren
 Jacques Bertin, manuscrit de La graphique et le traitement graphique de l’information, avant 1977. BnF, Cartes et Plans, GE EE-8890.
Jacques Bertin, manuscrit de La graphique et le traitement graphique de l’information, avant 1977. BnF, Cartes et Plans, GE EE-8890.
Globes et atlas, cartes et plans à toutes les échelles exercent sur nous un véritable pouvoir de fascination.
D’où vient cette emprise ? Pourquoi dresse-t-on des cartes depuis la nuit des temps ? À quels besoins et usages répondent-elles ? Quels en sont les auteurs ?
Voici quelques-unes des questions auxquelles le département des Cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France se propose de répondre grâce à un cycle d’initiation à l’histoire de la cartographie, ouvert à tout public.
Sa troisième saison est dédiée aux nouvelles problématiques auxquelles la cartographie est confrontée : décentrement géopolitique du monde, questions écologiques, impact du numérique sur la représentation de l’espace.Informations pratiques :
BnF, site Richelieu | 5, rue Vivienne, Paris 2e | Salle des Conférences | de 18h15 à 20h.
Entrée gratuite. Réservation recommandée sur : [https:]] (ouverture des inscriptions un mois avant chaque conférence)
Expositions cartographiques et espaces urbains (Paris, XVIIIe-XXe siècle) 6 février 2025 Jean-Marc Besse, Directeur de recherche CNRS – Directeur d’études à l’EHESSLes opérations cartographiques n’ont pas toujours été limitées au monde des savants, des militaires et des ingénieurs, et les cartes ne sont pas toujours restées confinées à l’intérieur des bibliothèques et des dépôts d’archives. Que ce soit sous la forme d’objets symboliques exhibés lors d’événements publics, d’espaces architecturaux et décoratifs destinés à l’éducation, ou de supports matériels de projets politiques déterminés, les cartes et les globes, à différentes échelles, sont depuis longtemps présents aussi dans les espaces publics des grandes villes, favorisant ainsi la diffusion d’une culture géographique auprès des habitants et des passants. Le but de cette conférence est de présenter quelques-uns de ces installations et dispositifs cartographiques créés à Paris depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’à la période contemporaine.
Le « Plan de Paris mis en carte géographique du Royaume de France » (plan ci dessous) accompagne la publication de la Géographie parisienne de l’abbé Étienne Teisserenc en 1754. Dans ce projet, le but est de rebaptiser les rues de Paris en leur attribuant des noms des régions de France. Comme si Paris devait incarner la France, et les lecteurs de la carte y apprendre à la fois Paris et le Royaume. Ce projet trouvera divers prolongements et reformulations, au cours de la Révolution française, puis sous la IIIe République.

Teisserenc, Étienne (Abbé), Géographie parisienne en forme de dictionnaire, contenant l’explication de Paris ou de son plan, mis en carte géographique du royaume de France, pour servir d’introduction à la géographie générale, Paris, Rue Robinot, 1754. BnF, 8-LK7-6020.
Les blancs des cartes dans un monde géonumérisé 13 mars 2025 Matthieu Noucher, Directeur de recherche au CNRS, Laboratoire PASSAGES (Bordeaux)Les cartographes ont longtemps cherché à remplir leurs cartes avec un maximum d’information. Combler les blancs des cartes s’est alors révélé être, au fil des siècles, un véritable défi, alimentant une soif d’aventure, un désir de conquête ou encore une volonté de connaissance toujours plus approfondie des territoires. Aujourd’hui encore, même face au déluge de données numériques, des fractures cartographiques demeurent et des blancs subsistent. L’exposé explorera différentes manières de les remplir et nous nous interrogerons sur la pertinence de vouloir les combler à tout prix.
Le Lac Parimé (dans la carte ci-dessous) : un mythe qui a longtemps été utilisé pour combler le blanc des cartes et servir différents projets de conquête coloniale. Nous verrons alors, qu’à l’heure de l’intelligence artificielle, de nouveaux mythes cartographiques semblent voir le jour…

Hondius, Jodocus II, Guiana sive Amazonum regio (avec des lieux imaginaires : lac Parimé et Eldorado), vers 1630. Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, R 2= 22 P. 67.
Contours de la contre-cartographie 10 avril 2025 Nephtys Zwer, Docteure en histoire, fondatrice du site [https:]]Qu’est-ce que la contre-cartographie ? La dénomination intrigue car elle recouvre les multiples expressions d’une géographie alternative. La caractéristique la plus saillante de la cartographie dite radicale, critique ou militante est qu’elle s’approprie le pouvoir performatif des cartes dans une démarche politique. Les cartes du Detroit Geographical Expedition and Institute en sont un exemple paradigmatique. Mais la nature de cette subversion s’inscrit aussi dans ses formes. Il convient alors d’appliquer l’étiquette à beaucoup de cartes conçues hors du régime de production habituel de l’information géographique. Il en est ainsi des cartes sensibles dressées par des non-cartographes pour visualiser leurs propres pratiques et perceptions de l’espace. Quels critères retenir alors pour y voir un peu plus clair ? Cette conférence propose d’explorer la généalogie et les manifestations de la contre-cartographie – encore perçue comme nouvelle – afin d’en dessiner les contours.
Dans la tradition des recueils d’Itinéraires et Royaumes, le géographe persan Istakhri a cartographié les sites importants du monde musulman. Cette représentation de la Méditerranée (image ci dessous) est orientée avec l’ouest en haut. Le dôme triangulaire, ici nommé Jabal al-Qil?l (« mont du bois »), représente le comptoir sarrasin du Fraxinet, probablement situé dans la région de la Garde-Freinet en Provence. Il marque la porte d’entrée à cette partie de la Méditerranée. Les trois cercles représentent, de haut en bas, la Sicile, la Crête et Chypre…

Abou Ishak Ibrahim ibn Mohammed el-Farisi, surnommé el-Istakhri, carte de la Méditerranée (détail), dans Kitab al-Masalik wa’l-Mamalik, début du Xe siècle. Fac-similé réalisé en 1819-1821 [Copie ? par Khv?nd M?r, Ghiy?s? al-D?n ibn Hum?m al-D?n (1475?-1535?). BnF, Manuscrits, Supplément persan 355.
Carte et communication. Map design, sémiologie graphique, géovisualisation 15 mai 2025 Gilles Palsky, Professeur émérite, Université de Paris 1 Panthéon-SorbonneLa cartographie connaît un changement de paradigme dans les années 1950-1960, avec la mise en avant de la capacité des cartes à communiquer de l’information. Cette association de la carte et de la communication s’incarne dans deux grands courants théoriques initiés en France par Jacques Bertin (la sémiologie graphique) et aux États-Unis par Arthur H. Robinson (le map-design). Tous deux ont pâti, à partir des années 1980, de la priorité donnée aux SIG (Systèmes d’information Géographique), aux données numériques et à leur traitement, faisant passer la dimension visuelle des cartes au second plan. La réflexion sur la communication graphique s’est cependant renouvelée dans le cadre d’une discipline intégratrice, la géovisualisation.
Dès les années 1950, le français Jacques Bertin (1918-2010) développe de premières recherches théoriques sur la cartographie, à l’occasion du travail d’illustration (illustration ci dessous) qu’il réalise pour l’étude collective dirigée par Paul Chombart de Lauwe sur l’espace social de la région parisienne (1952)…

P. H. Chombart de Lauwe, [et al.], Paris et l’agglomération parisienne, série B, tome 1, recherche graphique par Jacques Bertin, Paris, PUF, 1952, pl. 17. BnF, Philosophie, histoire, sciences de l’homme, 8-R-56004 (1,1).
Ce que l’ordinateur fait aux cartes 12 juin 2025 Henri Desbois, Maître de conférences en géographie, Université Paris-NanterreL’informatique, d’abord introduite à partir des années 1960 dans le traitement des données de la géographie militaire de la guerre froide a massivement transformé la manière de produire, de diffuser et d’utiliser les cartes entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe. Les cartes se sont multipliées, ont changé d’aspect, et même de nature en moins de deux décennies. On propose de retracer l’histoire de cette révolution autant culturelle que technique, en essayant de comprendre comment notre rapport avec l’espace géographique s’en trouve changé.

Un extrait de la carte OpenStreetMap ( [https:]] ). Cette carte collaborative, souvent comparée à Wikipédia, illustre certaines transformations dans la production et la diffusion des cartes à l’ère d’internet.
Que vous soyez curieux, amateur, passionné, ou connaisseur aguerri, ce cycle de conférences vous invite à explorer l’histoire et les enjeux actuels des cartes. Des premières représentations du monde aux révolutions du numérique, chaque séance sera l’occasion d’interroger le pouvoir des images cartographiques et leur impact sur notre perception de l’espace. Venez découvrir comment les cartes façonnent notre façon de voir le monde !
Programme – Histoire de la cartographie 2025Télécharger
-
sur Utiliser les applications cartographiques uMap et Framacarte
Publié: 13 February 2025, 5:23pm CET
uMap est un outil open source qui permet de créer des cartes personnalisées à partir de fonds OpenStreetMap (données en libre accès). Il est possible d'importer des données géographiques en masse au format geojson, gpx, kml, osm. La gestion des calques offre des possibilités de superposition des données. L'application ne propose pas d'animation cartographique. En revanche, elle permet de rassembler un grand nombre de ressources et de les consulter à travers une seule interface cartographique. Le code source ouvert d'uMap est disponible sur GitHub. L'outil, assez simple d'usage, est très utilisé dans le domaine de l'enseignement et de la formation. Il est également mobilisé par des associations ou des mouvements pour développer des sites de cartographie participative. Pour une prise en main par étape, voir le tutoriel Maîtriser uMap en 12 leçons.
1) uMap et Framacarte, deux applications open source de cartographie en ligne
Dérivé du logiciel libre uMap, Framacarte, permet de dessiner, marquer, colorier, annoter les fonds de carte d’OpenStreetMap. L'application fait partie de la série d'outils libres proposés par Framasoft. Framacarte permet d'exporter le code et d'insérer la carte sur son site web (voir ce tutoriel).
Les applications en ligne uMap et Framacarte ne remplacent pas les outils de traitement cartograhique, tels Khartis ou Magrit. Leur vocation n'est pas de manipuler de la donnée statistique, mais plutôt d'assembler des ressources géolocalisées et de permettre une navigation entre ces ressources (cartes, images, textes...). Lorsqu'elles sont scénarisées, ces ressources géolalisées peuvent donner lieu à une narration et déboucher sur des story maps. Il s'agit d'outils de géovisualisation plus que de traitement cartographique. Vous pouvez vous reporter à la rubrique Globes virtuels et applicatifs pour accéder à d'autres outils de géovisualisation. Framasoft a fait également une page pour présenter la cartographie libre à vélo.
Carte participative des bassines contestées en France (source : uMap)
Exemples d'applications :- Carte des bassines contestées en France
- Cartocrise - Culture française tu te meurs
- L'Ile de France en Bandes Dessinées
- Nantes à vélo par CartoCités
- La guerre civile en Syrie
2) Présenter ses ressources pédagogiques avec uMap
Jean-Christophe Fichet, professeur agrégé dans l’Académie de Normandie et formateur, montre comment utiliser uMap pour présenter géographiquement une large palette de ressources pédagogiques (films, textes…).
Cartes à l’appui depuis son site Cartolycée, son témoignage ouvre des perspectives aux enseignants pour s’approprier les sujets, aux élèves pour plonger dans des documents variés, et à tous ceux qui veulent faire vivre des documents sur des cartes.
Lire son interview sur le blog d'uMap.
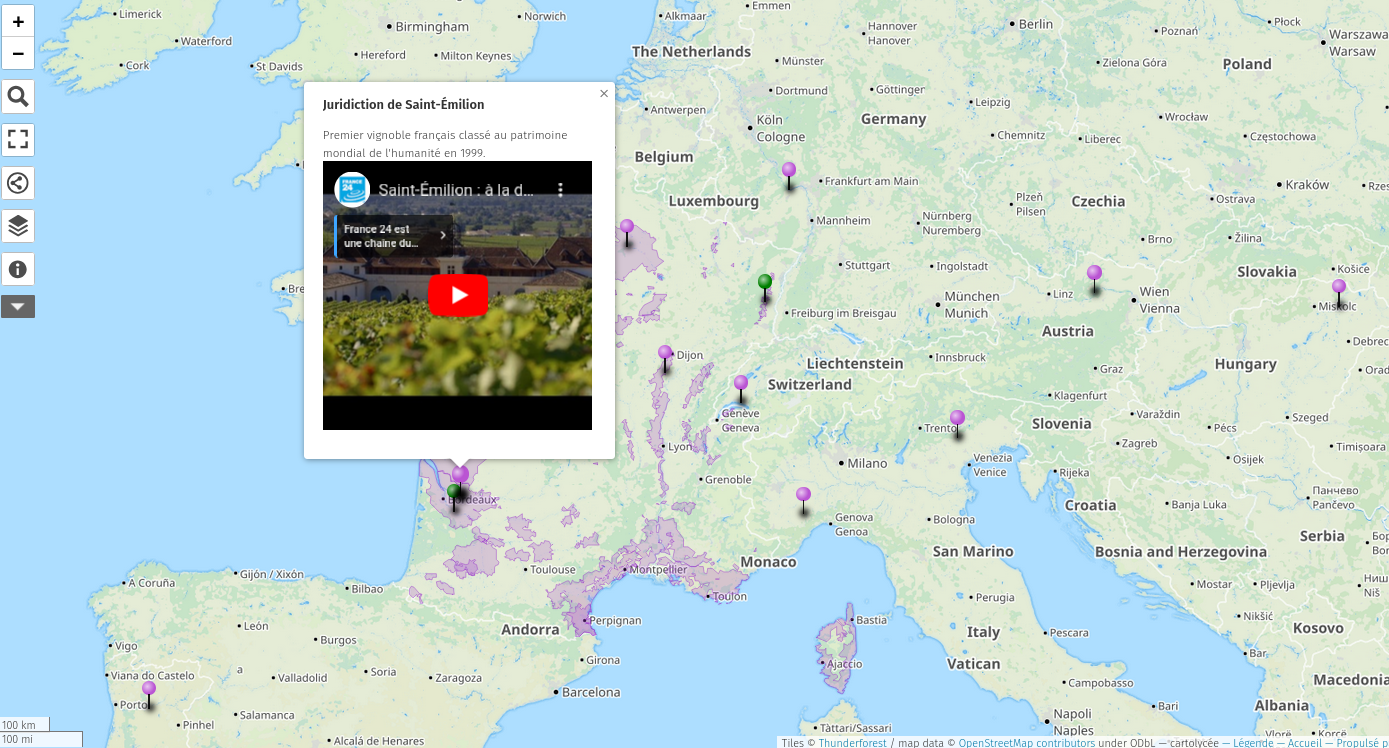
Exemples d'applications pédagogiques :- Carte de Lubrizol : Rouen face au risque technologique
- Carte de la Silicon Valley
- Carte des révoltes en musique
- Carte du goulag
Articles connexes
Utiliser Khartis dans le cadre de la géographie scolaire
Utiliser Magrit dans le cadre de la géographie scolaire
Les story maps : un outil de narration cartographique innovant ?
Travailler en équipe avec l'outil Ma carte de l'IGN
Utiliser la cartographie numérique pour travailler les compétences sur le croquis de synthèse
Globes virtuels et applicatifs -
sur Différences par sexe selon les pays dans l'utilisation des réseaux sociaux à partir des données Facebook
Publié: 13 February 2025, 3:27pm CET
Source : Cross-Gender Social Ties Around the World. Par Michael Bailey, Drew Johnston, Theresa Kuchler, Ayush Kumar, Johannes Stroebel (2025).Résumé
Les économistes, sociologues et autres spécialistes des sciences sociales s’intéressent depuis longtemps aux déterminants et aux effets des liens sociaux entre les sexes (par exemple, McPherson, Smith-Lovin et Cook, 2001 ; Currarini, Jackson et Pin, 2009). Cependant, en raison d’un manque de données représentatives et à grande échelle, les travaux empiriques ont généralement étudié les liens sociaux dans un seul contexte ou une seule zone géographique, empêchant une analyse systématique des variations spatiales ou autres, entre les sexes. Ici, est présenté et analyse un nouvel ensemble de données mondiales sur les "liens d’amitié" (followers) entre les sexes au niveau infranational pour près de 200 pays et territoires. Les mesures sont basées sur plus de 1,38 trillion de liens sociaux observés entre plus de 1,8 milliard d’utilisateurs sur Facebook, un service mondial de réseautage social en ligne. Les données agrégées sont disponibles en téléchargement sur le site HDX. Le but est de faciliter de nouvelles recherches visant à comprendre la dynamique qui façonne la formation des liens sociaux entre les sexes, ainsi que les effets de ces liens.
Cartes du ratio d'amitié entre les sexes parmi les 200 "meilleurs amis" (source : Bailey, Johnston & al, 2025)
Les auteurs ont mesuré les différences entre les sexes en utilisant le Cross-Gender Friending Ratio (CGFR), le rapport entre la part d'amies dans les réseaux d'hommes et la part d'amies dans les réseaux de femmes en fonction des lieux. Les hommes ont presque toujours une proportion plus faible d’amies féminines que les femmes, mais avec des degrés variés selon les pays. Dans tous les pays, le CGFR est un indicateur très prédictif des différences entre les sexes en termes de participation au marché du travail. Au sein des pays, on observe également une forte corrélation avec les attitudes liées au genre dans l'enquête World Values Survey, notamment les croyances sur l'aptitude des femmes à faire de la politique. Au delà des biais d'interprétation inhérents à ce type d'information, l'intérêt est de pouvoir les confronter avec d'autres jeux de données.
Accès aux données sur le site data.humdata.org
Accès à l'article sur le site de Drew Johnston
Articles connexes
Quand Facebook révèle nos liens de proximité
Ces pays qui bloquent les réseaux sociaux (Statista)
Territoires virtuels. Carte interactive des 400 000 projets déposés sur GitHub
Les modèles de langage (LLMs) utilisés en intelligence artificielle reproduisent l'espace et le temps
La carte mondiale de l'Internet selon Telegeography
L'essor parallèle de la Silicon Valley et d'Internet : du territoire au réseau et inversement
Géographies de l'exclusion numérique par Mark Graham et Martin Dittus
Cartographie du réseau social Mastodon
-
sur La stéréoscopie par satellite pour le suivi des ressources en eau ?
Publié: 12 February 2025, 3:16pm CET par Sylvain Ferrant
Dans les régions arides ou semi-arides, où l’irrigation est généralisée, le suivi de la ressource en eau agricole est primordial pour anticiper les pénuries. Cette ressource peut-être l’eau de grands barrages, de petits réservoirs ou provenant de l’aquifère. C’est le cas de l’état du Télangana, en Inde du Sud, où de nombreux grands barrages construits […]
-
sur Café géo de Montpellier, 6 mars 2025 : La tourismophobie. Du « tourisme de masse » au « surtourisme », avec Jean-Christophe Gay
Publié: 11 February 2025, 4:33pm CET par r.a.
Le Jeudi 6 mars à 18h, un café géo est organisé au Gazette Café à Montpellier (6 rue Levat, Montpellier).
Nous accueillerons Jean-Christophe GAY, Professeur a? l’universite? Co?te d’Azur, laboratoire Urmis sur le thème : La tourismophobie. Du « tourisme de masse » au « surtourisme ».

Au cœur de la tourismophobie, il y a la question de la masse et les strate?gies de distinction entre ceux qui s’autode?signent « voyageurs » et les touristes. La persistance de la re?pulsion a? leur endroit et la continuite? de cette obsession, alors que les touristes ne sont plus les me?mes, que leur nombre est infiniment plus e?leve? aujourd’hui qu’hier, que les pratiques ont radicalement change? et que les lieux se sont multiplie?s, sera questionne?e. Il s’agira de sortir de l’ombre cet invariant culturel, reposant notamment sur l’e?litisme ou la nostalgie, et de comprendre les ressorts de cette posture sociale qui a pris un tour nouveau avec le de?re?glement climatique.
-
sur Optimiser vos rasters et générer des mosaïques au format COG avec GDAL
Publié: 11 February 2025, 2:00pm CET
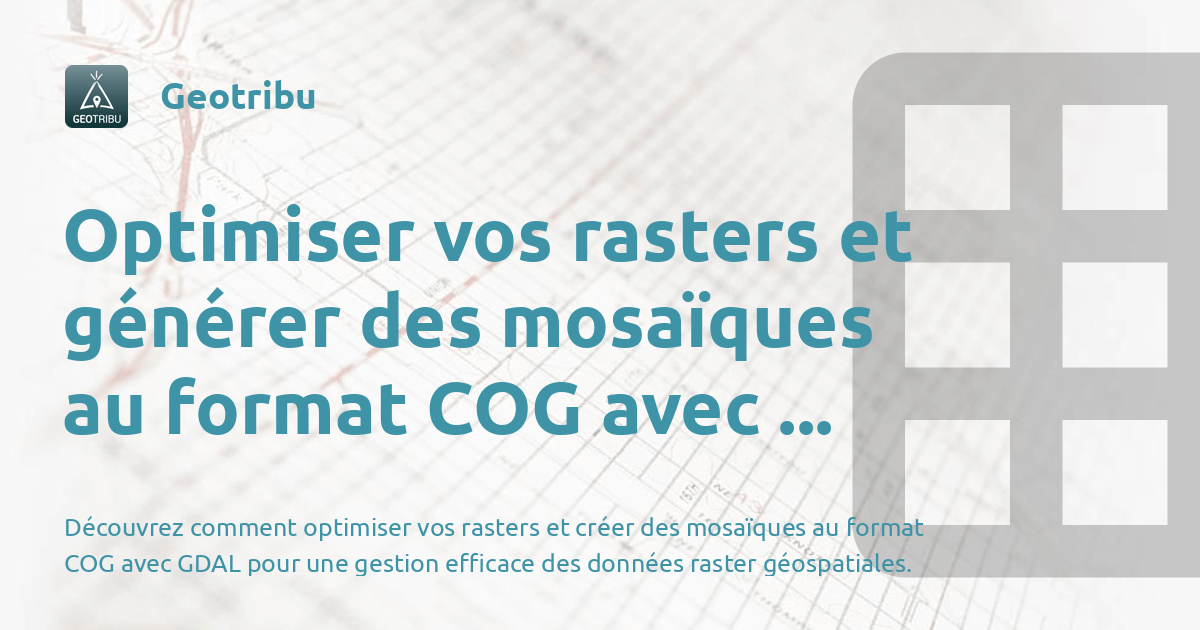 Découvrez comment optimiser vos rasters et créer des mosaïques au format COG avec GDAL pour une gestion efficace des données raster géospatiales.
Découvrez comment optimiser vos rasters et créer des mosaïques au format COG avec GDAL pour une gestion efficace des données raster géospatiales.
-
sur Café géo de Paris, lundi 10 mars 2025 : « L’Afghanistan, un trou noir entre les empires », avec Régis Koetschet
Publié: 11 February 2025, 10:48am CET par r.a.
Lundi 10 mars 2025, de 19h à 21h, Café de Flore, salle du premier étage, 172 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris
Ce café géo souhaite présenter la situation actuelle de l’Afghanistan sans négliger, bien sûr, les aspects plus anciens, notamment sur le plan géopolitique. Carrefour de civilisations, pays-témoin de la géopolitique, situé au cœur d’une région dont l’orientaliste René Grousset disait qu’on y entend les battements de cœur de l’Histoire universelle, l’Afghanistan se voit renvoyé à son malheur obscurantiste dont la situation faite aux femmes témoigne de manière révoltante. Pourtant, l’Afghanistan, en relation depuis un siècle avec la France, ne peut, du fait de sa centralité et de sa complexité, être dissocié des recompositions en cours entre Asie centrale et Moyen-Orient.
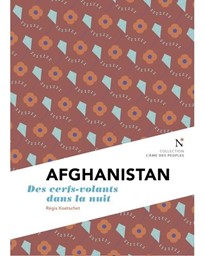
L’intervenant qui animera ce café géo, Régis Koetschet, a été ambassadeur de France à Kaboul entre 2005 et 2008. Il a publié aux Éditions Nevicata Afghanistan (2023) et L’Afghanistan en partage (2023). Il contribue régulièrement à la revue Les nouvelles d’Afghanistan. Il est également l’auteur de Diplomate dans l’Orient en crise, réédité en 2023 (Maisonneuve et Larose Hémisphères).
-
sur Calculez sur GPU avec Python – Partie 2/3
Publié: 11 February 2025, 10:38am CET par Gael Pegliasco
Dans cette partie, vous apprendrez à utiliser votre GPU avec les librairies CuPy et PyCUDA. Vous commencerez à comprendre dans quelles conditions un GPU est préférable à un CPU.
-
sur Vivre au bord de la mer
Publié: 10 February 2025, 2:49pm CET par r.a.
90% des échanges (en tonnage) à l’échelle mondiale se font par voie maritime et atterrissent donc dans un port souvent industrialisé en bord de mer. Plus de 60% de la pop. mondiale habite à moins de 100km de la côte. Ces deux chiffres clés légitiment l’intérêt pour les littoraux qui ont longtemps été des lieux autant rêvés qu’effrayants et répulsifs mais qui sont aujourd’hui des espaces intégrés, attractifs, convoités et stratégiques

A.Oiry(à droite) et M.Huvet-Martinet au Flore le 19/01/2025. Photo. JP.Némirowsky.
C’est devant un public nombreux que nous avons accueilli au Flore Annaig Oiry (A.O) pour nous faire « Vivre au bord de la mer ». Maître de conférences à l’Université Gustave Eiffel, Annaig Oiry, est l’auteur d’une thèse de géographie sur l’éolien en mer. Elle est rattachée au laboratoire « analyse comparée des pouvoirs » et travaille sur le déploiement des énergies marines renouvelables ainsi que sur les questions nucléaires notamment en Bretagne.
Qu’est-ce que le bord de mer, c’est-à-dire le littoral ?
La définition est plus complexe qu’il n’y parait à priori car elle fait référence à différents critères : géomorphologiques et écologiques, paysagers, juridico-administratifs, économiques. A.O propose une définition synthétique : Le littoral une Interface influencée par des forces physiques marines, reliée au milieu marin par ses ressources propres (halieutiques, énergétiques, paysagères), ses activités (pêche, agriculture littorale, industries extractives, tourisme balnéaire), ses pratiques, mais relevant toujours de logiques terrestres. Cette définition concernerait en France d’après la loi littoral 1212 communes dont 975 riveraines de la mer.
Les littoraux sont maintenant des espaces attractifs.
Espaces stratégiques de la mondialisation
Les littoraux sont les réceptacles des échanges maritimes et le reflet des hiérarchies mondiales. L’Asie participe à 62,4% du trafic portuaire mondial. On trouve 7 ports chinois dans les 10 principaux ports mondiaux de conteneurs, reléguant les ports européens et américains loin derrière (Rotterdam à la 10ème place, Anvers 13 ème, Hambourg 17ème Los-Angeles 18ème, New-York 20ème). Les premiers ports français du Havre et de Marseille n’apparaissent plus dans le classement.
L’Afrique est en marge malgré un léger rattrapage depuis les années récentes mais en 2021 les ports africains ne représentaient que 3,9 % du trafic mondial de conteneurs, signe d’une bien faible intégration à la mondialisation.
A proximité des flux de la mondialisation
Les littoraux attirent les activités économiques pour être proches des flux de la mondialisation.
L’exemple chinois est révélateur de l’intégration économique dans l’espace mondialisé qui s’affirme à partir de la mise en place du processus de libéralisation et d’ouverture à la fin des années 1970.
Le port de Yangshan, construit dans les années 2000 en eaux profondes pour désengorger Shanghai est un parfait exemple de littoralisation économique. Il peut traiter annuellement 750 millions de tonnes en vrac et 40 millions de conteneurs. On y accède par une autoroute sur piles de 32 km. Pas un docker à l’horizon : c’est un port « sans hommes » où toutes les opérations sont entièrement contrôlées et pilotées par les ordinateurs de la tour de contrôle.
Malgré tout, la littoralisation économique est inégale en Chine : certaines parties ne sont pas concernées et restent pourvoyeuses de main d’œuvre.Le littoral en Chine et la baie de Shenzhen
In A. Oiry, 2020. Les littoraux. D.P 8138, CNRS éd.A forte attractivité démographique
Depuis le milieu du XIXème siècle le littoral français est devenu attractif notamment grâce au développement du tourisme balnéaire. Entre 1962 et 2016 la population littorale métropolitaine a connu une augmentation de 42%. La densité y est de 265 hab/km2 pour une densité moyenne de 104 hab/km2. Cette attractivité est liée à des facteurs économiques mais aussi culturels avec le développement des loisirs. Ce dynamisme est cependant contrasté : sur le littoral guyanais la densité est de 5 hab/km2 contre 529 hab/km2 en Provence côte d’Azur.Accueillir les flux de la mondialisation présente des revers :
Il faut constamment agrandir les ports, approfondir les chenaux.
Il faut gérer la démolition des navires en fin de vie, supportée largement par les pays en voie de développement particulièrement le subcontinent indien et dans une moindre mesure la Chine et la Turquie. Ceci en liaison avec le faible coût de la main-d’œuvre et une moindre application des réglementations environnementales envers les matières toxiques et polluantes. Au Bengladesh les chantiers de démolition emploient plus de 30 000 ouvriers et contribuent à ravager le littoral.
Les marées noires sont des risques récurrents comme en atteste l’exemple du littoral breton avec la difficulté de stocker les déchets des multiples accidents (naufrages, avaries, pertes de carburant).Le stockage des déchets des marées noires en Bretagne
In A. Oiry, Atlas mondial des littoraux, 2023Il existe aussi des littoraux très en marge, très peu connectés aux flux mondiaux : ce qui n’est pas forcément un mal. A. O cite la région d’Aysen en Patagonie chilienne, le Cap Horn un « bout du monde » difficile d’accès.
Les littoraux peuvent aussi être des espaces en tension.
Certains présentent des inégalités à l’intégration différenciée dans les circuits de la mondialisation. A.O présente le cas de Tanger, reflet d’une croissance inégalitaire.
Certaines inégalités sont liées à l’attractivité démographique des littoraux. L’exemple de la Bretagne est significatif avec les problèmes posés par l’importance des résidences secondaires. 12% des logements sont des résidences secondaires et les 2/3 sont à moins de 2km du rivage. Les 2/3 des propriétaires de résidences secondaires ont plus de 60 ans. Certaines communes accueillent plus de résidents secondaires que permanents (Arzon dans le Morbihan : 77% de résidences secondaires en 2019 ; plus de 70% dans les iles bretonnes (iles aux Moines, Hoëdic, Bréhat, Molène). Dans ces conditions la vie quotidienne des « locaux » est rendue compliquée surtout pour se loger.A une échelle plus fine, la plage peut aussi être espace en tension. Ainsi l’organisation spatiale des plages de Rio de Janeiro (Brésil) obéit à des logiques de ségrégation et même d’exclusion de populations jugées indésirables.
Les littoraux peuvent aussi être le réceptacle de tensions géopolitiques comme les bords de la mer Noire. Dès le début de l’agression, les Russes ont cherché à bloquer l’exportation des productions agricoles et industrielles ukrainiennes et aussi à établir une continuité avec le littoral de la Crimée annexée et la mer d’Azov ; d’où l’importance de la position de Marioupol et pour l’armée ukrainienne les attaques sur le pont de Crimée.
Le littoral ukrainien au cœur du conflit avec la Russie

In A. Oiry. Atlas mondial des littoraux, 2023
Certains espaces maritimes et littoraux comme ceux de la Manche sont des zones de conflictualités en raison des difficultés à partager des espaces saturés d’activités : zones de pêche, d’extraction de granulats marins, de protection environnementale Natura 2000…
Rajouter une activité crée nécessairement des tensions ce qui s’est vu quand l’Etat a décidé de lancer ses parcs éoliens sur des espaces de travail. Ainsi les conflits se sont exacerbés dans la baie de Saint-Brieuc avec les pécheurs. Le parc éolien qui mord légèrement sur le gisement de coquilles St-Jacques, est finalement fonctionnel depuis 2024 malgré les contestions et manifestations tant des résidents secondaires que des pécheurs et des associations environnementales redoutant les impacts sur la zone Natura 2000.
Concurrence en mer dans la baie de Saint-Brieuc
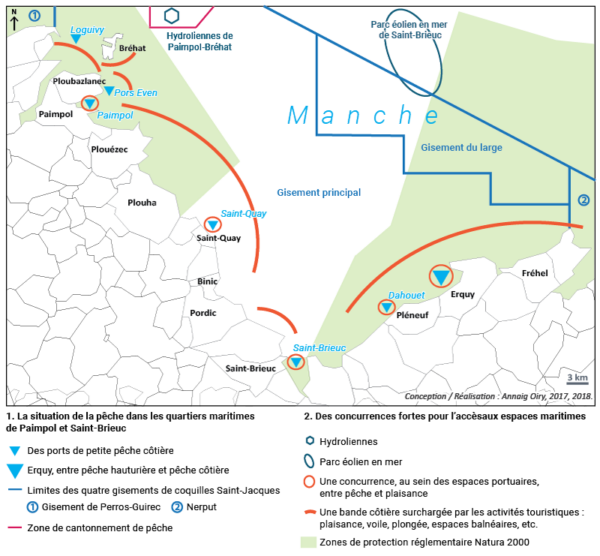
In OIRY A. Une transition énergétique sous tensions ? Contestations des énergies marines renouvelables et stratégies d’acceptabilité sur la façade atlantique française, Thèse en géographie, Université Paris 1, 2017.
Vivre au bord de la mer à l’heure du changement climatique.
Il est signalé que ce sujet a déjà été abordé aux cafés de géo ( [https:]] ).
A.O rappelle que les littoraux sont aux avant-postes des changements climatiques. Ils subissent l’élévation du niveau des mers (qui pourrait atteindre 110cm en 2100), l’exacerbation des risques de submersion-érosion, la multiplication d’évènements météorologiques extrêmes (tempêtes, cyclones) aggravés par les aménagements et l’artificialisation des bords de côtes en liaison avec l’urbanisation souvent importante.
Les techniques de défense et les dispositifs de lutte face aux risques ne sont pas toujours efficaces : endiguement, aménagement des dunes par végétalisation, rechargements de sables, pieux ne résistent pas toujours, notamment lors de tempêtes extrêmes comme Cynthia en Vendée (février 2010) ou la tempête Johanna en Bretagne (mars 2008).
La question se pose de savoir si, dans certains contextes territoriaux très précis de submersion/érosion forte, on devrait ne plus vivre en bord de mer. Certaines communes sont amenées à mettre en place des stratégies de repli en déclarant en péril certaines constructions et en les rasant ce qui est évidemment mal vu des populations locales.
Questions de la salle ont permis d’approfondir certains aspects.
Quels enjeux représentent les ZEE (Zones économiques exclusives) ?
Les ZEE ont été définies à la Conférence de Montego Bay (1982) et sont importantes pour l’exploitation des ressources halieutiques bien sûr mais aussi minières qui peuvent être aussi en haute mer hors ZEE sous juridiction internationale. Ce problème de l’exploitation des ressources mais aussi de leur protection et de la biodiversité, hors ZEE, a conduit à la signature en 2023 au siège de l’ONU d’un traité international pour la protection de la haute mer et de la biodiversité marine (BBNJ), ratifié par la France. Même si la haute mer est un bien commun de l’humanité, certaines organisations régionales de pêche sont actives dans ces zones, ce qui peut entrainer des tensions entre Etats.Peut-on parler d’hypertrophie ou de sous-utilisation de certaines installations portuaires notamment à Tanger ?
A propos de Tanger, ces cas ne se posent pas. Il peut arriver que les infrastructures portuaires soient surdimensionnées si les flux de la mondialisation n’arrivent pas ou n’arrivent plus ou si l’environnement a changé. A.O cite l’exemple de la construction dans le port de Brest, sur un polder, d’une usine d’assemblage des pièces d’éoliennes destinées au parc de St-Brieuc qui est maintenant en sous-utilisation. Cette usine cherche à récupérer des commandes au Royaume-Uni ou de futures commandes en Bretagne sud pour maintenir ses activités mais il s’agit d’activités occasionnelles.Câbles sous-marins ?
Il y en a en effet beaucoup. Ils sont de nature diverse et sont des infrastructures stratégiques. : grands câbles de télécommunication transatlantiques ou câbles plus locaux notamment pour relier les parcs éoliens au réseau électrique terrestre. Ceci conduit à interdire les zones de parcs éoliens à la pêche pour éviter d’endommager les câbles ce qui posera des problèmes quand le nombre de parcs va augmenter : il est question d’une cinquantaine de parcs éoliens en France prochainement.Littoral de Calais et les migrants ?
En effet ce littoral est marqué par les vagues migratoires qui se sont dispersées dans l’espace depuis Sangatte depuis plusieurs années en se déplaçant au rythme des expulsions et en liaison aussi avec l’action des associations et mouvements solidaires. Le port est totalement bunkerisé et fermé par des barbelés.Quelle est l’attitude des populations locales dans les zones littorales très touristiques ?
Il est certain qu’à St-Tropez ou à l’île de Ré l’été les flux touristiques sont très importants et sont problématiques. La tendance est d’essayer de la part des élus locaux ou des mouvements citoyens de réguler les flux pour éviter le surtourisme, ce qui n’est pas toujours possible. Par exemple l’île de Bréhat (Côtes d’Armor) a institué dans les périodes estivales les plus tendues des quotas journaliers pour traverser et accéder à l’île. De même les autorités cherchent à faciliter l’accès au logement des populations locales en essayant de réguler les locations temporaires ou en augmentant la taxe d’habitation des résidences secondaires.Pour en savoir plus :
A.Oiry, Atlas mondial des littoraux, éditions Autrement, 2023
A.Oiry, Les littoraux, documentation photographique n°8138, CNRS éditions, 2020.
Benjamin Keltz & Joëlle Bocel, Bretagne secondaire, une année au pays des volets fermés, éditions coin de la rue, 2023.
Collectif droit à la ville Douarnenez, Habiter une ville touristique, Vue sur mer pour les précaires, , éditions du commun, 2023
Compte-rendu rédigé par Micheline Huvet-Martinet, février 2025.
-
sur Quelle est la puissance des cartes ? (Arte)
Publié: 9 February 2025, 6:41pm CET
Quelle est la puissance des cartes ? (Arte, 42- La réponse à presque tout, 15 septembre 2024)« Combien de fois par jour dégainez-vous votre téléphone portable pour trouver votre chemin ? Et que voyez-vous à première vue sur l'écran ? A première vue, les cartes géographiques semblent neutres. A grande échelle, elle représentent les continents. A plus petite, notre environnement proche. Elles donnent à voir le monde tel qu'il est... enfin en principe. Les cartes racontent toujours une histoire. Elles sont de puissants narratifs. Et si les cartes n'étaient pas si neutres que cela ? Si elles avaient même le pouvoir de façonner notre vision du monde ? »
« Quelle est la puissance des cartes ? » (source : documentaire de la chaîne Arte)

Les cartes reflètent souvent un point de vue et sont un élément constitutif de l'identité des pays. L'émission propose de réfléchir à la puissance des cartes en interrogeant le choix de la projection, le choix du cadrage, mais aussi le tracé des frontières qui peut être artificiel (surtout lorsque les frontières sont tracées avant même de s'emparer du territoire). Sont abordés également les "silences cartographiques" par exemple dans Google Maps qui nous indique où nous garer ou faire du shopping, mais pas les lieux où l'on pourrait faire du skateboard ou encore là où l'on pourrait se poser sans avoir à consommer. Certains quartiers n'avaient tout simplement pas d'existence sur Google Maps et il a fallu des initiatives comme OpenStreetMap pour que la cartographie soit faite de manière participative C'est le cas par exemple du quartier de Kibera (200 000 habitants) dans la banlieue de Nairobi qui n'avait pas été cartographié dans Google Maps mais a pu trouver une existence dans OpenStreetMap grâce au projet communautaire open source Map Kibera. On peut citer également le travail de collecte de données et de cartographie humanitaire dans OSM lors du séisme de 2010 à Haïti.
Cartographie citoyenne émancipatrice (source : Map Kibera)
Ces contre-cartes ont le pouvoir de nous raconter une histoire alternative. Elles nous montrent qu'un autre monde existe. Trois groupes en particulier remettent en question le pouvoir des cartes : les pays du Sud global, les artistes et les cartographes critiques (voir par exemple cette carte du monde sans les Etats-Unis par les Surréalistes qui a inspiré l'artiste Greg Curnoe pour sa carte de l'Amérique du Nord). Comme il est rappelé dans l'émission, « les cartes sont l'expression de la diversité des regards sur le monde. La carte unique et neutre n'existe pas ».
Le monde au temps des Surréalistes - carte anonyme (source : Gallica)
Au total, la chaîne Arte propose là un bon documentaire pour prendre de la distance par rapport aux cartes qui ne sont jamais neutres. Elle montre que la puissance des cartes ne tient pas seulement au choix de la projection ou de l'orientation : les processus de sélection de l'information ou de concentration du pouvoir aboutissent à invisibiliser une partie du territoire (#BlancsDesCartes).
D'autres exemples pourraient être pris pour montrer tout à la fois la puissance et l'impuissance des cartes à restituer le réel. Ce n'est pas le moindre paradoxe de la cartographie que de mettre en visibilité tout en dérobant en même temps à notre regard une partie de l'information.
Articles connexes
La carte, objet éminemment politique. Cartographie radicale par Nepthys Zwer et Philippe Rekacewicz
La carte, objet éminemment politique : quand Trump dessine sa carte du monde
La carte, objet éminemment politique. Quels niveaux de soutien ou de critique vis à vis de la Chine ?
La carte, objet éminemment politique : les cartes de manifestations à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux
Le Blanc des cartes. Quand le vide s'éclaire (Atlas Autrement)
Cartographies actuelles. Enjeux esthétiques, épistémologiques et méthodologiques
Les nouvelles façons de « faire mentir les cartes » à l'ère numérique
Dire et changer le monde avec les cartes (émission "Nos Géographies" sur France-Culture)
-
sur Les Rencontres de la Cartographie. Faire de la carte un levier de conscience et de démocratie
Publié: 9 February 2025, 4:26pm CET
Les Rencontres de la Cartographie. Faire de la carte un levier de conscience et de démocratie
[https:]]Une coalition d’acteurs engagés - l’IGN, la Banque des Territoires, OVHcloud, CY école de design (CY Cergy Paris Université), le Conseil national de l'information géolocalisée (CNIG), la Fabrique de la Cité, Leonard (Groupe Vinci) - lance une initiative pour faire de la carte et de l’information géographique un levier de démocratie au service de nos territoires.

- Repenser notre rapport au monde
- Réorienter la puissance transformatrice de la cartographie
- Pour une nouvelle alliance cartographique
- Un appel à renforcer l’initiative
Articles connexes
Carte de répartition des risques naturels en France métropolitaine (IGN)
Travailler en équipe avec l'outil Ma carte de l'IGN
Cartographier l'anthropocène à l'ère de l'intelligence artificielle (IGN, 2024)
Cartes IGN, une application mobile pour comprendre le territoire et découvrir la France autrement
Lidar HD : vers une nouvelle cartographie 3D du territoire français (IGN)
La carte, objet éminemment politique : peut-on évaluer la qualité d'une démocratie ?
- Repenser notre rapport au monde
-
sur Blog SIG et IA générative : Quel intérêt?
Publié: 7 February 2025, 11:18pm CET par Florian Delahaye
L’intelligence artificielle est partout. ChatGPT par-ci, Gemini par-là, et bien d’autres technologies révolutionnent la création de contenus. Un prompt sur mesure vous permet de créer un plugin QGIS en 10 minutes. Un assistant vous guide de vive voix pour manipuler QGIS avec une retranscription textuelle immédiate. Alors cette génération de… Continuer à lire →
L’article Blog SIG et IA générative : Quel intérêt? est apparu en premier sur GEOMATICK.
-
sur 27-28 mai 2025 à Tours: les Ateliers Archéomatiques 25.2 – SIG – RSA « Représentation squelettique animale »
Publié: 6 February 2025, 1:53pm CET par archeomatic
Bonjour à tous ! Voici venu le temps de l’annonce des prochains Ateliers Archéomatiques qui auront lieu à la MSH Val de Loire à Tours et qui mêleront archéozoologie (une fois n’est pas coutume !) et notre cher logiciel QGIS. En effet Émeline Le Goff et Céline Bellimi nous présenterons un outil que dis-je… un […]
-
sur Travailler en équipe avec l'outil Ma carte de l'IGN
Publié: 5 February 2025, 10:54am CET
Depuis octobre 2024, l'application Ma carte de l'IGN permet à ses utilisateurs de travailler en équipe pour réaliser et diffuser des cartes sur Internet. Jean-Marc Viglino, ingénieur à l'IGN, propose un rapide retour d'expérience après 3 mois d'essai.
L'article montre l'intérêt de travailler en équipe ainsi que les étapes à suivre pour réaliser des cartes concues à plusieurs. Avec cette fonctionnalité, l'outil développé par l'IGN (Institut national de l'information géographique et forestière) offre de nouvelles perspectives pour la création de cartes au sein d'une organisation et permet de mettre en place une véritable chaine de rédaction afin de contrôler la publication de vos cartes en ligne.
Pour plus d'informations sur Ma carte :
- Modèles de conception pour Ma carte
- Comment travailler en équipe : mes premiers pas
- Le replay des Masterclass
- Demander au chatbot
- Les cartes de Mathieu Chartier (Atlas IGN Édugéo)
- Une storymap sur le cyclone Chido à Mayotte (J-M Viglino)
- Paris 2024 (Les JO vus d'en-haut)
- La carte de Cassini en haute résolution (Cassini-BNF)
- L’empire romain : comment romaniser les populations ? (Carto-lycée)
Articles connexes
Cartes IGN, une application mobile pour comprendre le territoire et découvrir la France autrement
Cartographier l'anthropocène à l'ère de l'intelligence artificielle (IGN, 2024)
Carte de répartition des risques naturels en France métropolitaine (IGN)
Depuis le 1er janvier 2021, l'IGN rend ses données libres et gratuites
L'IGN lance en 2024 un grand concours de cartographie à partir de la BD Topo
Vagabondage, un jeu de rôle à partir de cartes et de photographies aériennes de l'IGN
Lidar HD : vers une nouvelle cartographie 3D du territoire français (IGN)
L'histoire par les cartes : 30 cartes qui racontent l'histoire de la cartographie (sélection de l'IGN)
Utiliser les applications cartographiques uMap et Framacarte
-
sur BIM World | Jumeaux Numériques – 2 & 3 avril 2025
Publié: 5 February 2025, 8:38am CET par Caroline Chanlon

Oslandia sera présent les 2 & 3 avril à Paris Expo – Porte de Versailles sur le Hub open source Systematic pour présenter des projets comme Giros360, un jumeau numérique pour la Garonne réalisé avec EGIS pour le Grand Port Maritime de Bordeaux.
BIM World | Jumeaux Numériques est l’évènement de référence, entièrement consacré au numérique et à l’innovation pour les bâtiments, les infrastructures et les territoires.
Retrouvez Vincent Picavet et Bertrand Parpoil sur le stand pour échanger sur vos projets, découvrir nos dernières réalisations et nos composants OpenSource pour la 3D : Giro3D, Piero, py3Dtiles, CityForge.
Nous disposons d’invitations, n’hésitez pas à nous contacter infos@oslandia.com, nous vous enverrons le code promo.
Inscription à BIM World : [https:]]
-
sur Lofmyndir / Construire la carte 3D de l’Islande
Publié: 5 February 2025, 6:18am CET par Sébastien Guimmara
Pièce jointe: [télécharger]
Loftmyndir ehf. est une entreprise islandaise fournissant des données géospatiales pour l’Islande, telles que la photographie aérienne, les données LIDAR et les modèles de terrain. Elle propose également des cartes en ligne adaptées aux besoins spécifiques des municipalités islandaises.
Ce qu’Oslandia fournit à LoftmyndirOslandia aide Loftmyndir à construire la Carte 3D de l’Islande en utilisant des technologies web Open Source telles que Giro3D et Vue.js.
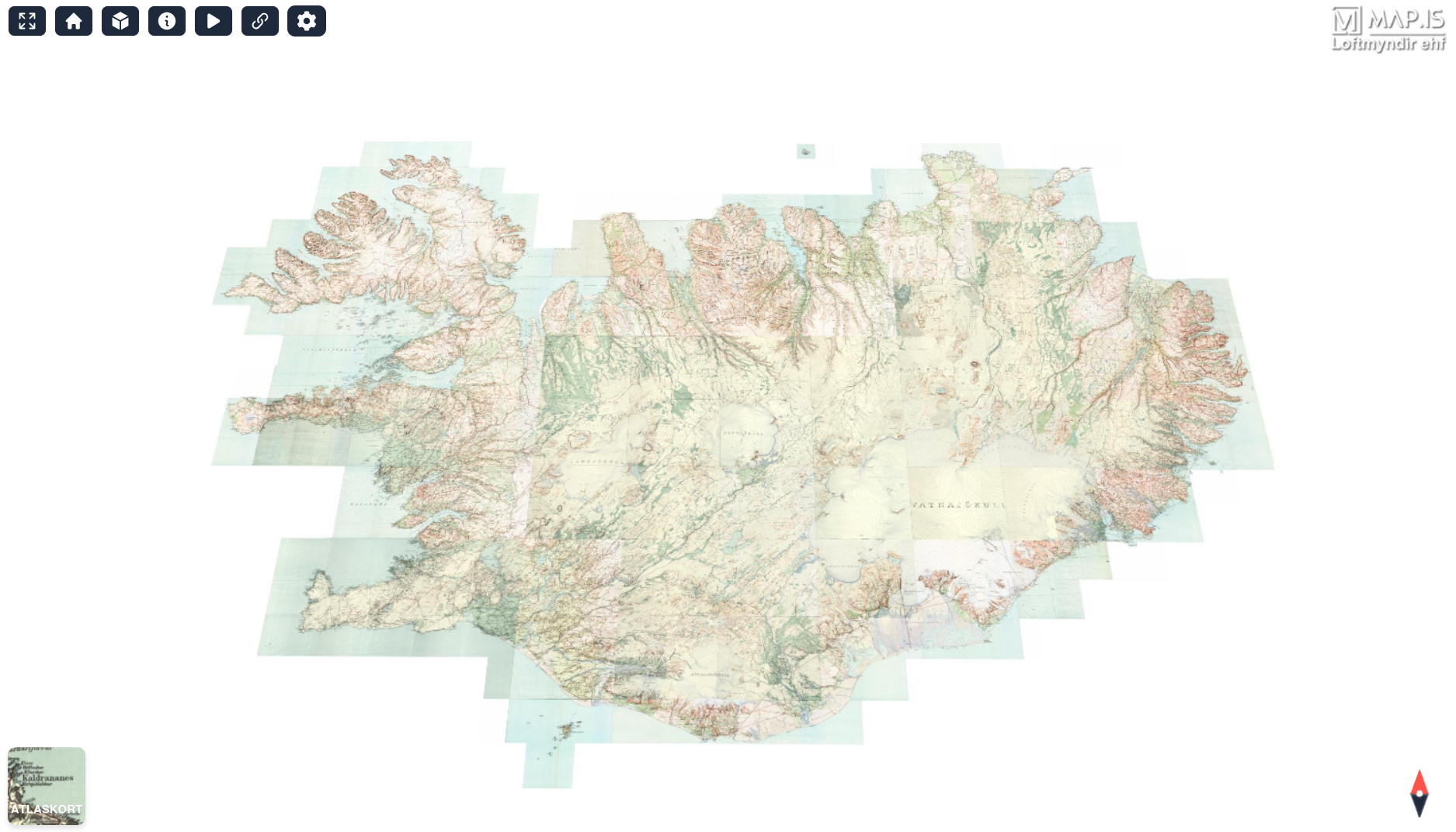 Loftmyndir – Carte 3D de l’Islande
Loftmyndir – Carte 3D de l’IslandeL’équipe de développement de Loftmyndir construit l’application avec l’aide d’Oslandia, lorsque l’expertise en visualisation 3D est nécessaire.
Les cartes 3D présentent des défis spécifiques, en termes de préparation des données, de performance et d’ergonomie. Par exemple, les environnements 3D sont moins intuitifs à naviguer et nécessitent une attention particulière pour aider l’utilisateur à se déplacer dans la dimension verticale. L’expertise d’Oslandia dans ce domaine peut vous aider à tirer parti de la valeur ajoutée par les données d’altitude dans les applications géospatiales.
Oslandia fournit une assistance dans les domaines suivants :
- préparation des données : conversion des rasters d’altitude en couches tuilées optimisées pour l’affichage web
- intégration de Giro3D dans l’application Vue.js
- implémentation de diverses fonctionnalités comme la navigation autour du terrain
- optimisation de Giro3D pour les plateformes mobiles
Galerie« Pendant des années, l’équipe de Loftmyndir a voulu développer une application de navigation web capable d’afficher toute l’Islande en 3D. Nous avions les données et des développeurs logiciels avec beaucoup d’expérience en SIG, mais il nous manquait une expertise 3D.
C’est là qu’Oslandia est intervenu.
Ce qui avait toujours semblé être une tâche intimidante s’est transformé en une expérience globalement agréable et éducative.
Les développeurs très compétents d’Oslandia ont toujours été rapides à répondre à nos questions, ce qui a abouti à un processus de développement rapide et à un projet de qualité dont nous sommes très fiers. »
Ressources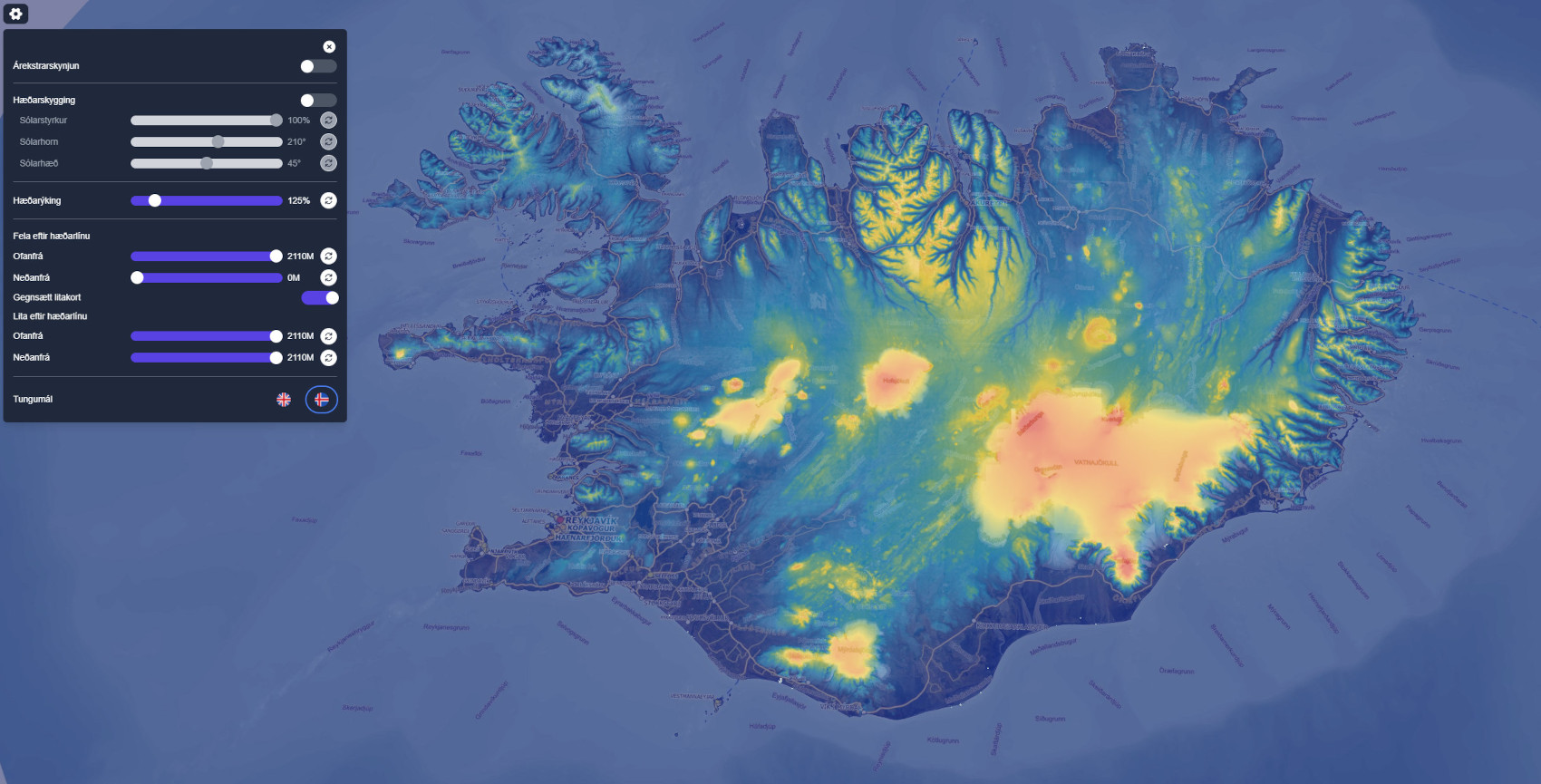 Loftmyndir / Terrain avec carte colorimétrique
Loftmyndir / Terrain avec carte colorimétrique 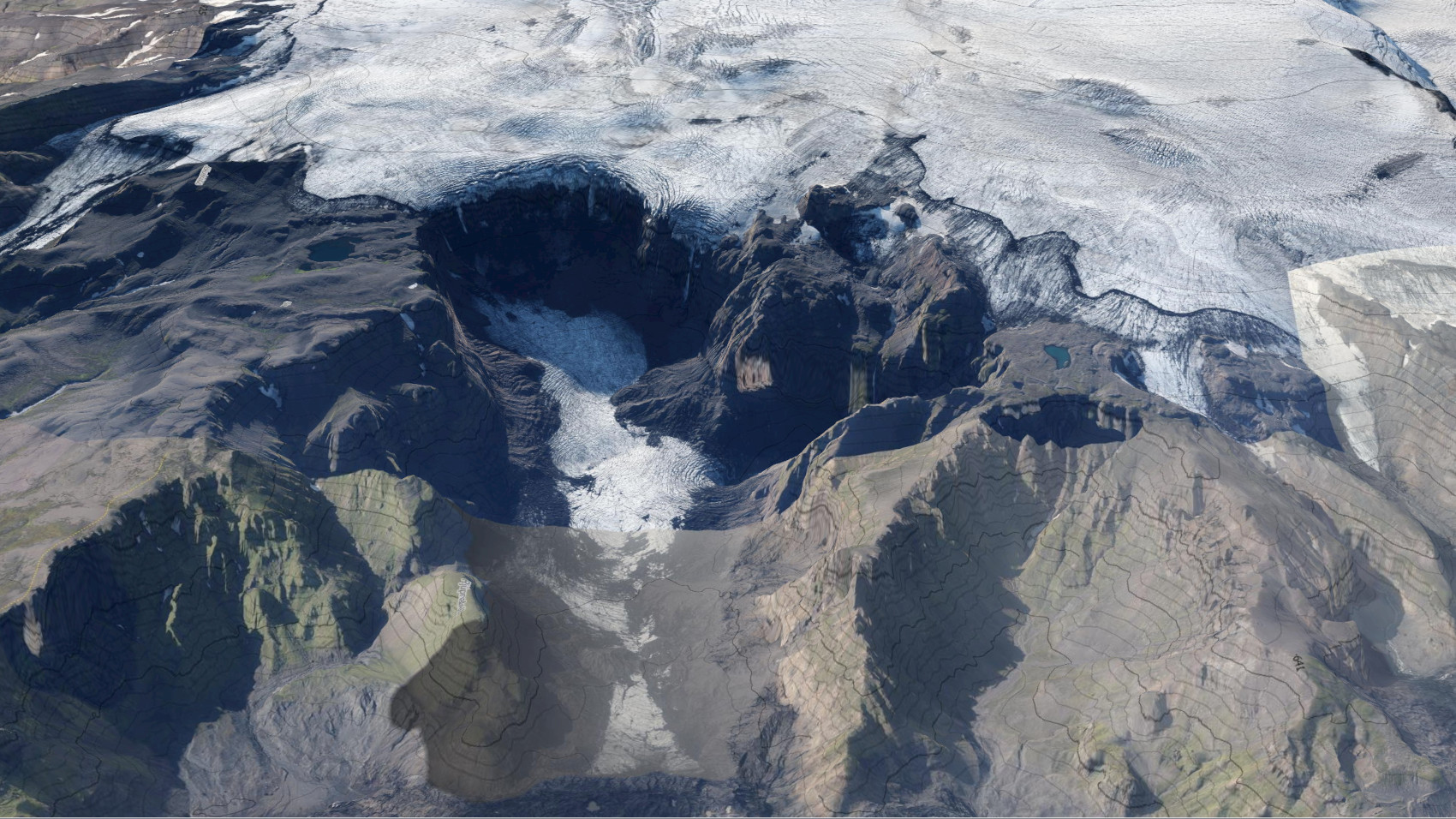 Loftmyndir / Le glacier Mýrdalsjökull
Loftmyndir / Le glacier Mýrdalsjökull 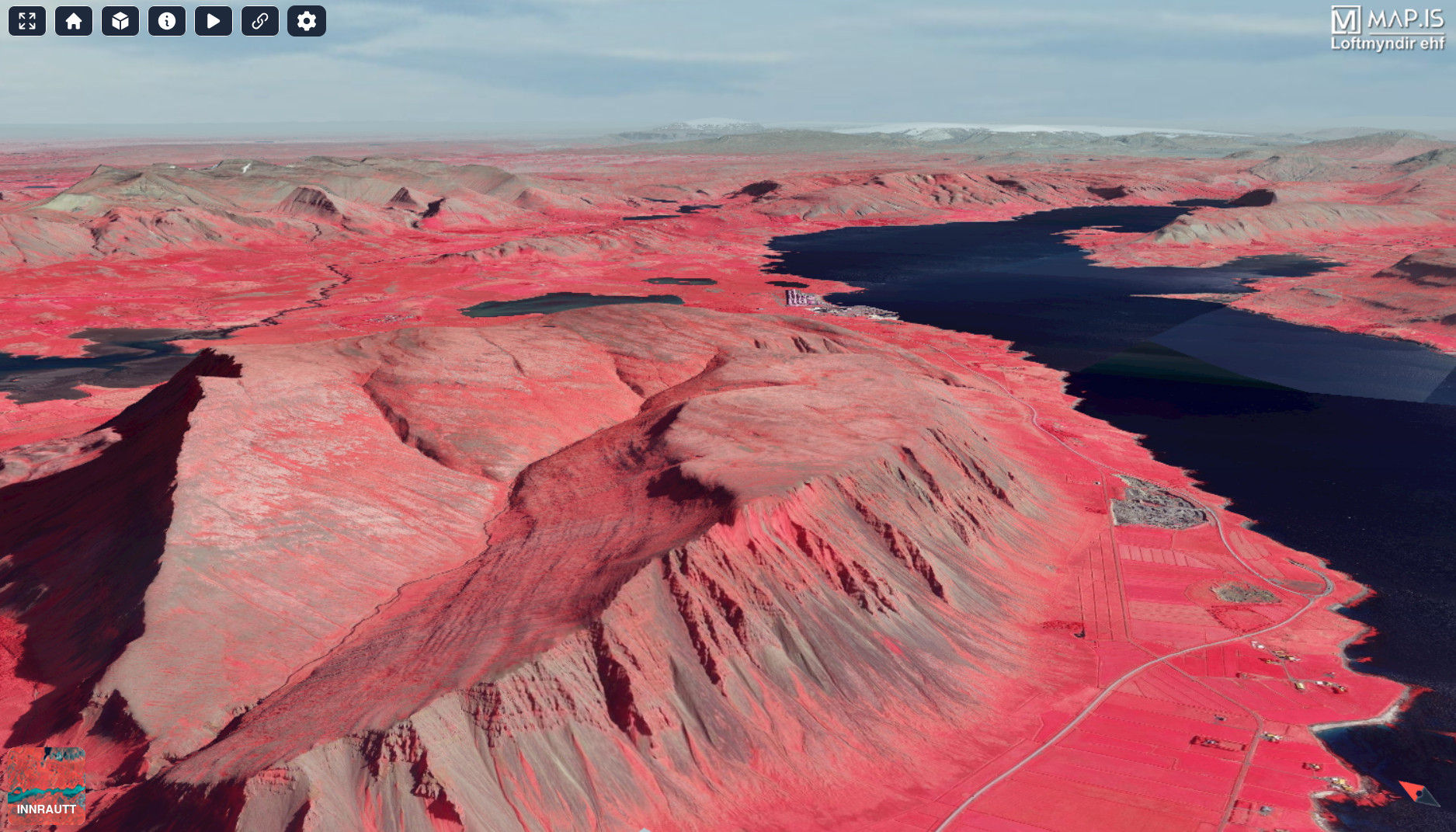 Loftmyndir / Orthoimage infrarouge
Loftmyndir / Orthoimage infrarouge 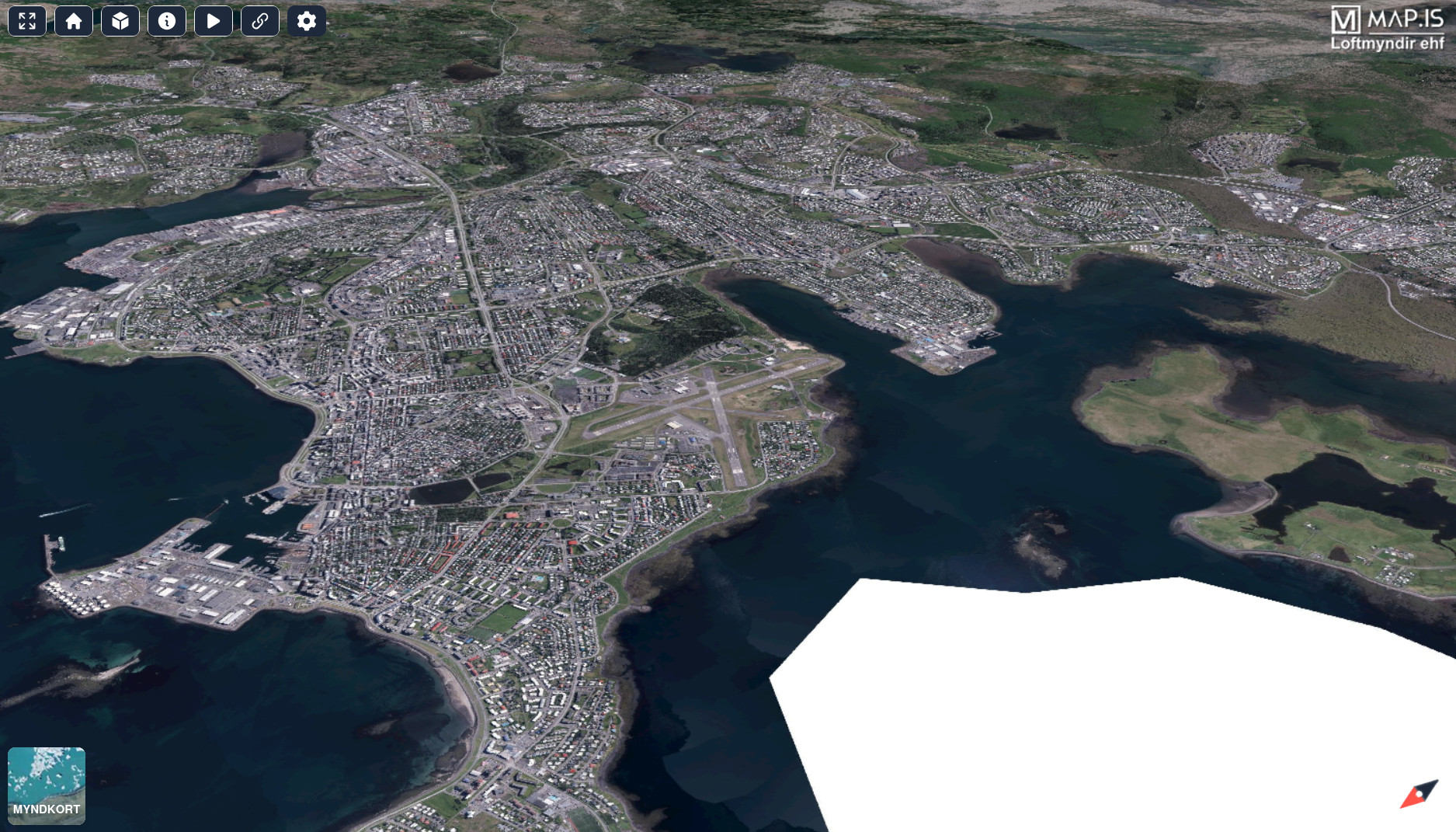 Loftmyndir / Zone urbaine de Reykjavik
Loftmyndir / Zone urbaine de Reykjavik 3d.map.is – La Carte 3D de l’Islande
3d.map.is – La Carte 3D de l’Islande giro3d.org – Le framework géospatial open source pour le web
giro3d.org – Le framework géospatial open source pour le web loftmyndir.is
loftmyndir.is
-
sur Atlas radical de Ferguson
Publié: 4 February 2025, 5:41pm CET
Ferguson, dans le Missouri, est devenue l'épicentre des tensions raciales aux États-Unis après le meurtre de Michael Brown en 2014 et les manifestations qui ont suivi. Bien que cette banlieue, située dans la périphérie de Saint-Louis, puisse ressembler à une ville moyenne du Midwest, l'activisme qui s'y est développé après le meurtre de Brown a mis en évidence comment les politiques de planification municipale ont conduit à la ségrégation raciale, à la fragmentation, à la pauvreté et au ciblage policier.
Patty Heyda, Radical Atlas of Ferguson, Belt Publishing, 2024.
En une 100e de cartes, Patty Heyda retrace les forces systémiques qui ont modelé Ferguson et, plus largement, les périphéries urbaines aux Etats-Unis. À travers un examen approfondi des contradictions qui sous-tendent l'urbanisme et la conception des villes, elle met en lumière la manière dont les incitations fiscales, les codes du logement, l'urbanisme, la police, la philanthropie et même l'aménagement paysager vont souvent à l'encontre de l'amélioration de la vie des résidents. Au cœur de cette réflexion se trouve une question clé : pour qui nos villes sont-elles construites ?L'Atlas radical de Ferguson se veut une profonde réflexion sur ce que peuvent être les cartes. Il invite les urbanistes, les designers et les citoyens ordinaires à changer leur regard sur l'espace public. « Ce que nous observons à Ferguson et dans le nord du comté se produit dans toutes les villes américaines. Les tendances sont seulement plus prononcées ici. ». Pour l'auteure, les cartes du livre sont destinées à mobiliser également les résidents et les militants.
Quand on observe effectivement l'environnement bâti de Ferguson, cela ressemble à un patchwork d'espaces ségrégés. En août 2014, dans les rues de Ferguson, dans le Missouri, des manifestants ont réclamé justice pour Michael Brown et la reconnaissance de décennies d’inégalités accumulées. Cette lutte – à la fois politique, économique, sociale et historique – a mis en lumière un autre obstacle structurel, assez surprenant : l’environnement bâti de Ferguson lui-même : « L’espace public est censé aider les gens à s’exprimer. Mais lorsque les politiques publiques cèdent la place à la richesse privée et à l’économie de marché, le résultat est fragmenté, ségrégué et toxique. »
Le terme "radical" vient du latin qui signifie racine. « Pour moi, un atlas radical peut revisiter des données que nous connaissons déjà – sur la démographie, la pauvreté ou les écarts d’espérance de vie, par exemple. Ou il peut présenter de nouvelles conclusions. Mais l’objectif d’une cartographie radicale est de nous aider à identifier les systèmes racinaires sous-jacents. Ainsi, à Ferguson, lorsque nous examinons la santé, nous examinons également la disponibilité des assurances et les types de restauration rapide. Lorsque nous examinons les taux d’asthme, nous examinons également les autoroutes, l’industrie et la déréglementation.
Patty Heyda est professeure agrégée d'architecture et d'urbanisme à l'Université Washington de Saint-Louis. Elle est co-auteure de Rebuilding the American City (Routledge).
Pour en savoir plus
« Ce que Ferguson révèle du racisme systémique aux États-Unis » par Charlotte Recoquillon (Géoconfluences).
« The infrastructure of fragmentation. Heyda’s "Radical Atlas of Ferguson USA" explores the built environment » (WashU).
« In Radical Atlas, 100 maps show the what and why of Ferguson » (St Louis Public Radio).
Articles connexes
La carte, objet éminemment politique. Cartographie radicale par Nepthys Zwer et Philippe Rekacewicz
Pour un spatio-féminisme. De l'espace à la carte (Nepthys Zwer)
La carte, objet éminemment politique : les cartes de manifestations à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux
Les ségrégations raciales aux Etats-Unis appréhendées en visualisation 3D et par la différence entre lieu de travail et lieu d'habitat
Présentation de l'Opportunity Atlas et des problèmes d'interprétation qu'il pose
La cartographie des opportunités dans les quartiers des grandes métropoles : un outil au service de la justice spatiale ?
Le « redlining » : retour sur une pratique cartographique discriminatoire qui a laissé des traces aux Etats-Unis
La suppression de la Racial Dot Map et la question sensible de la cartographie des données ethniques aux Etats-Unis
-
sur Calculez sur GPU avec Python - Partie 1/3
Publié: 4 February 2025, 9:09am CET par Gael Pegliasco
Cet article vous présente comment utiliser des GPU avec Python en passant par la présentation du choix du matériel jusqu’à sa mise en œuvre avec différentes librairies : Cupy, cuDF, xarray…
-
sur Audit QGIS / EPTB Eaux & Vilaine
Publié: 4 February 2025, 6:52am CET par Aurélie Bousquet

L’établissement public territorial de bassin (EPTB) Eaux & Vilaine porte et met en œuvre les politiques publiques de l’eau sur le bassin de la Vilaine, en répondant aux défis environnementaux de qualité de l’eau et de biodiversité. Pour appuyer le diagnostic et les politiques publiques qu’il mène, il s’est doté d’une base de données PostgreSQL – PostGIS partagée entre ses agents et déploie des instances du logiciel QGIS en interne.
Eaux & Vilaine a choisi de réaliser un audit portant sur l’organisation, l’administration, la production et l’utilisation de ses données géographiques et le déploiement de QGIS en interne à ses équipes.
Les enjeux de cette mission confiée à Oslandia portent sur la rationalisation de l’usage des bases partagées, l’amélioration de la politique de sauvegarde pour offrir des capacités de restauration partielle des données pour les utilisateurs et l’optimisation de la configuration de la base pour minimiser les travaux de maintenance et d’administration.
Dans une seconde phase, l’EPTB Eaux & Vilaine a demandé à Oslandia de le conseiller sur la politique de déploiement de QGIS à l’aide de l’outil QDT, en créant des profils d’utilisation distincts selon les différents usages observés.

-
sur Les quartiers de gare montpelliérains entre renouveau et intégration : regard croisé urbanisme-transport par Alexandre BRUN et Laurent CHAPELON (5 décembre 2024)
Publié: 3 February 2025, 8:45pm CET par r.a.
Alexandre Brun est Professeur de géographie à l’Université de Montpellier Paul-Valéry. Laurent Chapelon est Professeur en aménagement de l’espace et urbanisme à l’Université de Montpellier Paul-Valéry. Tous deux sont membres du Laboratoire de Géographie et d’Aménagement de Montpellier (LAGAM). Le 5 décembre 2024, ces deux enseignants-chercheurs ont présenté leurs travaux sur la place des deux gares montpelliéraines dans leurs tissus urbains respectifs, et leur accessibilité en transports collectifs urbains (réseau TaM), régionaux (TER) et nationaux (Intercités, TGV). La présentation s’intitule « Les quartiers de gare montpelliérains entre renouveau et intégration : regard croisé urbanisme-transport », dont un article a été publié dans la revue Géotransports en 2024 (numéro 22) avec Llewella Maléfant et Jean-Clément Ullès, doctorants au LAGAM.
Le paysage ferroviaire montpelliérain a récemment évolué avec la mise en service en 2018 de la gare exurbanisée Sud-de-France, en complément de la gare historique Saint-Roch. Depuis l’arrivée du TGV, les « doublets de gares » posent des défis d’intégration urbaine et de segmentation de l’offre ferroviaire. Les deux invités ont présenté les dynamiques urbaines contrastées des quartiers des deux gares, en mettant en lumière les enjeux et les défis liés à l’aménagement urbain porté par la Métropole et à l’organisation de l’offre ferroviaire.
1) La gare historique Saint-Roch : centralité et renouvellement urbain
La gare Saint-Roch, mise en service en 1845, occupe aujourd’hui une position centrale dans la ville de Montpellier. Initialement excentrée, elle a été intégrée au tissu urbain grâce à des projets d’urbanisation ambitieux, comme la création de la rue de Maguelone et du square Planchon, symboles de modernisation sous le Second Empire. Elle occupe une place également centrale dans la mobilité métropolitaine, régionale et nationale, avec une desserte assurée par quatre lignes de tramway, des TER, des Intercités et une partie des TGV.
Le quartier environnant, autrefois marqué par des friches industrielles et ferroviaires, connaît une profonde transformation avec le projet de la ZAC (Zone d’aménagement Concerté) Nouveau Saint-Roch. Sur 14 hectares, ce programme combine logements, bureaux, espaces verts et un parking, visant à rendre attractif le quartier dans une logique de mixité fonctionnelle. Le renouvellement urbain autour de la gare Saint-Roch illustre une dynamique attestée dans de nombreuses grandes agglomérations françaises. Ce processus s’inscrit dans une tendance à la standardisation des aménagements des quartiers de gare (souvent caractérisés par des équipements tels qu’un bâtiment emblématique conçu par un architecte renommé, un pôle d’échange multimodal, un hôtel 3 étoiles, ou encore un centre des congrès ou sportif, etc.).
2) La gare TGV Sud-de-France : le défi de l’intégration à Montpellier
Inaugurée en 2018, la gare TGV Sud-de-France est située en périphérie de Montpellier, ce qui lui vaut d’être qualifiée de gare « exurbanisée ». Son aménagement vise à optimiser les performances du réseau à grande vitesse (LGV), mais elle pâtit d’une intégration urbaine limitée. Cette gare se trouve déconnectée du centre-ville et repose sur une accessibilité routière, autoroutière et une navette de bus temporaire depuis/vers la station de tramway de la ligne 1 Place de France.
Le quartier de la gare Sud-de-France fait l’objet d’une ZAC baptisée Cambacérès, dont la programmation urbaine a longtemps demeuré instable. Initialement devant incarner un projet urbain novateur (vocabulaire de la Smart City) et écologique, à la mixité des fonctions urbaines (logements, bureaux, infrastructures de transport et de sport), force est de constater des modifications profondes par rapport au projet initial. Par exemple, aucun logement ne sera finalement construit au regard de la pollution générée par les deux autoroutes situées à proximité (Figure 1).
Figure 1 : Le projet d’urbanisation de la ZAC Cambacérès (situation actuelle)
3) Le doublet de gares : les enjeux de la segmentation de l’offre ferroviaire et de l’intégration urbaine
La gare Sud-de-France, dévolue uniquement aux TGV, accueille 40% des TGV desservant Montpellier, le reste étant maintenu à Saint-Roch (en plus de l’ensemble des TER et des Intercités). Cette répartition entraîne une fragmentation de l’offre ferroviaire, obligeant les voyageurs à composer avec des correspondances pénalisantes entre TGV et TER lorsqu’il est nécessaire de se déplacer d’une gare à l’autre (augmentation du temps de déplacement, utilisation des transports collectifs urbains, nécessité de se déplacer avec une valise, etc.).
Alors que la gare Saint-Roch bénéficie d’une intermodalité optimale grâce à la convergence de quatre lignes de tramway, Sud-de-France reste faiblement connectée aux transports collectifs urbains. Son accès repose sur une navette temporaire reliant une station de tramway, en attendant le prolongement de la ligne 1 prévu en octobre 2025 et, plus tard, le réseau de Bustram (Bus à Haut Niveau de Service). L’aire maximale accessible en 30 minutes pendant une journée type depuis les deux gares, en termes de surfaces desservies par les transports collectifs montpelliérains, met en évidence des différences notables, illustrant l’éloignement de la gare Sud-de-France du centre urbain (Figure 2).
Figure 2 : Aires maximales accessibles en transports collectifs en 30 minutes depuis chacune des deux gares de Montpellier
4) Conclusion :
L’exemple de la gare Saint-Roch montre qu’il faut plusieurs décennies pour qu’une gare s’intègre pleinement à son tissu urbain. En revanche, le quartier de la gare Sud-de-France, majoritairement consacré aux activités tertiaires, demeure en périphérie et peu intégré. Avec un sillon LGV situé à moins de 4 km du centre-ville, contrairement à d’autres gares TGV françaises (comme la gare TGV Nîmes Pont-du-Gard à 14 km de Nîmes), Sud-de-France bénéficie déjà d’une connexion au tissu métropolitain. Alexandre Brun souligne que la gare Sud-de-France, bien que mal connectée au centre-ville, semble s’être imposée, presque involontairement, comme la gare des habitants des périphéries montpelliéraines. Le manque d’anticipation des pouvoirs publics pour la desserte en transports collectifs urbains de la gare Sud-de-France se traduit par des temps de rabattement prolongés vers le centre-ville et une multiplication des ruptures de charge entre les modes de déplacement. Laurent Chapelon désigne cette difficulté comme une « limite des doublets de gares métropolitains ». Finalement, Montpellier dispose de deux gares aux fonctions différenciées, adaptées à des publics distincts et à des infrastructures spécifiques, reflétant une complémentarité partielle dans leur usage.
5) Échanges avec le public
Une question sur le risque d’inondation dû à la montée du niveau de la mer
Alexandre Brun : Les gares (Saint-Roch et Sud-de-France) sont à l’abri des inondations par submersion marine, même avec l’élévation du niveau de la mer d’ici 2100. La gare Sud-de-France est située suffisamment loin de la mer et en hauteur. Les enjeux liés à cette gare sont plutôt économiques, commerciaux et écologiques, car sa construction et la périurbanisation qu’elle génère vont à l’encontre des objectifs des outils de planification comme le PLU et le SCOT.
Une question sur l’augmentation possible des services de fret ferroviaire grâce à la création de Sud-de-France
Laurent Chapelon : Le fret ferroviaire reste en difficulté partout en France, notamment à cause de la concurrence de la route qui permet le transport de porte à porte. Le report d’une partie des TGV et des trains de fret sur le contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier a permis de libérer des sillons sur la ligne classique au profit du TER. Il est à noter que la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan devrait se caractériser également par une voie mixte voyageurs/fret qui laisse la porte ouverte au développement du fret ferroviaire sur l’arc méditerranée, en contrepartie d’un coût plus élevé de construction (cette ligne a un coût estimé à 6 milliards d’euros).
Une question sur l’impact potentiel de l’aménagement du quartier Sud-de-France sur le quartier Saint-Roch
Alexandre Brun : Il n’y a pas d’impact significatif immédiat sur Saint-Roch. Le renouvellement urbain de ce quartier a été réussi, avec un retour du commerce qui stimule l’urbanité. En revanche, le quartier Cambacérès, autour de Sud-de-France, est exclusivement dédié au tertiaire, sans logements prévus. Alexandre Brun exprime des doutes sur la capacité de Montpellier à absorber autant de constructions de bureaux sans d’abord attirer les entreprises.
Laurent Chapelon met en avant des résultats de recherches scientifiques montrant que les entreprises ne s’implantent pas dans les nouveaux quartiers de gare pour l’infrastructure de transport, mais surtout pour la disponibilité d’espaces de bureaux. Il y a souvent un décalage entre les équipements de transport et leur connexion au tissu économique local.
Une question sur l’évolution du trafic dans les gares Saint-Roch et Sud-de-France
Laurent Chapelon : La fréquentation de Sud-de-France augmente, mais c’est une croissance artificielle, car les voyageurs sont contraints d’utiliser cette gare. Les taux de remplissage des TGV sont optimisés par les ajustements tarifaires des opérateurs ferroviaires (yield management). À Saint-Roch, le trafic TER s’intensifie grâce à des cadences améliorées, rendues possibles par la libération de sillons consécutive à l’ouverture de la gare Sud-de-France et du contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier. Alexandre Brun souligne l’absence de connexion entre l’aéroport de Montpellier et les autres infrastructures de transport. Cette lacune entrave l’intégration de l’aéroport dans le réseau de transport urbain.
Une dernière question sur les raisons pour lesquelles il n’y a pas de logements sociaux dans le quartier Cambacérès
Alexandre Brun : Initialement, la ZAC Cambacérès (anciennement ZAC Oz) devait inclure des logements pour équilibrer la programmation urbaine. Cependant, les nuisances sonores et la pollution (proximité des autoroutes) rendent la construction de logements impossible.
Prise de notes et compte-rendu : LLewella Maléfant et Jean-Clément Ullès, doctorants au LAGAM, Université Paul-Valéry Montpellier 3.
-
sur Intervention de Matthieu Noucher Le blanc des cartes : quand le vide s’éclaire
Publié: 3 February 2025, 8:28pm CET par r.a.
InformationsDétails de l’intervention
- Date : Mercredi 20 novembre 2024
- Intervenant : Matthieu Noucher
- Titre : Le blanc des cartes, quand le vide s’éclaire
- Rédactrice : Sarah Traoré
Présentation du géographe et de ses spécialités
Matthieu Noucher est géographe, spécialiste des systèmes d’information géographique (SIG). Docteur en sciences de l’information géographique, il exerce comme chercheur au CNRS au sein du laboratoire PASSAGES à Bordeaux. Ses travaux s’intéressent particulièrement aux dimensions politiques et sociales des usages de la cartographie et des technologies numériques. En parallèle, il est directeur-adjoint du GdR MAGIS, réseau français de recherche en géomatique et chercheur associé au CRDIG de l’Université Laval à Québec.
Synthèse du sujetLe « blanc des cartes », loin d’être un simple vide, se révèle être un outil puissant, tantôt de protestation, tantôt d’omission stratégique. À travers divers exemples et en s’appuyant sur l’ouvrage qu’il a publié avec Sylvain Genevois (Université de La Réunion) et Xemartin Laborde (journal Le Monde) aux éditions Autrement, Matthieu Noucher a démontré comment ces zones peuvent simultanément dissimuler et éclairer des enjeux locaux et globaux. Dans un contexte marqué par une saturation d’informations, ces « fuites cartographiques » ne se contentent pas de refléter les dynamiques sociales, politiques et environnementales : elles les modèlent et les instrumentalisent, tout en s’affirmant parfois aussi comme une forme de résistance et de contestation.
InterventionIntroduction
La cartographie est souvent perçue comme un outil neutre et objectif. Cependant, Matthieu Noucher invite à déconstruire cette vision en explorant les « blancs » des cartes, espaces où silence et omission racontent une autre histoire. Ces zones vides, intentionnelles ou accidentelles, dévoilent des enjeux sociopolitiques complexes. À travers une approche critique, l’intervenant analyse le pouvoir symbolique des blancs des cartes et les tensions qu’elles révèlent
1. Cartographie critique : concepts et enjeux
La cartographie critique repose sur une remise en question des cartes en tant qu’outils objectifs de représentation. S’inscrivant dans la continuité de chercheurs tels que Brian Harley ou Jeremy Crampton, Matthieu Noucher analyse comment les cartes simplifient ou déforment la réalité en favorisant une perspective « vue d’en haut ». Il met alors Brian Harley : Il met en lumière leur rôle idéologique et les intérêts politiques ou économiques qu’elles peuvent servir. En s’inspirant des travaux de James Scott (Seeing Like a State), il explore notamment, comment les États-nations utilisent (non sans échec) les cartes pour imposer une lecture surplombante des territoires, marginalisant les réalités locales.
Dans ces travaux les plus récents, Matthieu Noucher mobilise les « blancs » des cartes comme focale d’analyse. Ces zones, loin de ne pouvoir être réduites qu’à des absences d’information, peuvent parfois (souvent ?) traduire des stratégies délibérées qui peuvent être multiples : de la protection d’informations sensibles à l’Iinvisibilisation de populations ou d’enjeux environnementaux.2. Exemple de la Guyane : entre invisibilisation et contestation cartographique
La Guyane française illustre parfaitement les dynamiques de « blanchiment » cartographique. Ce territoire, marqué par des conflits de territoires nombreux, offre un exemple éloquent de la manière dont les cartes participent à des stratégies de pouvoir.
- Effacement des populations autochtones : Les cartes historiques de la Guyane, bien qu’exceptionnelles en termes de détails topographiques, omettaient progressivement les populations locales. Ce processus reflétait une volonté de promouvoir la colonisation en invisibilisant les réalités humaines. La cartographie a ainsi pleinement contribué au mythe de la terra nullius.
- Données insuffisantes ou erronées : Malgré les référentiels nationaux de l’IGN, les cartes actuelles de la Guyane présentent encore des lacunes. Les transitions d’échelles (1/50 000 à 1/25 000) sont mal réalisées, et certains cours d’eau sont représentés de manière incohérente. Cette imprécision entrave le diagnostic et la planification des projets d’aménagement.
- Les mythes cartographiques et les « fake maps » : Certaines cartes historiques incluent des éléments fictifs, tels que des montagnes imaginaires, résultats d’erreurs ou d’un manque de vérification sur le terrain. Ces mythes perdurent parfois sous forme de « fake maps », révélant la fragilité des données géographiques numériques actuelles.
- Cartographie participative : une alternative critique : Pour pallier les insuffisances des cartes officielles, des initiatives participatives comme OpenStreetMap se développent. Ces approches, basées en partie sur des observations directes, impliquent les communautés locales dans la collecte et l’analyse des données. Elles n’en sont pas moins des initiatives qui restent soumises à des jeux de pouvoir qui méritent d’être déconstruits. Résultat : une lecture plus nuancée des réalités locales, qui remet en question les cartes institutionnelles et valorise les savoirs locaux.
3. Le blanc des cartes comme outil d’analyse
En reprenant la ligne éditoriale de l’ouvrage publié avec Xemartin Laborde et Sylvain Genevois (Blanc des cartes. Quand le vide s’éclaire), Matthieu Noucher explore les multiples dimensions du « blanc des cartes », illustrant comment ces espaces vides enrichissent notre compréhension des dynamiques spatiales.
- Un déluge de données inégalement réparties
Les grandes bases de données géographiques, comme Google Street View ou Seabed 2030, ne couvrent pas uniformément tous les territoires. Ces disparités reflètent des priorités politiques et économiques, laissant certaines régions marginalisées et leurs populations privées d’un capital informationnel équitable. La collecte de données de terrain, bien que cruciale pour appréhender les réalités locales, est souvent négligée faute de financements adéquats.
- Faire parler les silences cartographiques
Les « silences » des cartes révèlent des inégalités. Par exemple, l’absence de données sur les inégalités domestiques dans certains pays soulève des interrogations sur les mécanismes qui sous-tendent ces lacunes. Ces silences peuvent découler d’un manque de collecte, de choix politiques ou d’une rétention d’information délibérée. Ils invitent ainsi à questionner les intentions derrière ces absences.
- Représenter et interpréter le vide
Certaines cartes, comme celles représentant les zones éclairées la nuit, présentent des « vides » qui, en réalité, recouvrent des situations complexes (infrastructures non résidentielles telles que des stades éclairés sans habitants, autoroutes désertes ou territoires sous-développés). Ces vides nécessitent des analyses approfondies pour éviter des interprétations erronées.
- Révéler ou masquer le blanc
En Guyane, des cartographies militantes (issues de collectifs autochtones, d’ONG, etc.) mettent en lumière les enjeux liés à l’extractivisme minier et au pillage des savoirs traditionnels. Ces cartes alternatives viennent combler le blanc de cartes et servent à contester les représentations officielles et à défendre les droits des communautés marginalisées.
4. Applications militantes : la contre-cartographie
Le mouvement de contre-cartographie mobilise des expertises variées (scientifiques, artistiques, militantes) pour produire des cartes alternatives, avec trois objectifs majeurs :
- Fédérer des luttes territoriales : Les ZAD (Zones à Défendre), comme celle de Notre-Dame-des-Landes, utilisent des cartes pour illustrer l’impact des grands projets d’aménagement et fédérer les oppositions locales. De même, le mouvement contre les lignes à grande vitesse (LGV) Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax mobilise la cartographie pour visualiser les implications sociales et environnementales des projets..
- Produire des diagnostics opposables : À Notre-Dame-des-Landes, des écologues ont réalisé des diagnostics environnementaux alternatifs pour contester les études officielles, en s’appuyant sur des cartes et des données détaillées. Ces cartes deviennent parfois des références officielles, qui donnent une crédibilité scientifique et juridique à ces contre-expertises.
- Sensibiliser le public : En médiatisant ces cartes, ces mouvements permettent une meilleure compréhension des enjeux liés à la manipulation ou au biais des données géographiques. Ces initiatives illustrent également une dimension sensible, où la collaboration entre militants, scientifiques et artistes contribue à créer des outils puissants, à la fois juridiques, politiques et culturels.
Un autre volet de la contre-cartographie consiste à s’opposer directement à des cartes existantes, qu’elles soient à vocation juridique ou officielle, en mettant en lumière leurs biais ou leurs omissions.
5. Les implications politiques et éthiques
Les questions soulevées lors de la discussion ont permis d’approfondir plusieurs dimensions des enjeux politiques et éthiques liés à la cartographie :
- Formation et appropriation des données : La cartographie participative, en formant des jeunes locaux, joue un rôle clé dans la démocratisation de l’accès et de l’usage des données géographiques. Ces jeunes, une fois formés, peuvent à leur tour devenir formateurs, renforçant ainsi un modèle de transmission locale et durable. Cependant, cette démarche nécessite un soutien institutionnel fort, notamment par la création d’établissements dédiés, avec des locaux, des équipements et une gouvernance inclusive intégrant des représentants de chaque ethnie.
- Réception institutionnelle : Les initiatives de contre-cartographie suscitent des réactions variées, allant de l’indifférence à des collaborations prometteuses. En Guyane, par exemple, une convention de recherche a été signée pour cartographier les sites d’orpaillage et les territoires autochtones. Pourtant, malgré ces engagements, les réalisations concrètes demeurent partielles, révélant des tensions entre les ambitions affichées et les moyens alloués..
- Le droit à l’opacité : En s’inspirant d’Édouard Glissant (Introduction à une poétique du divers, 1996, Gallimard, p. 71), Matthieu Noucher souligne que certains « blancs » doivent être préservés. Cela s’applique notamment en contexte de conflit, comme en Ukraine, où l’incertitude des données peut protéger les populations en maintenant une part de brouillard stratégique. Cette perspective invite à ne pas chercher systématiquement à combler tous les vides, mais à réfléchir aux implications de leur révélation.
Ces réflexions enrichissent le rapport à la propriété des données et soulignent les multiples facettes – politiques, éthiques et stratégiques – de la cartographie contemporaine.
Conclusion
L’intervention de Matthieu Noucher démontre que les cartes ne sont jamais neutres. Les « blancs » qu’elles contiennent, loin d’être de simples absences, sont porteurs de significations profondes. Ces espaces vides interrogent sur les dynamiques de pouvoir, les choix méthodologiques et les enjeux éthiques de la représentation spatiale.
Pour aller plus loin
Ces réflexions rejoignent les tensions entre le visible et l’invisible dans la représentation des territoires. Certaines zones, perçues comme des opportunités d’exploitation par des acteurs externes, sont parfois considérées par les communautés locales comme des espaces à préserver en raison de leur valeur culturelle, spirituelle ou symbolique. Ce décalage souligne la nécessité d’une approche respectueuse des perceptions et des pratiques locales.
En repensant la manière dont nous produisons, analysons et utilisons les cartes, la cartographie critique ouvre la voie à une compréhension plus nuancée et inclusive des territoires. Elle invite également à diversifier les études sur les zones floues et incertaines pour appréhender ces espaces avec des perspectives variées, évitant ainsi la réutilisation mécanique de chiffres ou de discours figés dans les débats publics.Ouvrages de Matthieu Noucher
- Le blanc des cartes, quand le vide s’éclaire (Sylvain Genevois, Matthieu Noucher, Xemartin Laborde, éditions Autrement, Mai 2024).
- Aperçu : [patiencesgeographiques.org]
- Blancs des cartes et boîtes noires algorithmiques (Édition CNRS, 2023, 408 p.).
- Disponible en libre-accès : [https:]]
- Atlas Critique de la Guyane (sous la direction de Matthieu Noucher et Laurent Polidori, Éditions CNRS, 2020, 330 p.).
- Aperçu : [patiencesgeographiques.org]
- Les petites cartes du web : Approche critique des nouvelles fabriques cartographiques (Éditions Rue d’Ulm, 2017, 70 p.).
- Disponible en libre-accès : [https:]]
Quelques références utilisées par l’auteur
- Google Street View
- VirtualStreets.org
- Fonds marins : Projet Seabed 2030 – [https:]]
- Chart of the Oceans (GEBCO) – [https:]]
- Sous les nuages : Copernicus Browser – [https:]]
- Bing Maps Aerial
- OpenStreetMap – https://osm-analytics.org
- Gender Equality : Banque Mondiale, Atlas 2023 – [https:]]
- Division de la carte des Nations Unies – [https:]]
- LiDAR : IGN – [https:]]
- Carte TOPO Guyane : Géoportail – [https:]]
- IGN BD Route 500 et IGN BD Route 120
- Balises AIS : GlobalFishingWatch – [https:]]
- Survol interdit : Organisation de l’Aviation Civile Internationale (ICAO) – [https:]]
- Armed Conf : Direction générale de l’aviation civile (DGAC) – [https:]]
- Null Island : Natural Earth Data
- Latitude Zéro : Natural Earth Data
- Point Nemo : Natural Earth Data
- Isohypse zéro : ETOPO Global Relief Model, NOAA
- Présidentielle 2022 : Ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer – https://data.gouv.fr
- Géopolitique de la guerre : Institut pour l’Étude de la Guerre (ISW), Live Universal Awareness Map (Liveuamap), WarMapper, Brady Africk
- Indigenous and Community Lands : LandMark Global Platform – [https:]]
- Où sont les camps du voyage : William Acker, Inventaire critique des aires d’accueil (Éditions du Commun, 2022)
- Carto’friches : Centre d’Études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (Cerema)
-
sur La Crise des eaux souterraines en Méditerranée : la gouvernance en question – François Molle
Publié: 3 February 2025, 7:07pm CET par r.a.
Les cafés géographiques de Montpellier ont reçu ce mardi 5 novembre François Molle. Diplômé de l’École polytechnique, il s’est spécialisé à l’ENGREF (aujourd’hui AgroParisTech) et est titulaire d’un doctorat en sciences de l’eau de l’Université de Montpellier. Il a 40 ans d’expérience dans la recherche pour le développement sur des sujets tels que les petits barrages, l’analyse des systèmes d’irrigation, la gouvernance des bassins hydrographiques, la gouvernance des eaux souterraines, les politiques de l’eau, l’interaction entre les sociétés, la technologie et l’environnement, etc., principalement au Brésil, au Mali, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
Directeur de Recherche à l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement, France), il a été récemment (2010-2015) détaché à l’Institut International de Gestion de l’Eau en charge du développement du portfolio de recherche de l’IWMI (International Water Management Institute) dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Il est co-rédacteur en chef de la revue Water Alternatives.
Ainsi, son expérience sur le terrain, au plus près des acteurs concernés par la problématique de la crise des eaux souterraines en méditerranée (surtout dans ces zones spécifiques du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord où il a été détaché et où les problématiques hydriques sont exacerbées), le rend tout désigné pour nous parler de ce sujet complexe.
Tout d’abord la crise en chiffres :Alors que le monde est mû par une pression liée au réchauffement climatique et à la croissance démographique, la demande d’eau est au cœur des enjeux de développement humain, de justice sociale et de développement environnemental. Stockées à 99 % dans les roches poreuses et perméables des sous-sols, les réserves d’eau font l’objet d’un pompage intensif. Le pompage total mondial annuel est de 1000 milliards de m³ dont 43 % sont utilisés pour les besoins d’irrigation et 50 % pour des usages domestiques. En France, c’est 6 milliards de m³ (dont 55 % pour l’irrigation). Le déstockage mondial représente 250 milliards de m³ par an soit 1/4. Paradoxalement, ces réserves qui de fait constituent une ressource essentielle et vitale, sont souvent sous-évaluées, mal gérées et même surexploitées.
Plus spécifiquement, François Molle se centre sur le cas méditerranéen très éloquent pour évoquer ces défis entre demande croissante et gouvernance hasardeuse. Cette région est caractérisée par un climat semi-aride et une forte pression démographique, est particulièrement vulnérable aux pénuries hydriques. Un stress hydrique par ailleurs amplifié par le changement climatique avec une baisse attendue de 10% à 30% des précipitations d’ici à 2050. Une grande partie des eaux de surface sont des restitutions d’eaux souterraines (par exemple en France c’est 60%). Les eaux souterraines y constituent ainsi une ressource stratégique : l’estimation est à 5 à 6 millions de puits recensés, lesquels impliquent une diversité d’usages (agricole, industriel, domestique) et d’acteurs potentiellement divergents.
La grande diversité d’usagers et de dispositifs techniques dans la crise des eaux souterraines :
– Il y a tout d’abord les qanats, qui sont des galeries creusées initialement en Iran avec des puits servant à sortir des matériaux et à la maintenance. Les qanats se sont développés et se retrouvent en Afrique du Nord et jusqu’au Japon ou en Amérique du Sud). Les galeries sont horizontales au lieu de vertical, le système produit de l’eau tout en reflétant changement hydrologique.
– Il existe plusieurs types de puits (et exhaure) avec des pompes plus ou moins performantes (une pompe à succion peut pomper que jusqu’à 10 m par exemple, mais on peut descendre le corps de pompe dans le puits. Les pompes submergées peuvent être mues par un axe (comme au Maghreb), ou électriques (quand on creuse un forage).
– Ils sont aussi classés par leur catégorie : puits individuels, forages pour l’agrobusiness; puits avec vente d’eau (marchés du service de pompage, en Asie) ; puits collectifs avec investissement partagés ; puits collectif de coopératives (Turquie) ; puits public dévolu (Tunisie) ; puits public (AEP).
Plusieurs modèles de gouvernance de l’eau et des puits :
– 1) la gestion communautaire comme il en existe pour les puits collectifs ou les khettaras et les foggaras au Maroc, en Iran. La gestion peut se faire par des coopératives (Turquie, Algérie, Inde, Tunisie…) ou par des investissements privés conjoints (Maroc, Iran, Égypte…). Ce mode de gestion reste limité à des environnements sociaux et écologiques spécifiques. Il est rarement reproductible mais peut être efficace dans certains contextes. Ils sont souvent mis en danger par les systèmes technologiques (des puits toujours plus profonds), la rareté de la ressource et les concurrences entre les usagers, la tentation de la marchandisation de la ressource ou de systèmes productifs plus marchands (les producteurs tentés par la production intensive de pastèque au Maroc par exemple).
– 2) la gestion axée sur le marché (Bekka libanaise, Australie, EU, Chili). Cette gestion présente également plusieurs limites, parmi lesquelles la difficulté de suivi et de contrôle de la ressource lorsqu’elle dépend des acteurs privés. Le Chili est un cas paradigmatique de la libéralisation du marché de l’eau mais aussi des impacts hydrologiques et sociaux liés à cette privatisation.
– 3) la gouvernance des puits par l’État : dans les années 1980-1990, une majorité des pays du monde ont mis leurs eaux sous tutelle étatique (sous différentes formulations) si bien que l’acteur étatique entre en jeu dans cette gestion des puits. En 1985 par exemple, l’eau en Espagne devient un bien commun et un patrimoine national.
F. Molle distingue trois grandes catégories de politiques concernant les eaux souterraines et leur régulation :
a/ gestion de l’offre, politiquement plus acceptable et pour laquelle les États ont tendance à préférer « créer de la ressource » plutôt que la limiter (transferts, dessalement, recharges, stockage)
b/ contrôle du nombre et de l’expansion des puits (zonages de protection renforcés, imposer des quotas de puits, développer le régime de la déclaration). Des tentatives de fermeture des puits illégaux ont par exemple eu cours en Iran, au Maroc ou en Algérie. Les résultats restent partout limités. F. Molle explique notamment que seulement 15 % des puits du Roussillon étaient déclarés au début des années 2010.
c/ contrôle du pompage des puits existants. Au Maroc par exemple, en 2022, un comptage public des puits a été réalisé. Le résultat : 372000 puits (alors qu’on avançait auparavant le chiffre de 100 000), dont 90 % non autorisés.
La régulation par l’État peut passer par le rachat de puits et de licences, la fermeture de puits illégaux, la mise en place de compteurs etc. Cette police et régulation de l’eau sont dans l’ensemble limitées principalement par le coût très onéreux des investissements nécessaires et la grande difficulté à démanteler le système de puits illégaux.– 4) des modèles de cogestion (Etats-usagers) émergent lesquels permettent de concilier les intérêts des différents acteurs. Elle est encore trop rare dans le domaine des puits et des nappes phréatiques, selon le géographe.
Ces quatre modèles supposés répondre aux « crises » des eaux souterraines se révèlent en réalité insuffisants. Le problème central que François Molle évoque à propos de la gestion des eaux souterraines est le manque de volonté politique de l’État ou sa difficulté à imposer des règles face aux pressions des divers acteurs : intérêts particuliers prédominants, priorités nationales court-termistes au détriment d’une durabilité à long terme, concurrences bureaucratiques internes ou encore lobbyisme puissant en faveur d’un laissez-faire des pratiques aménagistes de l’eau. Ainsi, l’émergence d’une nouvelle culture de l’eau fondée sur des modèles de gestion et d’usage des aquifères plus égalitaires et plus respectueux de l’environnement est-elle freinée.
Questions du public :
=> Pourquoi n’y a-t-il pas plus de communication politique autour de ce problème ?
F.M – Les réponses politiques sont souvent des solutions réactives à des crises ponctuelles. Pour renverser la situation, il faudrait prendre des décisions impopulaires car c’est toute une économie qui s’est développée sur ces systèmes de pompage, et les conditions de vie de beaucoup d’acteurs en dépendent. C’est très difficile de revenir en arrière et de changer de modèle. Surtout quand les investissements faits sont considérables.
En Espagne, dans le bassin du Segura par exemple, les investissements pour assurer l’irrigation de systèmes à haute valeur ajoutée sont impressionnants : lorsque l’eau de la nappe est trop salée, ils peuvent pomper dans la 2e puis la 3e couche. Certains ont même des usines de dessalement individuels, ou sont connectés à une usine de dessalement étatique. Ils suivent la salinité de toutes ces sources et les mixent en conséquence pour que la qualité finale soit acceptable.
On observe des entrepreneurs itinérants, par exemple au Maroc, qui se rendent dans les espaces où l’eau souterraine est accessible et qui plient bagage quand la ressource s’épuise.=> L’Espagne importe-t-elle sa pénurie d’eau ?
F.M -Effectivement, elle investit partout en Méditerranée. Son modèle « marche bien ». Les Espagnols ont une maîtrise de la filière qui leur permet d’investir à l’étranger en reproduisant ce système agricole hydrophage.=> Une auditrice présente une initiative écocitoyenne positive dans les Bouches du Rhône autour de la nappe de Crau : l’objectif est une réappropriation territoriale de l’eau par les acteurs locaux et une collaboration entre gestionnaires des eaux humides/ agriculteurs/ citoyens à propos des puits et forages. L’initiative est financée par l’Agence de l’Eau et permet des espoirs.
F.M – Il y a effectivement des initiatives qui émergent et sont possibles quand le déséquilibre n’est pas trop grand et qu’il s’agit de stabiliser la situation. La Crau est quant à elle, encore largement rechargée par l’eau dérivée de la Durance. Les deux tiers de la nappe en sont issus. Donc, l’initiative de La Crau est une démarche prospective pour réfléchir à l’avance. C’est un cas encourageant qui a l’avantage de réunir de nombreux acteurs et des financements propres. Le contexte français est assez favorable à ce type d’action, il y a une multiplicité d’acteurs publics et d’études sur le sujet. Dans ce type de contexte, des initiatives peuvent permettre des marges d’ajustement de 15/20 %. Le contexte réglementaire et de gouvernance joue donc beaucoup.=> Un auditeur souligne la difficulté des acteurs du SAGE de Montpellier à réguler les pompages privés dans les jardins au moment des sécheresses.
Le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) est un outil de planification, institué par la loi sur l’eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
F.M – Effectivement, contrôler les petits usages diffus qui impactent la ressource en période de sécheresse est très compliqué.
La volonté collective de réguler émerge notamment au travers de la politique de gestion quantitative qui tente de quantifier les prélèvements possibles par nappe ou sous-bassin. Cela comporte un certain nombre de difficultés, en particulier quant à la connaissance imparfaite à la fois de la ressource et des prélèvements, mais la France a au moins le mérite de se poser la question de la limite quantitative de pompage… c’est un point plutôt positif !Par les étudiants de CPGE littéraire de Montpellier : Alexandre Molto et Sara Da Silva (Lycée J.Guesde) ; Majda Bouchami, Athénaïs Saint-Réal et Pellarin Perrine (Lycée Joffre)
-
sur Carte des risques naturels en France métropolitaine (IGN)
Publié: 2 February 2025, 7:04am CET
Source : « Risques naturels : comment se répartissent-ils sur le territoire ? » (IGN, 29 janvier 2025)Réalisée par l'IGN, cette carte montre la répartition des six principaux types de risques naturels en France hexagonale et en Corse. Les risques représentés sont assez divers : inondations, mouvements de terrain, séismes, submersion marine, feux de forêt et avalanches. L'Atelier de cartographie thématique de l'IGN a « pour vocation de venir en appui aux services publics dans la mise en valeur cartographique de leurs données et d'être un espace de réflexion autour de la sémiologie graphique et des façons les plus efficaces de représenter les évolutions des territoires ». Cette carte est intéressante. Elle n'est pas sans poser des problèmes de lecture et d'interprétation.
Répartition des six principaux types de risques naturels en France hexagonale et Corse (source : IGN)
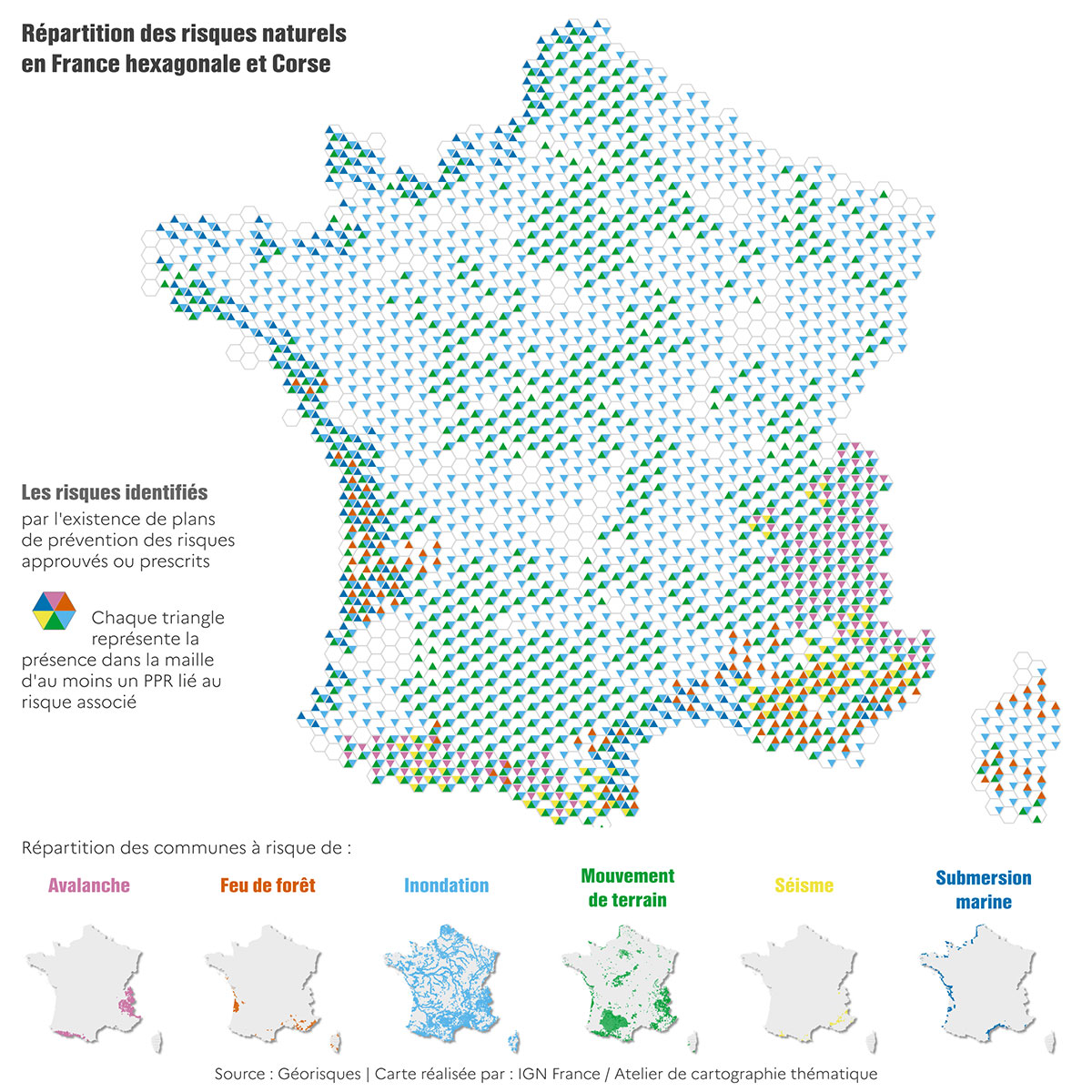
Mode de construction
La carte a été réalisée à partir des données du site Géorisques, du Ministère de la Transition Écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche et du BRGM. Pour chaque cellule disposée sur une grille hexagonale (pas de 20 kilomètres), la carte révèle si au moins une commune comprise dans cette zone dispose d’un Plan de prévention des risques (PPR). Chaque couleur correspond à un type de risque identifié : avalanche (en rose), feu de forêt (en orange), inondation (en bleu), mouvement de terrain (en vert), séisme (en jaune) et submersion marine (en bleu). Les petites cartes situées au bas de la carte de synthèse détaillent de manière utile la répartition de chaque risque pris individuellement. Ce qui permet de faciliter la lecture de cette carte, quelque peu difficile à comprendre au premier coup d'oeil.
Message général délivré par la carte
Comme expliqué sur le site, il s'agit d' « illustrer la répartition des principaux risques naturels en France hexagonale et Corse », mais aussi de montrer « les menaces que le changement climatique intensifie, rendant indispensable une planification adaptée pour connaitre et anticiper les risques et développer notre capacité de résilience face aux aléas ». La carte a donc une double mission d'information et de sensibilisation.
Lorsqu'on observe la carte, apparaît une forte dominance de bleu et de vert. Elle montre bien que le risque inondation constitue le risque majeur, suivi par les mouvements de terrain. La carte met également en évidence la coexistence de différents risques sur le territoire national. Toutefois, le titre pose problème : il ne montre pas assez qu'il s'agit seulement des risques identifiés par les PPR. Il faut aller lire en détail la légende pour le comprendre. Or, toutes les communes françaises ne sont pas dotées d'un PPRN qui reste un zonage réglementaire et sert d'abord comme document opposable (voir la carte des communes disposant d'un PPRN sur Géorisques). Le risque est donc de confondre la répartition réelle des risques et celle traduite indirectement à travers un document d'aménagement (même s'il existe bien sûr un lien entre les deux).

Problèmes posés par les choix méthodologiques et sémiologiques
Au delà du titre de la carte, se pose aussi le problème de la pertinence de ramener une donnée acquise à l'échelle communale sur une grille hexagonale de 20 km. Certes, cela permet de spatialiser le risque de manière uniforme sur le territoire en faisant abstraction du découpage administratif des communes. Mais en même temps cela pourrait laisser penser qu'il s'agit de la maille d'acquisition de la donnée, qui de fait n'a pas ce degré de résolution.
Du point de vue du choix des variables visuelles (juxtaposition de triangles de couleur au sein d'une maille hexagonale), la carte peut s'avérer d'une lecture difficile dans les secteurs où différents risques coexistent. On peut être perturbé par l'effet "psychédélique" produit par le choix de figurés géométriques pour représenter des territoires à risques. D'autant qu'il s'agit de risques fort différents n'ayant pas les mêmes périmètres de risques et qui concernent des communes souvent dissemblables (cf cas spécifique des communes situées sur le littoral pour le risque de submersion marine). C'est l'un des défis posés par une carte de synthèse qui cherche à généraliser l'information.
Effet visuel produit par les figurés géométriques lorsque l'on zoome sur la carte (source : IGN)

Au total, cette carte vaut surtout pour son originalité. Elle mérite d'être recoupée avec d'autres cartes de risques (voir par exemple les cartes interactives proposées par Géorisques). Comme beaucoup de cartes produites par ordinateur, elle nécessite d'être décryptée et déconstruite pour en analyser et discuter le sens et en montrer les éventuels biais d'interprétation.
Articles connexes
Carte mondiale d'exposition aux risques climatiques, de conflit et à la vulnérabilité
Rapport du Forum économique mondial sur la perception des risques globaux
Analyser et discuter les cartes de risques : exemple à partir de l'Indice mondial des risques climatiques
Cartographie des noms qui servent à désigner les couleurs en Europe (Mapologies)
Quand les couleurs révèlent le contenu et la matérialité des cartes. L'exemple de l’Asie orientale du milieu du XVIIe au début du XXe siècle
Quand la couleur rencontre la carte (catalogue d'exposition à télécharger)
Créer ses propres palettes de couleurs avec Dicopal
-
sur Cartographie des pays ayant les États-Unis ou la Chine comme principal partenaire commercial (2001-2023)
Publié: 1 February 2025, 4:48am CET
La carte animée proposée par le Lowy Institute montre qui, des États-Unis ou de la Chine, est devenu le principal partenaire commercial de chaque pays sur la période 2001-2023. Elle permet de mesurer l'influence grandissante de la Chine au début du XXe siècle. Selon l'Institut Lowy, « environ 70 % des économies commercent davantage avec la Chine qu'avec les États-Unis, et plus de la moitié d'entre elles commercent deux fois plus avec la Chine qu'avec les États-Unis . Au début du siècle, la situation était très différente : plus de 80 % des pays commerçaient davantage avec les États-Unis qu'avec la Chine ».
L'application et le rapport qui l'accompagne ont été produits par le Centre de développement indo-pacifique du Lowy Institute, qui bénéficie du soutien financier du ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce. Au delà du constat, il s'agit de prendre conscience de la domination de la Chine et d'organiser la riposte économique : « les actions de plus en plus virulentes des États-Unis et d’autres pays n’ont toujours pas réussi à arrêter les exportations chinoises. Mais une attaque bien plus importante est en cours » (sic). Par son contraste bleu/rouge, la carte fait penser à une carte géopolitique de la Guerre froide opposant pays de l'Est et pays de l'Ouest. Le fait de ne retenir que les Etats-Unis et la Chine a tendance à reduire le caractère multipolaire du commerce mondial aujourd'hui (voir la carte du Global Influence Index qui pose le même problème, malgré une vision plus nuancée du fait du plus grand nombre d'indicateurs pris en compte).
Premier partenaire commercial par pays sur la période 2001-2023 (source : Lower Intitute)
Déplacez le curseur en bas de la carte pour voir l'évolution et comparez importations / exportations
L’ascension rapide de la Chine en tant que superpuissance commerciale mondiale remonte à 2001, année de son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). À l’époque, plus de 80 % des économies avaient davantage d’échanges bilatéraux avec les États-Unis qu’avec la Chine. En 2018, ce chiffre était tombé à un peu plus de 30 %, 139 des 202 économies pour lesquelles des données étaient disponibles ayant davantage d’échanges avec la Chine qu’avec les États-Unis. Cette tendance se confirme avec les dernières données, qui couvrent l’ensemble de l’année 2023 pour 205 économies. Environ 70 % du monde, soit 145 économies, commercent désormais davantage avec la Chine qu’avec les États-Unis.
Les dernières données montrent que l'avance de la Chine en matière d'intégration commerciale mondiale s'est encore accrue, notamment en termes d'intensité de ses relations commerciales. Mais cet approfondissement reste déséquilibré, alimenté par une forte hausse des exportations chinoises alors que ses importations n'ont pas suivi le rythme.
En termes d'exportations, les États-Unis restent une destination plus importante que la Chine pour plus de la moitié des économies dans le monde. Cependant, compte tenu des menaces constantes de Donald Trump d'imposer des droits de douane à d'autres pays, il est évident qu'il cherche à affaiblir l'attrait des États-Unis en tant que destination d'exportation. Ce qui est moins clair, c'est comment il compte accroître les exportations américaines.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
Les données ayant servi à construire la carte sont issues des Statistiques sur la direction des échanges commerciaux (DOTS) du FMI. Elles présentent la valeur des exportations et des importations de marchandises désagrégées en fonction des principaux partenaires commerciaux de chaque pays. Les données sont disponibles de manière annuelle depuis 1947, de manière mensuelle et annuelle depuis 1960.
Pour prolonger
« Donald Trump signe les décrets sur les droits de douane imposés au Canada, au Mexique et à la Chine » (Le Monde).
Les nouvelles taxes commenceront à entrer en vigueur mardi 4 février. Les produits canadiens et mexicains seront taxés à 25 % – à l’exception des hydrocarbures canadiens taxés à 10 % – et les produits chinois à 10 %. Les réactions mexicaine, canadienne et chinoise sont vite arrivées : quelques heures plus tard, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et le premier ministre canadien Justin Trudeau ont annoncé que des droits de douane seraient imposés en représailles sur les produits américains. De son côté, Pékin a dit s’« opposer fermement » aux taxes américaines et promis de répliquer avec des mesures « correspondantes ».
« La Chine va contester les droits de douane américains devant l’OMC » (Ouest-France).
La Chine va contester les droits de douane américains auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), a déclaré dimanche 2 février le ministère chinois du commerce. La décision des États-Unis d’imposer des droits de douane « viole gravement » les règles de l’OMC, a déclaré le ministère dans un communiqué, exhortant Washington à « engager un dialogue franc et à renforcer la coopération ». Le président américain Donald Trump a signé samedi des décrets imposant des droits de douane au Mexique, au Canada et à la Chine, qui devraient entrer en vigueur mardi. Pékin s’est vu imposer des droits de douane de 10 %, en plus de ceux qui sont déjà appliqués à ses exportations aux États-Unis. « La Chine est vivement mécontente et s’oppose fermement » au relèvement des taxes, a fustigé le ministère du Commerce dans un communiqué, en annonçant des mesures «correspondantes pour protéger résolument» les «droits et intérêts» chinois. Le commerce sino-américain a représenté environ 500 milliards d’euros sur les 11 premiers mois de 2024 mais la balance est grandement en défaveur des Etats-Unis, avec un déficit de quelque 260 milliards d’euros sur la période, selon les chiffres de Washington.
Lien ajouté le 10 février 2025
? La bataille navale Chine-Etats-Unis pour dominer le commerce mondial ?? [https:]]
— Les Echos (@LesEchos) February 10, 2025
? Avec 90% des échanges internationaux transitant par voie maritime, la tension monte autour des points stratégiques comme le canal de Panama et les îles du Pacifique. pic.twitter.com/65ejIiFm2vArticles connexes
Carte de l'influence mondiale de la Chine et des États-Unis
La mondialisation appréhendée à travers un indice de connectivité mondiale
Mesurer le rayonnement des grandes puissances à travers leurs réseaux diplomatiques
Comment la Chine finance des méga-projets dans le monde
Les investissements de la Chine dans les secteurs de l'Intelligence artificielle et de la surveillance
Les pays bénéficiaires de l'aide des Etats-Unis depuis 1945
Utiliser les cartes du CSIS pour étudier les grandes questions géopolitiques du monde contemporain
Les visions multiples de la francophonie à travers les cartes
-
sur Impact de l’exposition à la pollution de l’air ambiant sur la survenue de maladies chroniques (Santé publique France)
Publié: 30 January 2025, 9:34am CET
Santé publique France a estimé, pour la première fois, l’impact de l’exposition à la pollution de l’air ambiant sur la survenue de maladies chroniques, en France hexagonale et en régions pour la période 2016-2019, dans une étude publiée le 29 janvier 2025. Les résultats soulignent qu’au-delà de ses impacts sur la mortalité, l’exposition à la pollution atmosphérique constitue un fardeau important pour la santé en France hexagonale en termes de survenue des huit maladies chroniques étudiées. La pollution de l’air, un fléau aux conséquences enfin chiffrées !
Huit maladies ont un lien scientifiquement avéré avec l’exposition aux particules PM2,5 et/ou au NO2, à savoir :
- au niveau respiratoire : cancer du poumon, broncho-pneumopathie chronique obstructive, asthme de l’enfant et de l’adulte, pneumopathie et autres infections aiguës des voies respiratoires inférieures (grippe exclue) ;
- au niveau cardiovasculaire : AVC (accident vasculaire cérébral), infarctus aigu du myocarde, hypertension artérielle ;
- au niveau métabolique : diabète de type 2.
Selon la maladie et le polluant étudié, cela représente :
- entre 12 et 20 % des nouveaux cas de maladies respiratoires chez l’enfant (soit entre 7 000 et presque 40 000 cas),
- entre 7 et 13 % des nouveaux cas de maladies respiratoires, cardiovasculaires ou métaboliques chez l’adulte (soit entre 4 000 et 78 000 cas) sont attribuables annuellement à une exposition à long terme à la pollution d’origine anthropique en France hexagonale.
La réduction des concentrations en PM2,5 et NO2 à des niveaux équivalents aux valeurs guides de l'OMS permettrait d'éviter :
- 75 % de ces cas de maladies liées à l’exposition aux PM2,5 en lien avec les activités humaines
- près de 50 % pour le NO2.
À titre d’illustration, le respect de la valeur guide de l’OMS pour les PM2,5 permettrait d’éviter presque 30 000 nouveaux cas d’asthme chez l’enfant de 0 à 17 ans.
L'impact économique annuel en termes de santé et de bien-être pour les maladies étudiées est estimé à :
- 12,9 milliards d’euros en lien avec les PM2,5, soit presque 200 euros par an et par habitant,
- 3,8 milliards d’euros pour le NO2, soit 59 euros par an et par habitant.
Si les valeurs guides de l'OMS étaient respectées, ces bénéfices seraient respectivement de 9,6 milliards d’euros (soit 148 euros par an et par habitant) et 1,7 milliard d’euros (soit 26 euros par an et par habitant).
Les résultats de cette étude confortent l’importance en termes de santé publique de poursuivre et de renforcer les actions mises en place par les pouvoirs publics afin de répondre aux objectifs de la nouvelle directive européenne concernant la qualité de l’air ambiant et « Un air pur pour l’Europe ». Cette directive vise à abaisser dans un premier temps les normes de l’Union européenne en matière de qualité de l’air puis à les aligner à terme sur les valeurs guides les plus récentes de l’OMS. Ces actions se traduisent par la poursuite des efforts de réduction de la pollution sur toutes ses sources et sur l’ensemble du territoire, au travers des stratégies et plans d’action mis en œuvre aux niveaux national et local. Dans « Le pacte vert pour l’Europe », la Commission européenne s’est engagée à améliorer davantage la qualité de l’air et à aligner plus étroitement les normes de l’Union européenne sur les recommandations de l’OMS. Dans son plan d’action « zéro pollution », la Commission européenne s’engage ainsi à réduire, d’ici à 2030, l’incidence de la pollution atmosphérique sur la santé de plus de 55 %.
Pour consulter les résultats de l’étude :
Estimation de la morbidité attribuable à l’exposition à long terme à la pollution de l’air ambiant et de ses impacts économiques en France hexagonale, 2016-2019 (rapports et synthèse nationale)- volume 1 : Évaluation quantitative d’impact sur la santé (ÉQIS-PA)
- volume 2 : Évaluation des impacts économiques
La pollution de l'air est la première menace mondiale pour la santé humaine (rapport de l'EPIC, août 2023)
Pollution de l'air et zones urbaines dans le monde
Quels sont les États qui ont le plus contribué au réchauffement climatique dans l’histoire ?
Les plus gros émetteurs directs de CO2 en France
Quand la carte du dioxyde d'azote (NO2) crée comme une ombre fantomatique de l'humanité
Qualité de l'air et centrales thermiques au charbon en Europe : quelle transition énergétique vraiment possible ?
L'empreinte carbone des villes dans le monde selon le modèle GGMCF
Le tourisme international et son impact sur les émissions de CO?
Des cartes pour alerter sur la pollution de l'air autour des écoles à Paris et à Marseille
-
sur Deuxième Journée d’étude : Le Fleuve sur la carte. 25 février 2025.
Publié: 29 January 2025, 5:20pm CET par Emmanuelle Vagnon
Le Fleuve sur la carte. Cartes régionales et mappemondes (monde latin, monde arabo-musulman) XIe -XVIe siècle
25 février 2025
9h30 – Accueil des participants et introduction
Jean-Charles Ducène, Nathalie Bouloux, Jean Sénié et Camille Serchuk10h – Les fleuves dans la cartographie du monde arabo-musulman
Des Pamirs à la mer d’Aral ? L’Amou Darya dans la cartographie arabe
Camille Rhoné (Université Aix-Marseille)Les fleuves d’Iran dans la cartographie d’Idrisi
Jean-Charles Ducène (EPHE)Discussions
14h – Les fleuves dans la cartographie du monde latin
Rivers of Paradise and Rivers of Communication
Felicitas Schmieder (FernUniversität in Hagen)Nuovi fiumi e nuovi mondi (secoli XV-XVI)
Marica Milanesi (professeur émérite Université de Pavie)Les fleuves sur les cartes marines (XIIIe-XVe siècle)
Emmanuelle Vagnon (CNRS-LAMOP)Entre cartographie locale et cartographie régionale : les représentations du Pô (XIVe-XVe siècle)
Nathalie Bouloux (Université de Tours-CESR)Discussions
Affiche et programme en PDF
-
sur Café géo de Paris, mercredi 12 février 2025 : « Géographie des pandémies contemporaines », avec Guillaume Lachenal
Publié: 29 January 2025, 2:06pm CET par r.a.
Mercredi 12 février 2025, de 19h à 21h, Café de flore, salle du premier étage, 172 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris
Guillaume Lachenal, professeur des universités à Sciences Po Paris, est l’unique intervenant de ce café géo qui se tient de façon inhabituelle un mercredi : le 12 février 2025. Il est l’auteur avec Gaëtan Thomas d’un atlas historique des épidémies paru en 2023 aux éditions Autrement.
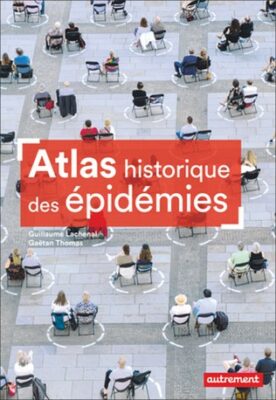
Les principales pandémies des XXe et XXIe siècles (grippe espagnole, sida, Covid-19, etc.) seront interrogées selon plusieurs notions géographiques comme les territoires, les lieux et les paysages. Ainsi la lutte contre les épidémies suscite la création d’espaces et de lieux de contrôle. Les lieux de confinement sont bien sûr liés à l’enfermement mais ils peuvent devenir également des lieux de réappropriation. De nombreuses questions ne manqueront pas d’être posées sur les liens multiples et mutuels des humains, des pathogènes, des êtres vivants et des territoires.
-
sur [Webinaire] 3D open source : une nouvelle dimension !
Publié: 29 January 2025, 9:33am CET par Caroline Chanlon

Oslandia a le plaisir de vous inviter à un webinaire dédié à la 3D open source jeudi 13 mars 2025 à 11h.
Au programme :- Les enjeux de la 3D en 2025 : jumeaux numériques, publier de la donnée sur le web, partager la donnée, gérer la volumétrie, mutualiser les outils en OpenSource
- Cas d’usages
- Architecture technique
- Présentation des composants OpenSource Giro3D, Piero, py3Dtiles, CityForge
- Séquence d’échanges, questions / réponses
Inscription gratuite mais obligatoire, le lien d’accès au webinaire vous sera adressé par email après votre inscription : [https:]]
-
sur L'Indice de performance environnementale (EPI)
Publié: 28 January 2025, 5:41pm CET
L’Environmental performance index (EPI, en français IPE), élaboré conjointement par les Universités de Yale et de Columbia, en réponse à une demande du Forum Économique Mondial de Davos, vise à comparer les performances environnementales des pays et ainsi contribuer à l’amélioration de leurs politiques en termes de protection des écosystèmes et de santé humaine. Chaque pays reçoit une note entre 0 et 100, 100 étant le meilleur score, selon différents critères statistiques. Un classement officiel est ensuite publié afin d’encourager les pays les plus éco-responsables et rappeler à l’ordre ceux qui ne le sont pas du tout.
À l’aide de 58 indicateurs de performance répartis sur 11 catégories (qualité de l’air et santé, qualité de l’eau, biodiversité et habitats, forêt, pêche, climat et énergie, pollution de l’air, ressources en eau, agriculture), l’IPE classe 180 pays en fonction de leur performance en matière de changement climatique, de santé environnementale et de vitalité des écosystèmes. Ces indicateurs fournissent une mesure de la proximité des pays par rapport aux objectifs de politique environnementale. L’IPE propose un tableau de bord qui met en évidence les leaders et les retardataires en matière de performance environnementale et fournit des conseils pratiques aux pays qui aspirent à évoluer vers un avenir durable.
58 indicateurs répartis en 11 catégories avec 3 objectifs principaux (source : epi.yale.edu)
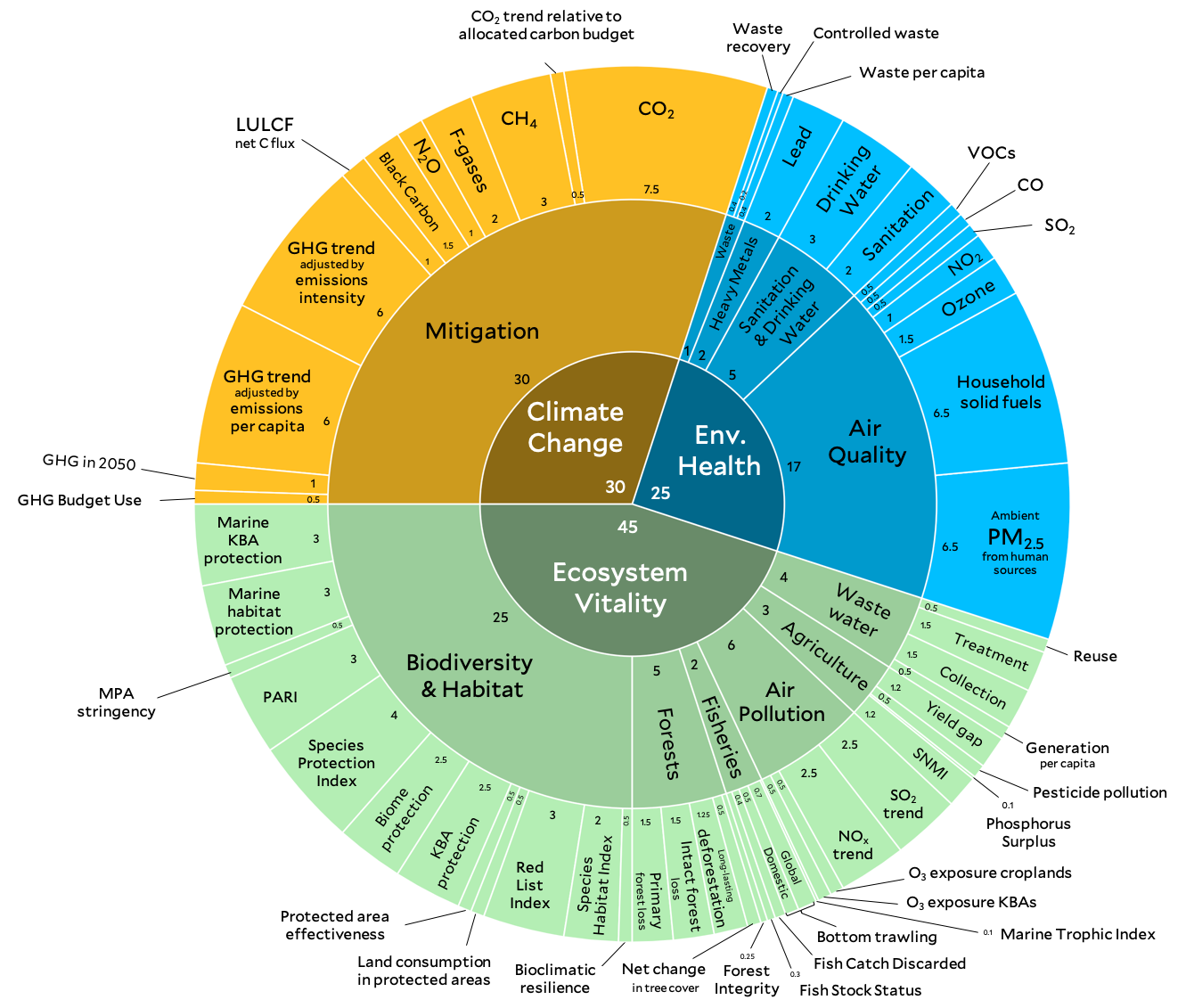
Publiés depuis 2006, les indicateurs IPE permettent de repérer les problèmes, de fixer des objectifs, de suivre les tendances, de comprendre les résultats et d’identifier les meilleures pratiques en matière de politiques environnementales. Cette vue granulaire et cette perspective comparative peuvent aider à comprendre les déterminants des progrès environnementaux et à affiner les choix politiques. Comme tout indicateur synthétique, l'IPE donne une vue moyenne. Le résultat final reste très dépendant du choix des indicateurs élémentaires et des pondérations qui leur sont appliquées. D’autres choix peuvent conduire à des résultats très différents, ce qui conduit à s’interroger sur la nature véritablement scientifique de cette démarche. Le principe même de l’agrégation des données pose problème, aucune méthode ne faisant consensus pour mesurer sur une échelle commune de tels indicateurs. Le rang doit également être interprété avec discernement : beaucoup d’écarts de « notes » entre pays sont faibles comparés à l’imprécision des données (source : Les indicateurs de développement durable, INSEE). Il convient d'aller au-delà des scores globaux et d'analyser les données par catégorie de problème et par objectif politique.
La méthode de calcul de l’IPE évolue à chaque édition. C’est pourquoi du fait du changement fréquent de méthodologie, la comparaison du score d’un pays à celui de l’édition précédente ne s’avère pas pertinente. En outre, les résultats du classement de l’IPE mettent l’accent sur les enjeux des pays et reflètent leur situation économique et politique. Sans grande surprise, les pays riches et développés occupent majoritairement le haut du classement, puisqu’ils ont les moyens de financer les solutions écologiques. L'Europe et en particulier la France font plutôt bonne figure dans ce classement. Pour autant, certains indicateurs relatifs aux « services écosystémiques » se sont dégradés, notamment sur l'évolution du couvert forestier. Mais il faut relativiser la fiabilité des données, l'observation satellitaire pouvant être source d'erreurs. A titre d'exemple, les dégâts infligés au massif des Landes par la tempête Klaus ont été assimilés à de la déforestation (Classements internationaux sur l'environnement. Comment interpréter la place de la France ?).
L’Indice de performance environnemental (IPE) permet donc principalement de faire un tour d’horizon des pays éco-responsables et ceux qui ont un "retard écologique", par manque de moyens ou de volonté. Il n'a pas vocation à fournir un classement objectif des pays ni à distribuer les bons ou mauvais points entre pays, un grand nombre d'entre eux n'ayant tout simplement pas les moyens d'atteindre les objectifs fixés au niveau international.
Pour télécharger les ressources : rapport 2024 et données 2024 (les données sont actualisées tous les deux ans).
Block, S., Emerson, JW, Esty, DC, de Sherbinin, A., Wendling, ZA, et al. (2024). Indice de performance environnementale 2024. New Haven, CT : Yale Center for Environmental Law & Policy. epi.yale.edu
Romain Thomas a développé une application avec Maplibre qui permet de visualiser l'IPE global et de faire des comparaisons pour chacun des 11 indicateurs.
Naviguez à travers les résultats 2024 de l'Environment Performance Index à l'aide d'un outil réalisé avec la v5 de @maplibre. [https:]]
— Romain T. (@Romainsologne) January 27, 2025
Cet indice produit par @Yale et @Columbia est mis à jours tous les deux ans. (?l'outil n'est pas adapté sur mobile). pic.twitter.com/P40ARNbV0TArticles connexes
Cartographier l'empreinte humaine à la surface du globe
Comment la cartographie animée et l'infographie donnent à voir le changement climatique
Cartographier les arbres. Entre visions esthétiques et enjeux environnementaux
Environnement et justice dans les paysages anthropisés. Une exposition virtuelle du Leventhal Center
Etudier la vulnérabilité environnementale et sociale en Amazonie colombienne à travers un outil de cartographie en ligneCartes et données sur les forêts en France et dans le monde
Cartographie des incendies en Californie
Eduquer à la biodiversité. Quelles sont les cartes, les données... et les représentations ?Limites planétaires. Des chercheurs expliquent pourquoi la Terre menace de devenir inhabitable
-
sur Cartographie de l'ionosphère avec des millions de téléphones dans le monde
Publié: 28 January 2025, 5:16pm CET
Source : Smith, J., Kast, A., Geraschenko, A. et al. Mapping the ionosphere with millions of phones. Nature, 635, 365–369 (2024). [https:]]L'ionosphère est une couche de l'atmosphère caractérisée par une ionisation partielle des gaz s'étendant entre 50 et 1500 kilomètres au-dessus de la Terre. Le contenu électronique total de l'ionosphère varie en réponse à l'environnement spatial de la Terre, interférant avec les signaux du système mondial de navigation par satellite (GNSS). Il en résulte l'une des plus grandes sources d'erreur pour les services de positionnement, de navigation et de synchronisation. Les réseaux de stations GNSS terrestres de haute qualité fournissent des cartes du contenu électronique total de l'ionosphère pour corriger ces erreurs, mais d'importantes lacunes spatiotemporelles dans les données de ces stations signifient que ces cartes peuvent contenir des erreurs.
Nous démontrons ici qu'un réseau distribué de capteurs - sous la forme de millions de téléphones Android - peut combler bon nombre de ces lacunes et doubler la couverture de mesure, fournissant une image précise de l'ionosphère dans les zones du monde mal desservies par les infrastructures conventionnelles. En utilisant des mesures effectuées à l'aide de smartphones, nous déterminons des caractéristiques telles que les bulles de plasma au-dessus de l'Inde et de l'Amérique du Sud, la densité renforcée par les tempêtes solaires au-dessus de l'Amérique du Nord et un creux ionosphérique à moyenne latitude au-dessus de l'Europe. Nous montrons également que les cartes de l'ionosphère obtenues peuvent améliorer la précision de la localisation, ce qui est notre objectif principal. Ce travail démontre le potentiel de l'utilisation d'un grand réseau distribué de smartphones comme un puissant instrument scientifique de surveillance de la Terre.
Couverture géographique des téléphones et des stations de surveillance (source : Smith et al., 2024)
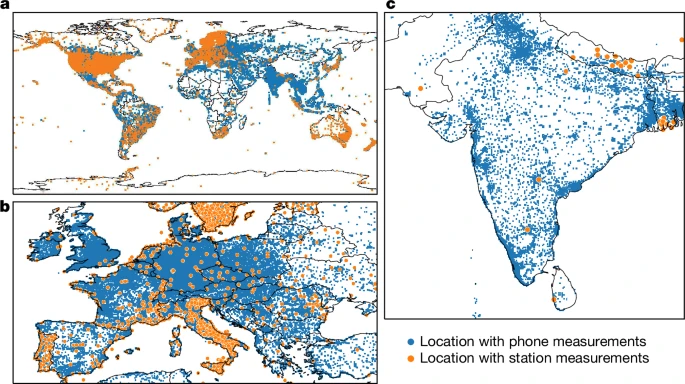
Les 9 036 stations de surveillance (points orange) contribuent à la base de données Madrigal, qui regroupe des dizaines de réseaux de stations mondiaux et régionaux. Les points bleus indiquent environ 100 000 emplacements où des mesures téléphoniques sont disponibles. Un emplacement dans une grande ville peut avoir des milliers de téléphones. La carte mondiale (a) montre que certaines parties du monde (comme les États-Unis et l'Europe) sont densément couvertes par des stations de surveillance. Un zoom sur l'Europe (b) montre que les téléphones ont une couverture encore plus dense. En Inde (c), la couverture relative des téléphones est encore plus grande. Les emplacements des stations ont été tirés de la base de données Madrigal (données sources à télécharger au format txt).
Les sources sont disponibles sous la forme d'une note Python.
Articles connexes
Infrastructures numériques : un accès encore inégal selon les pays
Carte du déploiement de la fibre optique en France
Qui habite où ? Compter, localiser et observer les habitants réels en France
Étudier la fréquentation touristique dans les villes espagnoles à partir des données de téléphonie mobile
La carte mondiale de l'Internet selon Telegeography
Les câbles sous-marins, enjeu majeur de la mondialisation de l'information
Une cartographie mondiale des points de connexion Wi-Fi réalisée dans le cadre du projet WiGLE
Carte mondiale des antennes-relais mobiles à partir des données ouvertes d'OpenCelliD
Carte du déploiement de la fibre optique en France
-
sur Testez QGIS 4 avant tout le monde
Publié: 28 January 2025, 2:00pm CET
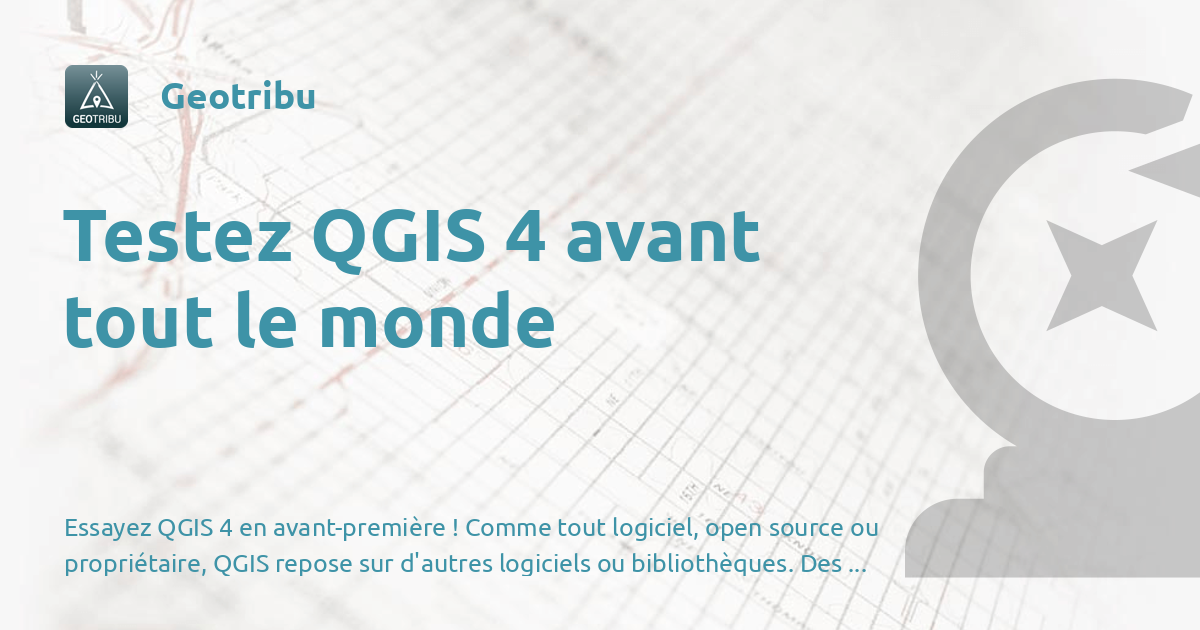 Essayez QGIS 4 en avant-première ! Comme tout logiciel, open source ou propriétaire, QGIS repose sur d'autres logiciels ou bibliothèques. Des dépendances dont la principale est Qt.
Essayez QGIS 4 en avant-première ! Comme tout logiciel, open source ou propriétaire, QGIS repose sur d'autres logiciels ou bibliothèques. Des dépendances dont la principale est Qt.
-
sur L’UX au service de la communication de la transition écologique : retour sur un atelier de co-design dans les Pays de la Loire
Publié: 28 January 2025, 9:14am CET par Mathieu Laffond
Afin de relever le défi de la transition écologique, l’Observatoire de la Transition Écologique (TEO) des Pays de la Loire a organisé un atelier UX de réflexion sur des outils accessibles et efficaces.
-
sur Alpes Open Source Software 2025
Publié: 28 January 2025, 6:27am CET par Caroline Chanlon

AlpOSS, nouvel événement de l’écosystème open source local et régional, se tiendra jeudi 20 Février 2025 à la Mairie d’Échirolles.
Sponsor de la journée, Oslandia animera une présentation « La plateforme QGIS, un système d’information géographique opensource complet » avec Loïc Bartoletti à 16h30 en salle Solutions : [https:]]
Loïc Bartoletti et Thomas Muguet seront d’ailleurs présents toute la journée pour échanger sur vos projets et découvrir les dernières réalisations et contributions d’Oslandia !
Plus d’informations et inscription : [https:]]
-
sur Contre-cartographie : ce que Google Maps ne vous montre pas
Publié: 27 January 2025, 7:18am CET
Source : « Contre-cartographie : ce que Google Maps ne vous montre pas » (Tracks, ARTE)- 00:00 Introduction
- 01:01 Contre-cartographie : l'espace est politique
- 06:59 Cartographie sensible : dessiner ses émotions
- 13:01 Cartographie amoureuse : regarder l’environnement
Pour trouver son chemin, et de préférence avec l’itinéraire le plus rapide, nombreuses sont les cartes dans nos poches : Google Maps, Waze, etc. Elles peuvent nous géolocaliser en temps réel, mesurer les distances parcourues, mais aucune d’entre elles n’est capable de représenter les ressentis et les vécus liés à nos déplacements. La contre-cartographie vient rebattre les cartes, et bouscule notre rapport utilitaire à l’espace. Ici, pas question de suivre la supposée objectivité scientifique, on veut représenter le monde tel qu’on le vit pour mieux mettre en avant les problématiques invisibles à l'œil nu : dynamiques raciales, enjeux environnementaux ou même nos propres questionnements intérieurs.
Tracks part à la rencontre de celles et ceux qui spatialisent les enjeux sociétaux et cartographient notre intime. L’artiste canadienne Larissa Fassler dessine les contours des inégalités qu’elle lit dans les espaces publics. Le danseur et performeur Mathias Poisson porte son attention sur le vivant et suit ses sens pour cartographier sa subjectivité. Stéphanie Sagot, quant à elle, œuvre à retranscrire le monde sous un prisme éco-sensible avec des cartes-peintures de paysages.
Pour compléter
Bien que les globes virtuels ne puissent parvenir à traduire les réalités humaines et sociales depuis le ciel, il arrive que certaines d'entre elles se révèlent assez brutalement. C'est le cas par exemple de ces messages d'appel à l'aide ("HELP") inscrits au sol sur un terrain vague situé en plein coeur de Los Angelès et relevés par Google Maps en 2023 (ces inscriptions sont encore visibles aujourd'hui).
Le terrain vague se situe dans une zone abandonnée de Los Angelès coincée entre des voies de chemin de fer et d'autoroutes, repère de trafics en tout genre. Les mots "Help", "traffico", "Federal" et "LAPD" ont été inscrits au sol déclenchant une vague de spéculations
— Sylvain Genevois (@mirbole01) January 27, 2025
2/ pic.twitter.com/VWBHsreakPLe terrain vague avec ces inscriptions se situe à proximité de la station d'hélicoptères de la police et les policiers survolent constamment cette zone, ce qui laisse penser que ces inscriptions leur seraient peut-être destinées... [https:]]
— Sylvain Genevois (@mirbole01) January 27, 2025
4/ pic.twitter.com/pTm4EVHmV1
Lien ajouté le 9 février 2025Ces messages énigmatiques de détresse et d'appel à l'aide sont visibles aussi dans le paysage urbain en dehors du terrain vague [https:]]
— Sylvain Genevois (@mirbole01) January 27, 2025
6/ pic.twitter.com/LpTeQx8KuE
Articles connexes???Le Plan Carte™ nouveau est arrivé ! Dedans, il y a : - un mastodonte de la cartographie - des frontières qui apparaissent et disparaissent - une chanson absolument nécessaire Comment Google redessine le monde ? @lesechosfr.bsky.social www.youtube.com/watch?v=DRfi...
— Jules Grandin (@julesgrandin.bsky.social) 9 février 2025 à 21:24
[image or embed]
La carte, objet éminemment politique. Cartographie radicale par Nepthys Zwer et Philippe Rekacewicz
Pour un spatio-féminisme. De l'espace à la carte (Nepthys Zwer)
La carte, objet éminemment politique. Vous avez dit « géoactivisme » ?
La carte, objet éminemment politique : les cartes de manifestations à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux
La carte des ZAD en France : entre cartographie militante et recensement des projets contestés
Dire et changer le monde avec les cartes (émission "Nos Géographies" sur France-Culture)
Le Blanc des cartes. Quand le vide s'éclaire (Atlas Autrement)
Sous le calque, la carte : vers une épistémologie critique de la carte (Denis Retaillé)
-
sur Veille des Cafés géographiques sur les littoraux – janvier 2025
Publié: 26 January 2025, 5:17pm CET par Les Cafés Géo
Annaïg Oiry [biographie et publications]. – Site de l’université Gustave Eiffel
Articles et publicationsLes littoraux, Annaïg Oiry. – La documentation photographique. 2021. – La Cliothèque, Clionautes
Développer les énergies marines renouvelables sur la façade atlantique française : entre contestation et planification, Annaig Oiry. – Géoconfluences (Lyon) Dossier Les systèmes socio-écologiques face aux changements globaux, 2018
L’aménagement-du-littoral-méditerranéen-face-aux-risques-liés-a-la-mer-et-aux-inondations, rapport de la Cour des comptes. 24 janvier 2025
Les littoraux français : indications bibliographiques (CAPES externe 2025, agrégations externes 2025). – Géoconfluences (Lyon), 2023
Droit et Littoral. – Géoconfluences, dans Glossaire,dernière modification, 2025
Les littoraux français : quelle utilité ? – Population & Avenir, n° 771, janvier-février 2025
PodcastsÉrosion du littoral, plages qui diminuent : à Marseille, les conséquences de la montée de la Méditerranée. – France culture. Publié le mardi 12 novembre 2024
Stratégie nationale pour la mer et le littoral : les élus des littoraux devront encore attendre. – France culture. Publié le lundi 24 juin 2024.
Chroniques littorales – France culture, 2?057 épisodes
La découverte et l’actualité des mers et de l’océan, des « Mériens » et des « Mériennes », de l’économie maritime et des territoires ultras marins. Les chroniques littorales larguent les amarres tous les jours…
Gérer le Littoral. – France Inter, 2011
Sites officielsGéolittoral
Conservatoire du littoral
Atout France – Littoraux
Martine Jouve, 25 janvier 2025
-
sur Des changements multiformes dans la disponibilité en eau avec un climat plus chaud
Publié: 25 January 2025, 6:36pm CET
Source : Gu, B., Zhou, S., Yu, B., Findell, K. L. & Lintner, B. Multifaceted changes in water availability with a warmer climate, npj Climate and Atmospheric Science, 8, 31 (2025).
Des chercheurs de l'Université de Pékin analysent l’impact du réchauffement climatique sur la disponibilité en eau. L’étude montre une variabilité accrue entre zones humides et zones arides amplifiant inondations et sécheresses. Les zones humides (Amazonie, Asie du Sud-Est) connaîtront une hausse marquée des précipitations saisonnières (+20%), entraînant des inondations et affectant les écosystèmes aquatiques. Cette intensité des pluies menace aussi les infrastructures et les populations riveraines. En Afrique du Nord et en Asie centrale, l’aggravation des sécheresses affectera gravement les ressources agricoles. La diminution des précipitations et l’évaporation accrue réduiront les réserves hydriques, accentuant la vulnérabilité des communautés rurales.
Distribution globale des régimes hydroclimatiques (source : Gu & al., 2025)

Résumé
Le réchauffement climatique modifie les schémas spatiaux et saisonniers de la disponibilité en eau de surface, affectant le ruissellement et le stockage de l'eau terrestre. Cependant, une évaluation complète de ces changements dans divers hydroclimats reste manquante. Nous développons une approche d'ensemble multi-modèles pour classer l'hydroclimat terrestre mondial en quatre régimes distincts en fonction de la moyenne et de la saisonnalité de l'eau de surface. Celle-ci devrait devenir de plus en plus variable dans l'espace et le temps. Les régions humides à faible et forte saisonnalité sont susceptibles de connaître des augmentations plus concentrées jusqu'à 20 % du ruissellement en saison humide. j soulignant des augmentations potentielles de la vulnérabilité liée aux inondations. Les régions à faible saisonnalité présentent des augmentations plus rapides de l'humidité du sol pendant la saison humide et des diminutions plus rapides pendant la saison sèche, augmentant la probabilité de pénurie d'eau et de sécheresse. Inversement, les régions sèches à forte saisonnalité sont moins sensibles au changement climatique. Ces résultats soulignent les impacts multiformes du changement climatique sur les ressources en eau mondiales, nécessitant la nécessité de stratégies d'adaptation selon les différents régimes hydroclimatiques.
Disponibilité des données
Toutes les données utilisées dans cette étude sont disponibles en ligne. Les simulations du modèle CMIP6 sont accessibles au public ainsi que la réanalyse ERA5. L'évaporation GLEAM et les précipitations GPCC sont également mises à disposition.
Articles connexes
Quelle évolution de la demande en eau d’ici 2050 ? (France Stratégie)
Impact du changement climatique sur le niveau des nappes d'eau souterraines en 2100
La moitié des pays du monde ont des systèmes d'eau douce dégradés (ONU-PNUE)
Une cartographie réglementaire incohérente menace silencieusement les rivières et les ruisseaux
Progrès en matière d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène dans les écoles (2015-2023)
Connaître l'état des eaux souterraines de l'Union européenne (projet Under the Surface)
L'évaporation des lacs dans le monde : une tendance à la hausse
Nappes d'eau souterraine : bilan de l’évolution des niveaux en 2022-2023 (BRGM)
Conflits liés à l'eau : les prévisions du site Water, Peace and Security
Un atlas mondial pour estimer les volumes d’eau des glaciers
Rapport mondial des Nations Unies 2019 sur la mise en valeur des ressources en eau
Etudier les risques de pénurie d'eau dans le monde avec l'Atlas Aqueduct du WRI
-
sur Voyager avec Michel Sivignon
Publié: 25 January 2025, 6:14pm CET par r.a.
Ce texte du géographe Amaël Cattaruzza a été lu le 9 novembre 2024 par son auteur lors de l’hommage au géographe Michel Sivignon (1936-2024) organisé à l’Institut de géographie de Paris par l’association Les Cafés géographiques.
Contrairement à mes collègues (Julien Thorez et Jean Gardin), j’ai rencontré Michel Sivignon un peu plus tardivement après la soutenance de ma thèse. Je connaissais évidemment ses travaux sur la Grèce et les Balkans. Mais je n’avais pas eu l’occasion de le rencontrer réellement. Ma première vraie rencontre et discussion avec lui date d’un café géopolitique sur les Balkans organisé le 1er février 2007. A la fin de la conférence, on commence à discuter. Il me parle de son projet d’ouvrage sur la géopolitique des Balkans fondé sur son expérience de la Yougoslavie socialiste. Ce qui était très agréable pour moi, jeune docteur, c’était la simplicité et la proximité qu’il introduisait tout de suite avec ses interlocuteurs. On était tout de suite rassuré et en confiance. Et il avait un vrai talent de conteur, par rapport à son expérience des Balkans. Le courant est donc tout de suite passé. Et dans le fil de la discussion, il me demandait s’il serait possible de venir observer la situation des Balkans post-conflit avec moi.
A cette époque, j’étais en poste à l’Ambassade de France en Serbie et vivais à Belgrade. Je lui propose de l’inviter à intervenir à Belgrade et j’évoque aussi un voyage possible à Sarajevo et à Mostar en Bosnie-Herzégovine. Donc, très vite, on se met d’accord sur une date et un mois plus tard, je le reçois à Belgrade, avec un petit périple programmé en Bosnie-Herzégovine. Je garde du séjour que nous avons passé ensemble un souvenir ému, car voyager avec Michel, ce n’était pas simplement faire du terrain avec un collègue, c’était voyager avec un ami, et c’était partager une expérience humaine, car il avait une capacité à faire des rencontres qui était impressionnante. Dans toutes les situations, à tous les endroits, il pouvait engager une discussion avec un chauffeur de taxi, un marchand ambulant, ou un simple passant. Et tout était prétexte à échange. Enfin, voyager avec Michel, c’était aussi voir un géographe à l’œuvre. Je me souviens que tous les soirs, il passait, seul, une petite heure à restituer la journée sur un carnet de voyage et à constituer des notes de terrain dont je découvrirais plus tard quelques extraits dans son ouvrage Les Balkans. Une géopolitique de la violence (Belin, 2009).
Fin mars 2007, il arrivait donc chez moi à Belgrade. J’avais organisé une rencontre avec les collègues géographes de l’Université, en particulier Mirko Grcic, professeur de géographie politique avec qui nous avons fait un grand tour de la ville, observant la citadelle de Kalemegdan et surtout le centre-ville, avec les bâtiments détruits par l’Otan de l’ancien Ministère de la défense et les bâtiments de Radio Televizija Srbija. Je me souviens fort bien de la discussion que je traduisais entre le professeur Grcic et Michel, autour de l’histoire de la ville et des conflits récents. Je découvrais là à quel point Michel était de fait très sensible à ces moments d’échanges qui constituaient pour lui, je pense, l’une des grandes motivations du voyage, et je sentais qu’il prenait un vrai plaisir à dialoguer avec son collègue. Et de fait, en relisant l’ouvrage, je retrouve à différents endroits des analyses issus des discussions dont j’ai été l’interprète – avec cette capacité qu’il avait de se faire le traducteur en quelques mots de l’espace vécu par les différentes communautés.
Après Belgrade, la région la plus passionnante du voyage restait encore la Bosnie-Herzégovine, Sarajevo et Mostar, villes divisées auxquelles il a consacré des chapitres entiers dans son ouvrage. Et cette partie du voyage commençait par le bus de nuit que nous sommes allés prendre à la gare routière de Belgrade. Ce trajet fut épique dans un bus bondé, où la musique folklorique turbo-folk nous a accompagné pendant les 6h de route. A 4h du matin, nous arrivions, sans avoir pu fermer les yeux de la nuit, dans la partie serbe de Sarajevo. Je m’inquiétais évidemment de la fatigue et des conditions de voyage, et regrettais de ne pas avoir pris ma voiture, mais Michel affichait toujours sa bonne humeur habituelle, et semblait ravi d’avoir entrepris ce périple.
Nous commencions notre voyage dans la Bosnie divisée, où nous avons passé quelques jours – à Sarajevo et à Mostar. Je me souviens de sa surprise dès l’arrivée dans le Sarajevo serbe, à 4h du matin, littéralement au milieu de nulle part – quand il a fallu trouver un taxi pour être accompagné dans la partie bosniaque de la ville, où se trouve le centre-ville et où nous avions notre hôtel. Nous expérimentions de fait dès notre arrivée la frontière interne de la ville sur laquelle il allait écrire de longs passages dans son livre. De fait, je sentais sa curiosité s’éveiller lors de nos périples dans ces deux villes, très surprenantes du fait de la division très nette entre les différentes communautés.
Dans le chapitre qu’il consacre dans son ouvrage aux villes divisées, j’ai eu la surprise de découvrir des encadrés avec quelques-unes de ses notes de terrain. Là aussi ces notes sont parlantes. Ainsi, en quelques mots, il restitue l’essence de la structure de Mostar et de sa géographie divisée, à plusieurs niveaux, tout en restant sensible au vécu de ses habitants.
Et sur Sarajevo, il rend compte d’une anecdote très parlante qui nous est arrivée lors de notre retour à Belgrade. Dans la ville divisée de Sarajevo, nous avions réservé notre bus de retour à 23h – toujours le bus de nuit – vers Belgrade. Mais par erreur, j’amenais Michel dans la gare de Sarajevo bosniaque, et non dans la gare de Srpsko Sarajevo.
Voilà pour mon expérience de voyage avec Michel. J’ai entretenu par la suite une relation qui, si elle n’était pas régulière, était toujours très sincère, très fidèle à ce qu’il était, c’est-à-dire simple, directe et bienveillante. Je lui suis toujours très reconnaissant d’avoir pris soin de relire les épreuves de l’ouvrage issu de ma thèse, qu’on avait d’ailleurs commencé à relire ensemble lors de ce voyage, et je me souviens encore de sa rigueur, et de son œil aiguisé et précis, lorsqu’il s’agit de relecture scientifique.
Au final, voyager avec Michel, c’était cela. Voyager avec un ami, toujours sensible aux événements du quotidien, prêt à s’intéresser à tout, pour en tirer plus qu’une anecdote, une information géographique sur l’esprit des lieux, les ressentis des habitants. Il avait dans ses échanges une vraie empathie, et savait mettre à l’aise ses interlocuteurs. Cela faisait de lui un observateur sensible sur le terrain, et nous permettait de vivre des rencontres et des expériences humaines fortes.
Amaël Cattaruzza, 9 novembre 2024
-
sur L’exploration des grands fonds marins : pour quoi et comment ? « Les Mardis de la mer » à l’ICP, 14 janvier 2025
Publié: 25 January 2025, 6:07pm CET par r.a.
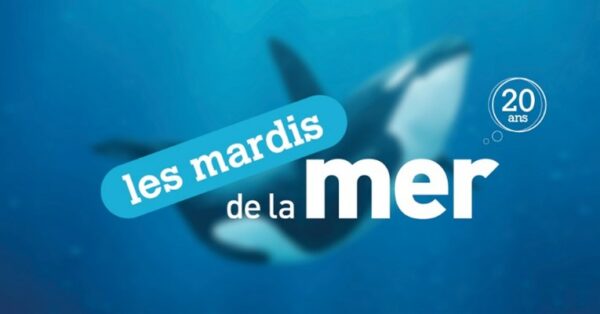
La découverte des grands fonds marins nourrit autant l’imaginaire des poètes que des chercheurs chez qui le mythe de l’Atlantide trouve encore quelque écho. Ils gardent encore beaucoup de leurs mystères malgré les grands progrès accomplis depuis l’époque du capitaine Nemo. Pour nous en dévoiler quelques-uns, l’ICP reçoit ce mardi 21 janvier 2025 deux représentants d’Abyssa, compagnie française d’exploration des grands fonds sous-marins, fondée en 2019 : son président Jean-Marc Sornin, titulaire d’une thèse de géologie marine et ancien chercheur à l’IFREMER, et Carla Frier.
Pour quoi et pourquoi s’intéresser à ces grands fonds où la lumière ne pénètre pas ?Profiter de leurs richesses potentielles constitue une première réponse. Ces richesses sont d’abord biologiques avec plus de 5000 espèces répertoriées. Elles sont aussi minérales. Nodules polymétalliques, sulfures polymétalliques, terres rares suscitent bien des convoitises depuis plusieurs décennies. Mais toute activité se déroulant dans les grands fonds est supervisée par l’Agence internationale des fonds marins (1), créée en 1994 sous l’égide de l’ONU. C’est elle qui délivre les licences d’exploration-hors ZEE (2) des ressources minérales (manganèse, cobalt, cuivre, nickel) considérées comme « bien commun de l’humanité ».
Pour mieux protéger les grands fonds qui sont des milieux fragiles, on a besoin de mieux les connaître. C’est aussi le besoin d’une gestion durable qui motive leur exploration.
Avec son immense domaine maritime mondial, 11 millions de km2 répartis sur quatre océans (2ème rang mondial), la France joue un rôle important dans le domaine de la protection marine. Son savoir-faire date des années 1960/1970. Aussi l’IFREMER (3) a-t-il obtenu les premiers contrats d’exploration. Mais aujourd’hui les moyens alloués à cette activité semblent diminuer (la suppression d’un secrétariat à la mer dans le gouvernement Bayrou actuel (4) en est un signe inquiétant). Par manque de moyens notre pays risque de connaître un décrochage scientifique.
Quels moyens utiliser pour connaître les grands fonds ?
Jean-Marc Sornin fait un bref rappel historique.
Dès le 15ème siècle, les navigateurs portugais et espagnols sont capables de mesurer la température des océans, ce qui ne permettait pas de dresser des cartes sous-marines. Ce n’est qu’au 19ème siècle que sont réalisées les premières cartes des fonds marins et au début du 20ème siècle les cartes bathymétriques (5). En 1977 l’Américaine, Marie Tharp, cartographe, océanographe et géologue, publie la première carte mondiale de la topographie des fonds océaniques.
Comment mesure-t-on la profondeur des eaux ?
De l’Antiquité au 19ème siècle, on a utilisé des plombs de sonde. Aujourd’hui les outils de mesure sont nombreux, tels les carottiers multitubes, les enregistreurs acoustiques, les sonars et sondeurs multifaisceaux qui permettent de faire des mesures bathymétriques mais aussi de mesurer les anomalies magnétiques, la température et la fluidité des eaux, les courants.
Les caméras vidéo sont d’un grand intérêt pour les biologistes et les drones sous-marins permettent une approche multi-échelle (à différentes profondeurs). Un exemple nous est donné par l’exploration du parc naturel corse à l’aide de drones qui sont descendus jusqu’à moins 2500 m. On a pu ainsi réaliser une cartographie du fond et découvrir de nouvelles espèces. L’objectif de tels travaux est de protéger et surveilles les zones naturelles.
Pour l’étude des grands fonds, la France offre un contexte porteur. A la recherche académique produite par plusieurs Instituts et Universités s’associent un écosystème entrepreneurial riche (une centaine d’entreprises) et le soutien des pouvoirs publics (cf. le plan de relance de 2020).
Notes :
1-L’AIFM (Association internationale des fonds marins) comprend des Etats défendant un moratoire d’exploitation, comme la France et le Costa Rica, et d’autres favorables à l’exploitation des ressources minières comme la Chine, le Japon et l’Inde (les terres rares utilisées pour favoriser la transition énergétique sont particulièrement visées).
2-ZEE (zone économique exclusive) : espace maritime situé entre les eaux territoriales et les eaux internationales, sur lequel l’Etat riverain exerce sa souveraineté et dispose des ressources naturelles.
3-IFREMER : Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer
4-Le poste est intégré dans un grand ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.
5-Cartes bathymétriques : cartes mesurant les profondeurs des océans et des mers et donc représentant la topographie des fonds marins.
Michèle Vignaux, janvier 2025
-
sur Carte cosmographique jaïne du continent de la pomme rose
Publié: 25 January 2025, 7:23am CET
Source : A Jain Cosmographic Map of the Rose?Apple Continent [Carte cosmographique jaïne du continent de la pomme rose], Leventhalmap.org
Le Leventhal Map and Education Center consacre une très belle storymap à une carte cosmographique issue du jaïnisme. Le jaïnisme, religion née en Inde au Ve siècle avant notre ère, met la connaissance au cœur de la foi. Elle s’est interrogée sur la place de l’homme dans le monde en développant une cosmologie détaillée, véritable pilier de son enseignement. Les cartes cosmographiques, peintes sur tissu, représentent le plus souvent le monde médian où vivent hommes et animaux. C'est celui qui a reçu le plus d’attention car c’est le lieu où l’on peut atteindre la délivrance. Des textes canoniques le décrivent avec précision et des peintures viennent lui apporter un support visuel. Ses cartes figurent parfois dans les manuscrits des traités consacrés à l’astronomie et à la cosmologie, disciplines, avec les mathématiques, qui ont toujours fait partie des bases de l’enseignement au sein des communautés monastiques jaïnas (Balbir & Petit, 2018).
Carte du continent des pommiers roses, XIXe siècle, Gujarat, Inde (source : collection MacLean SID 25250)

Autour du mont Meru, une haute montagne décrite aussi dans la mythologie brahmanique, se déploie l’île du Pommier rose (Jamb?dv?pa), qui désigne le continent indien pour les jaïnas, entourée par l’océan de Sel (Lava?asamudra). Au centre, le disque jaune bordé de rouge porte l'inscription Meru en écriture devanagari. Touchant à peine le disque jaune central se trouvent les quatre montagnes Gajadanta, littéralement en forme de « défenses d'éléphant », qui entourent le mont Meru. Les motifs géométriques reproduits de manière symétrique rappellent la technique des mandalas.
La collection MacLean possède deux autres cartes du XIXe siècle représentant les deux continents et demi (Adaidvipa) où le continent de la pomme rose (Jambudvipa) se trouve au centre. Ces deux cartes ont été peintes sur tissu et ont probablement été réalisées au Gujarat, en Inde.
Pour aller plus loin
Nalini Balbir, Jérôme Petit. La cosmologie jaïna. Revue de la Bibliothèque nationale de France, 2018, 56, pp.136-143. [https:]]
Jainpedia, the Jaine Universe online, [https:]]
L'Adaidvipa pata, carte cosmographique jaïn montrant les deux continents et demi (Adaidvipa) du monde médian (Wikipédia)
A?h??dv?pa. Peinture cosmologique jaïna. Gallica, [https:]]
Articles connexes
L'histoire par les cartes : Le Monde vu d’Asie, une histoire cartographique
L'histoire par les cartes : les représentations cartographiques de Kyoto pendant la période Tokugawa (1603–1868)
L'histoire par les cartes : la carte retraçant les voyages du navigateur chinois Zheng He au XVe siècle en version interactive
La Lémurie : le mythe d'un continent englouti. La cartographie entre science et imaginaire
Expositions du Leventhal Map and Education Center
Story maps et autres cartes narratives
Cartes et atlas historiques
Projections cartographiques
-
sur Bilan 2024, voeux 2025
Publié: 24 January 2025, 2:00pm CET
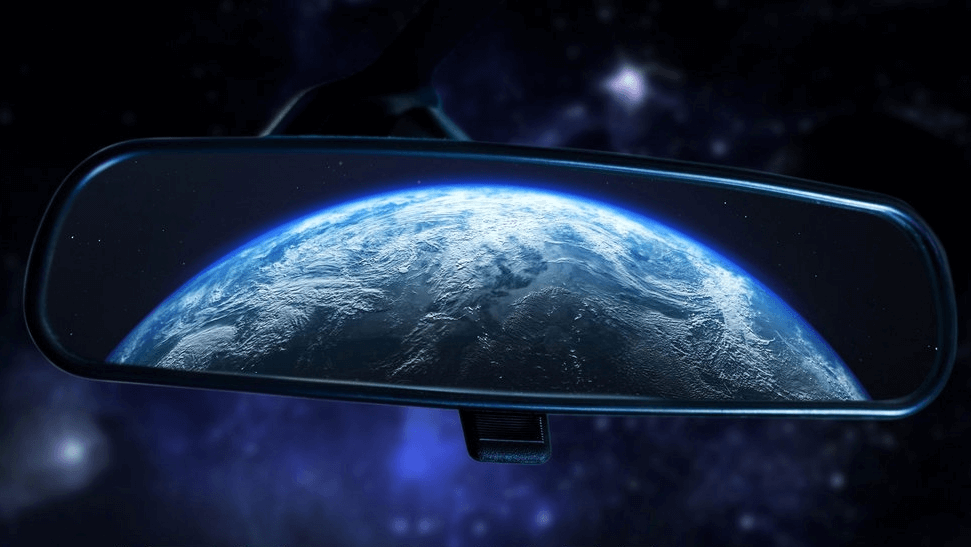 Dans un monde rythmé par les invectives, place à une rétrospective et des perspectives. Coup d'oeil dans le rétro 2024 avant de regarder la route 2025.
Dans un monde rythmé par les invectives, place à une rétrospective et des perspectives. Coup d'oeil dans le rétro 2024 avant de regarder la route 2025.
-
sur Densité du trafic maritime mondial et effets sur le réchauffement climatique
Publié: 23 January 2025, 5:49pm CET
Source : Nikos Benas, Jan Fokke Meirink, Rob Roebeling, « Tracking the impact of shipping pollution on Earth's climate », 2024 (Eumetsat).Les observations par satellite révèlent comment la pollution maritime affecte les nuages, les effets locaux ayant des répercussions de grande envergure à l'échelle de la planète. L'Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques (EUMETSAT) a consacré en février 2024 un article à la question de la pollution engendrée par le trafic maritime. Les traces de navires couvrent de grandes parties du globe et sont généralement concentrées dans des couloirs. La plupart de ces couloirs de navigation se situent dans l’hémisphère nord, comme ceux qui longent les côtes d’Asie, d’Amérique du Nord et d’Europe, ou ceux qui traversent l’océan Pacifique.
Carte mondiale des émissions de dioxyde de soufre (SO?) du transport maritime international en 2010
(source : Eumetsat)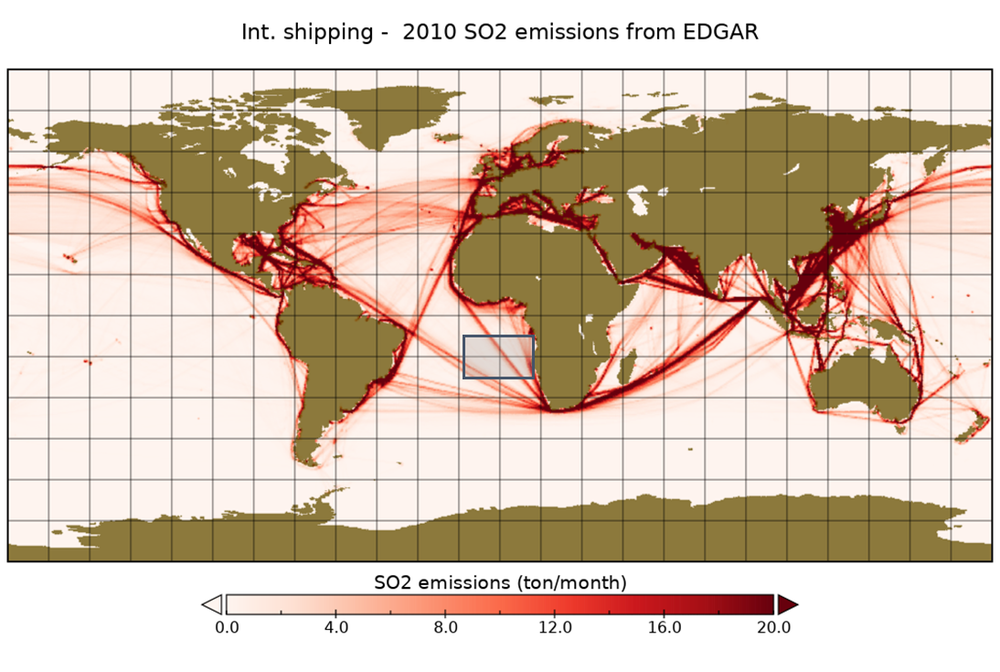 Les données satellitaires sont l'une des rares sources d'information disponibles pour étudier l'effet du transport maritime sur les nuages ??et le bilan énergétique de la Terre. Les auteurs ont pu comparer les propriétés des nuages ??affectés par les aérosols de combustion avec celles des nuages ??non affectés, à partir d'un ensemble de données sur l'Afrique et l'Europe sur une période allant de 2004 à nos jours. L'étude confirme un signal clair de l'effet du transport maritime sur les nuages ??au-dessus du corridor.
Les données satellitaires sont l'une des rares sources d'information disponibles pour étudier l'effet du transport maritime sur les nuages ??et le bilan énergétique de la Terre. Les auteurs ont pu comparer les propriétés des nuages ??affectés par les aérosols de combustion avec celles des nuages ??non affectés, à partir d'un ensemble de données sur l'Afrique et l'Europe sur une période allant de 2004 à nos jours. L'étude confirme un signal clair de l'effet du transport maritime sur les nuages ??au-dessus du corridor.En 2020, l'Organisation maritime internationale (OMI) a imposé de nouvelles réglementations visant à limiter l'utilisation du soufre dans le carburant des navires (IMO sulphur Limit 2020 for Ships Fuel Oil). Ces réglementations suggèrent que la réduction des émissions d'aérosols de combustion des navires a diminué la luminosité des nuages ??au-dessus des couloirs de navigation et, par conséquent, a pu affecter les températures mondiales. Depuis l'introduction des nouvelles réglementations, les nuages ??au-dessus du corridor de navigation ont des gouttelettes plus grosses qu'auparavant. Ce résultat est une indication claire de ce qui peut être réalisé en peu de temps avec des réglementations ciblées. Bien que les changements observés dans la région semblent confirmer le premier effet indirect des aérosols, ces résultats doivent être traités avec prudence. Comme la période d'application de la nouvelle réglementation ne couvre que trois ans (2020-23) et que l'augmentation observée du rayonnement solaire n'est pas directement imputable au corridor de navigation, il faudra conduire l'analyse sur davantage d'années avant de pouvoir en tirer des conclusions plus définitives. Les satellites du futur (radiomètre de température de surface de la mer et des terres de Sentinel-3 et imageur météorologique METImage) aideront à mieux surveiller les nuages ??de basse altitude à l'échelle mondiale.
Les données Meteosat sur la période 2004 à aujourd'hui sont issues du Climate Monitoring Satellite Application Facility (CM SAF). Les données sur la densité du trafic maritime mondial sont issues d'une collaboration entre la Banque mondiale et l'Organisation maritime internationale (OMI), dérivées des positions horaires des navires reçues par le système d'identification automatique (AIS) entre janvier 2015 et février 2021.
Pour compléter
« Y-a-t-il un lien entre la baisse des émissions de SO? des navires et les hausses de températures en Atlantique Nord ? » (Source : Citepa)
Le 3 juillet 2023 a été publié un article du site spécialisé Carbon Brief, repris par le World Economic Forum, écrit par les chercheurs Zeke Hausfather et Piers Forster, qui s’intéresse à l’impact des réductions d’émissions de SO? des navires sur le réchauffement climatique. Le 1er août 2023, un communiqué de l’agence européenne Copernicus (programme de l’UE pour l’observation et la surveillance de la Terre) a aussi publié un communiqué sur cette question. Les oxydes de soufre ont indirectement une action de refroidissement climatique car ils servent de noyaux de nucléation à des aérosols dont l’albédo est assez élevé. Les aérosols, en diffusant, réfléchissant ou absorbant la lumière du soleil, réduisent la quantité de rayonnement solaire atteignant les couches inférieures de l’atmosphère. Le SO? peut donc avoir un effet indirect refroidissant. Le Giec considère qu’il y a certes « des preuves solides indiquant un effet négatif significatif des aérosols sur le forçage radiatif » [autrement dit un effet refroidissant] mais qu’il reste « des incertitudes considérables » (source : Giec, AR6, WG1, Ch.7, section 7.3.3.4).
Il est donc possible que, pendant des années, les aérosols soufrés engendrés par les émissions de SO? des navires aient atténué une partie du réchauffement climatique induit par les émissions de gaz à effet de serre par ailleurs. La réduction drastique des émissions de SO? associée à la mesure dite OMI-2020 aurait alors pu réduire cet effet de refroidissement et donc donner un effet d’accélération au réchauffement, en particulier en Atlantique Nord. Les experts de Copernicus indiquent que le rôle du SO? dans le changement climatique fait l’objet de débats depuis longtemps, et qu’il n’y a pas encore de consensus clair. Ils rappellent cependant que, d’après les travaux de chercheurs chinois publiés en 2022, le transport maritime international ne serait responsable que d’environ 3,5% des émissions mondiales de SO?.Articles connexes
CLIWOC. Une base de données climatologiques des océans à partir des journaux de bord des navires (1750-1850)
Global Fishing Watch, un site pour visualiser l'activité des navires de pêche à l'échelle mondiale
Cartes et données sur l'impact de la pêche sur les écosystèmes marins (Sea Around Us)
Vers de possibles variations dans la répartition des stocks de poissons (dans et hors ZEE) en raison du changement climatique
Une carte réactive de toutes les ZEE et des zones maritimes disputées dans le monde
Le site Marine Traffic permet de visualiser la densité des routes maritimes
Shipmap, une visualisation dynamique du trafic maritime à l'échelle mondiale
OpenSeaMap, la cartographie nautique libre
40 ans de piraterie maritime dans le monde (1978-2018) à travers une carte interactive
Entre maritimisation des échanges et mondialisation de l'information : de quoi l’incident de l'Ever-Given est-il le nom ?
L'effondrement du pont de Baltimore : quels effets sur le commerce maritime mondial ?
Calculer le bilan carbone de nos déplacements aériens
-
sur Webinaire « Les défis de la mise à jour des PCRS raster et vecteur » le 6 février 2025
Publié: 23 January 2025, 5:09pm CET
Webinaire « Les défis de la mise à jour des PCRS raster et vecteur » le 6 février 2025
-
sur [Equipe Oslandia] Thomas Muguet, développeur SIG
Publié: 23 January 2025, 6:24am CET par Caroline Chanlon
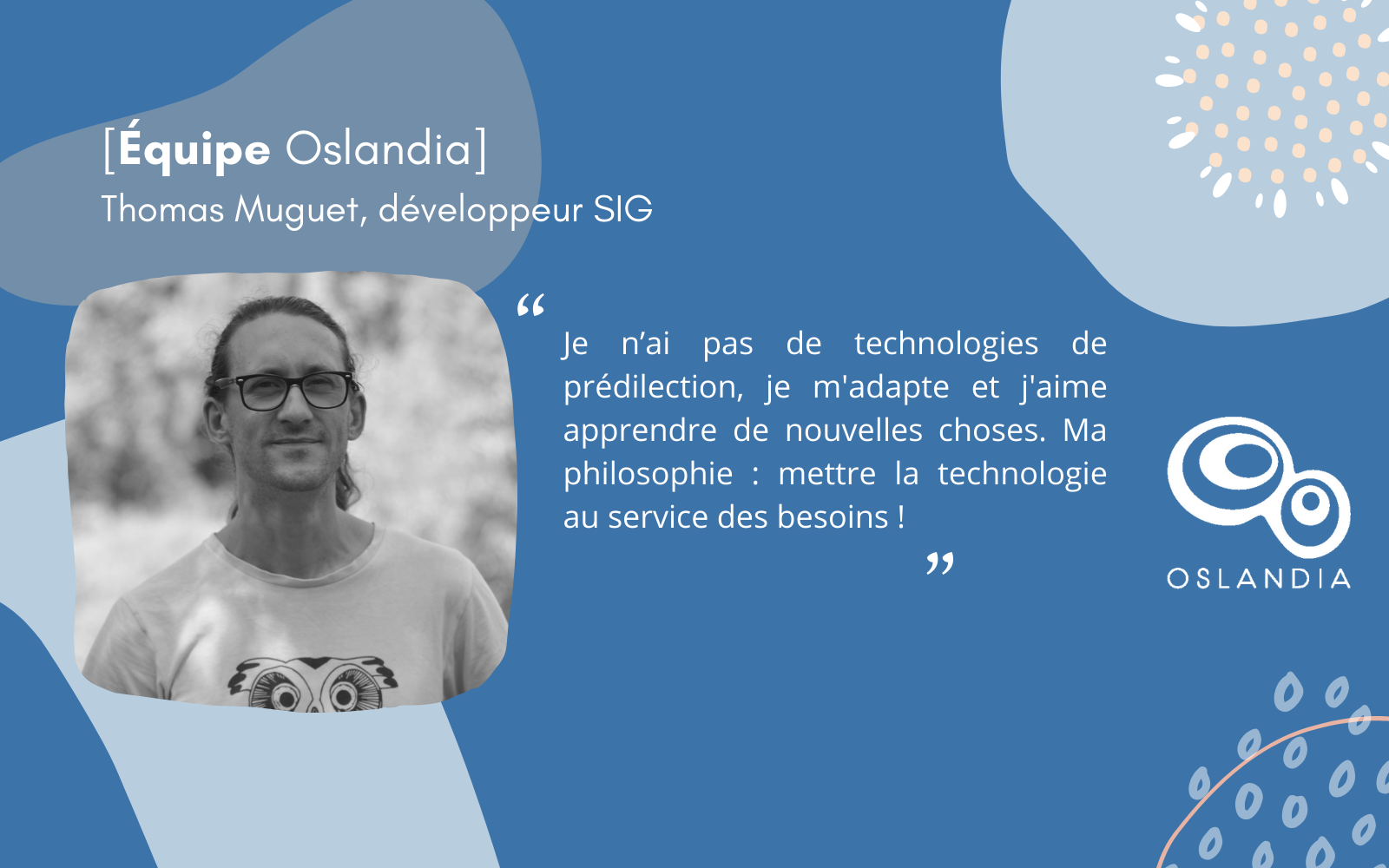
Né à Grenoble, c’est par coïncidence que Thomas revient dans sa ville natale pour entrer en école d’ingénieur en informatique et mathématiques appliquées à Grenoble INP – Ensimag puisqu’il passe son enfance à Chicago aux USA jusqu’à ses 6 ans puis en banlieue parisienne jusqu’à sa classe prépa.
Lui qui se destinait à être vétérinaire et fait d’ailleurs une première année pour exercer ce métier, se tourne vers une toute autre voie et revient dans les montagnes.
« Pendant mes études j’ai fait beaucoup d’informatique et j’ai découvert le champ des possibles de ce domaine. »
Diplôme en poche, Thomas multiplie les expériences : d’abord dans une ESN grenobloise pendant 3 ans puis dans la start-up Movea où il a pour mission de fournir les outils logiciels nécessaires aux autres équipes de R&D, et finit par assurer la fonction de Scrum master. Il vit le rachat de la start-up par une entreprise américaine puis par l’entreprise japonaise TDK, et passe ainsi de 50 à des milliers de collègues.
« J’ai évolué en même temps que la croissance de l’entreprise, puis j’avais envie de me lancer dans un autre projet »
Thomas rejoint la start-up upOwa qui installe des panneaux solaires au Cameroun, en tant que DSI pour travailler sur la stratégie de l’entreprise.
« Je passais près de 40% de mon temps au Cameroun car toutes les équipes étaient là bas, et le reste du temps en télétravail. »
Le covid passe et les possibilités de déplacement se réduisent…
Thomas avait gardé en tête le Podcast « Libre à vous » de l’April où il entend Vincent s’exprimer sur l’open source. Quelques mois plus tard, il envoie une candidature spontanée, c’était il y a 3 ans !
« J’ai tout de suite senti que je pourrais m’épanouir personnellement, l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle est privilégié chez Oslandia. »
Thomas est un couteau suisse : le web et la 3D, infrastructure et DevOps, sans oublier le volet base de données.
Projets emblématiquesPiero, l’application Web 3D SIG/BIM open source qu’il a principalement développée.
Une application web pour la gestion des travaux d’installation et de maintenance de la fibre pour une société qui pose de la fibre optique en Afrique de l’Est.
Technologies de prédilection« Je n’en ai pas vraiment ! je m’adapte et j’aime apprendre de nouvelles choses. »
Ta philosophieMettre la technologie au service des besoins.
Oslandia en 1 motÉpanouissement !
-
sur Cshapes 2.0, un jeu de données SIG pour visualiser l'évolution des frontières de 1886 à 2019
Publié: 22 January 2025, 7:12pm CET
CShapes 2.0 est un jeu de données SIG qui cartographie les frontières des États et des territoires dépendants de 1886 à 2019. Il s'appuie sur le jeu de données précédent et l'améliore en étendant la couverture temporelle de 1946 à l'année 1886 (suite à la Conférence de Berlin sur le partage de l'Afrique) et en cartographiant les frontières des colonies et autres dépendances. Le jeu de données est fourni par site de l'École polytechnique fédérale de Zurich dans le cadre de travaux de recherche conduits sur les conflits internationaux.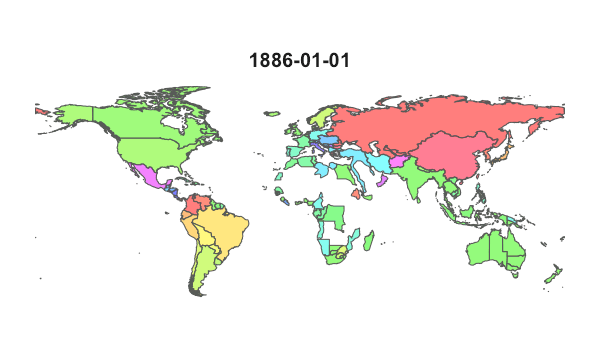 Il existe deux versions de l'ensemble de données, basées sur le codage de Gleditsch et Ward (1999) ou sur le codage Correlates of War des États indépendants. Les changements de frontières ont été codés sur la base de l'ensemble de données Territorial Change Dataset de Tir et al. (1998), de l'Encyclopedia of International Boundaries de Biger (1995) et de l'Encyclopedia of African Boundaries de Brownlie (1979). L'ensemble de données peut être téléchargé dans divers formats et est également accessible via le package R CShapes.
Il existe deux versions de l'ensemble de données, basées sur le codage de Gleditsch et Ward (1999) ou sur le codage Correlates of War des États indépendants. Les changements de frontières ont été codés sur la base de l'ensemble de données Territorial Change Dataset de Tir et al. (1998), de l'Encyclopedia of International Boundaries de Biger (1995) et de l'Encyclopedia of African Boundaries de Brownlie (1979). L'ensemble de données peut être téléchargé dans divers formats et est également accessible via le package R CShapes.
La version actuelle de CShapes peut être facilement consultée via le visualiseur interactif CShapes ou via le format pays-année prêt pour la recherche fourni par le portail GROW Research Front-End.
Le package R CShapes permet d'accéder facilement aux données de l'environnement statistique R. Vous pouvez également télécharger la dernière version (2.0) des données brutes CShapes directement au format CSV, TXT, GeoJSON, Shapefile, SQL et package R.
Le jeu de données, disponible en open data, est largement réutilisé notamment par des cartographes ou des journalistes (voir par exemple cette brève histoire de la Syrie en cartes par The Economist).
Pour en savoir plus :
Schvitz, Guy, Seraina Rüegger, Luc Girardin, Lars-Erik Cederman, Nils Weidmann et Kristian Skrede Gleditsch. 2022. Mapping The International System, 1886-2017: The CShapes 2.0 Dataset. Journal of Conflict Resolution 66(1): 144–61.
Carl Muller-Crepon, Guy Schvitz, Lars-Erik Cederman. 2022. Shaping States into Nations: The Effects of Ethnic Geography on State Borders.
Articles connexes
Quand les cartes révèlent les frontières fantômes
Frontières et groupes ethniques à travers le monde
Frontières et conflits en Afrique du Nord et de l’Ouest
Les frontières maritimes des pays : vers un pavage politique des océans ?
Comment les frontières politiques façonnent les paysages. Une série d’images satellites Planet en haute résolution
Un jeu de données SIG sur les fleuves qui servent de frontières dans le monde
Jeu de données SIG sur le classement des métropoles mondiales
Données SIG sur les écorégions terrestres
Fonds de cartes pour utiliser dans un SIG
-
sur Travailler avec du JSON et PostgreSQL
Publié: 21 January 2025, 2:00pm CET
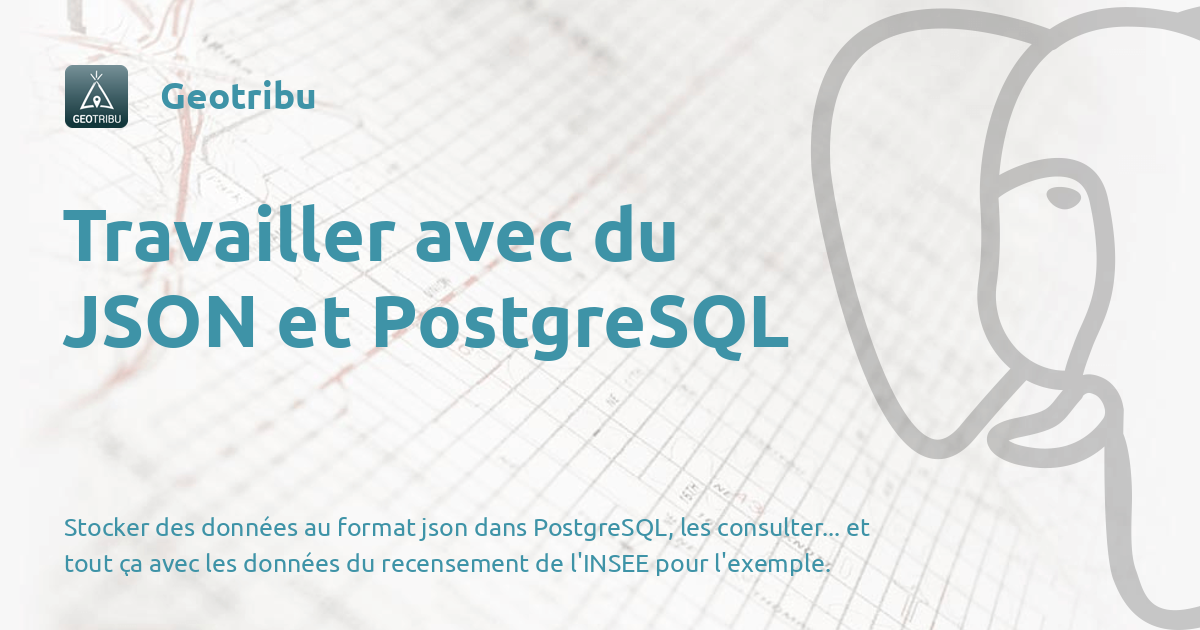 Stocker des données au format json dans PostgreSQL, les consulter... et tout ça avec les données du recensement de l'INSEE pour l'exemple.
Stocker des données au format json dans PostgreSQL, les consulter... et tout ça avec les données du recensement de l'INSEE pour l'exemple.
-
sur Émissions CO? de la consommation électrique en temps réel (Electricity Maps)
Publié: 21 January 2025, 12:38pm CET
La mission d'Electricity Maps est d'organiser les données sur l'électricité mondiale pour favoriser la transition vers un système électrique véritablement décarboné. Le site de cette société fournit des données sur l'intensité carbone provenant de la consommation d'électricité de plus de 200 pays ou régions dans le monde.
Émissions CO? de la consommation électrique en temps réel (source : Electricity Maps)

La carte fait apparaître en vert les pays qui produisent une électricité moins carbonée du fait de leur choix de développer l'énergie hydroélectrique (Brésil, Norvège, Islande, Québec) ou l'énergie nucléaire (France). A l'opposé, en brun apparaissent les pays encore très dépendants des énergies fossiles pour la production de leur électricité (Allemagne, Pologne, Russie, Inde, États-Unis, Argentine). La carte peut varier en fonction du temps (cas des éloniennes ou du solaire qui fonctionnent davantage à certaines périodes de l'année). Il est possible de remonter jusqu'en 2017 pour mesurer les évolutions.
L'intensité carbone mesure le caractère propre de la consommation d'électricité dans une zone à un moment donné. Elle représente le nombre de grammes de dioxyde de carbone (CO?) libérés dans l'atmosphère pour chaque kilowattheure (kWh) d'électricité consommée.
En d'autres termes, l'intensité carbone représente l'empreinte carbone de 1 kWh consommé dans cette zone. Cette empreinte est mesurée en gCO?-eq (grammes d'équivalent CO?), ce qui signifie que chaque type de gaz à effet de serre peut être converti en son équivalent CO? en termes de potentiel de réchauffement climatique sur 100 ans (par exemple, 1 gramme de méthane émis a le même impact sur le réchauffement climatique pendant 100 ans qu'environ 34 grammes de CO? sur la même période). L'intensité carbone de la production d'électricité d'une zone est déterminée par le mix de production d'électricité et les facteurs d'intensité carbone associés. Il existe deux types de facteurs d'émission affichés sur la carte : les facteurs par défaut et les facteurs régionaux.
Les sources de données ayant servi pour la carte sont regroupées sur GitHub.
Pour compléter
« L’énergie solaire dépasse le charbon pour la première fois dans la production d’électricité de l’UE en 2024 » (Le Monde).
« Bilan de l'électricité européenne 2025 » (Ember). Le rapport sur l'électricité européenne analyse les données de production et de demande d'électricité pour l'année 2024 dans tous les pays de l'UE-27 afin de comprendre les progrès de la région dans la transition des combustibles fossiles vers l'électricité propre.
« Le charbon, une consommation toujours en hausse en dépit du changement climatique » (Géoconfluences).
« Comment le Royaume-Uni est devenu le premier pays du G7 à abandonner progressivement l'énergie au charbon » (CarbonBrief).Articles connexes
La cartographie des centrales électriques dans le mondeCartographie des projets de combustibles fossiles : comment réduire le risque de "bombes carbone" ?
Vers un registre mondial des combustibles fossiles
Calculer le bilan carbone de nos déplacements aériens
Les plus gros émetteurs directs de CO?, en France en 2019
Climate Trace, une plateforme pour visualiser et télécharger des données sur les émissions de gaz à effet de serre (GES)
Quand la lutte contre les émissions de CO? passe par la dénonciation des entreprises les plus concernées
L'empreinte carbone des villes dans le monde selon le modèle CGMCF
Le tourisme international et son impact sur les émissions de CO?
Quels sont les États qui ont le plus contribué au réchauffement climatique dans l’histoire ?
-
sur Valider les types énumérés Django en base de données
Publié: 21 January 2025, 9:30am CET par Paul Florence
Apprenez à mettre en place une contrainte SQL permettant de valider les types énumérés en base de données à l’aide de l’ORM Django.
-
sur Quelle évolution de la demande en eau d’ici 2050 ? (France Stratégie)
Publié: 20 January 2025, 6:59pm CET
Source : « Quelle évolution de la demande en eau d’ici 2050 ? » (France Stratégie, rapport janvier 2025).Dans un rapport publié le 20 janvier 2025, France Stratégie étudie plusieurs « trajectoires d’évolution » de la demande en eau. Les scénarios sont marqués par une « demande pour l’irrigation [qui] augmente fortement », l’agriculture se substituant au secteur énergétique comme « le premier préleveur avec environ un tiers des prélèvements ». Elle entraîne, dans presque toutes les configurations, une hausse des volumes consommés (c’est-à-dire non directement restitués au milieu) notamment pendant les mois les plus chauds, alimentant de futurs conflits d’usage.

Ce travail, commandé à l’automne 2023 par la Première ministre, étudie entre 2020 et 2050 les évolutions théoriques des prélèvements en eau et des consommations associées, c’est-à-dire la part des prélèvements évaporée, selon trois scénarios prospectifs. Le premier, appelé « tendanciel », prolonge les tendances passées. Le deuxième, baptisé « politiques publiques », simule la mise en place de politiques publiques récemment annoncées. Le troisième, dit « de rupture », se caractérise par un usage sobre de l’eau. Entre 2020 et 2050, dans la configuration climatique la plus défavorable étudiée, la demande annuelle stagne dans le scénario tendanciel (+ 1 %) et diminue dans les scénarios politiques publiques (- 24 %) et de rupture (- 47 %), notamment du fait de la baisse de la demande pour la production énergétique dans la vallée du Rhône. La demande pour l’irrigation augmente fortement et devient majoritaire. À la di érence de la production énergétique, l’irrigation consomme la majorité de l’eau prélevée en raison de l’évapotranspiration des plantes. Aussi les consommations augmentent-elles substantiellement dans les scénarios tendanciel (+ 102 %) et politiques publiques (+ 72 %). Dans ce dernier scénario, elles sont multipliées par plus de deux dans près d’un quart des bassins versants. Seul le scénario de rupture permet de contenir l’augmentation des consommations (+ 10 % par rapport à 2020) dans la configuration climatique la plus défavorable étudiée. Avec l’augmentation de la part de l’agriculture dans les prélèvements, la demande en eau sera davantage concentrée au cours des mois les plus chauds de l’année, quand la ressource en eau est au plus bas dans les milieux aquatiques. Une prochaine publication de France Stratégie quantifiera les tensions entre la ressource en eau disponible et cette demande.

À télécharger :
Note d'analyse 148 - Quelle évolution de la demande en eau d’ici 2050 ? - Janvier 2025)
Rapport - La demande en eau Prospective territorialisée à l’horizon 2050 - Janvier 2025)« Pour éviter de futurs conflits sur l’eau, il faudra moins en consommer, notamment dans l’agriculture, prédit France Stratégie » (Le Monde).
Articles connexes
Impact du changement climatique sur le niveau des nappes d'eau souterraines en 2100
Des changements multiformes dans la disponibilité en eau avec un climat plus chaud
La moitié des pays du monde ont des systèmes d'eau douce dégradés (ONU-PNUE)
Une cartographie réglementaire incohérente menace silencieusement les rivières et les ruisseaux
Progrès en matière d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène dans les écoles (2015-2023)
Connaître l'état des eaux souterraines de l'Union européenne (projet Under the Surface)
L'évaporation des lacs dans le monde : une tendance à la hausse
Nappes d'eau souterraine : bilan de l’évolution des niveaux en 2022-2023 (BRGM)
Conflits liés à l'eau : les prévisions du site Water, Peace and Security
Un atlas mondial pour estimer les volumes d’eau des glaciers
Rapport mondial des Nations Unies 2019 sur la mise en valeur des ressources en eauEtudier les risques de pénurie d'eau dans le monde avec l'Atlas Aqueduct du WRI
-
sur Étude d’aide à la décision stratégique et technique / R-GDS
Publié: 20 January 2025, 6:37am CET par Caroline Chanlon

Oslandia a réalisé en 2024 une étude d’aide à la décision stratégique et technique pour R-GDS, 1er distributeur de gaz naturel et de biométhane dans le Bas-Rhin, dans le cadre d’un remplacement futur de son SIG.
La prestation s’est portée sur la pertinence des outils OpenSource pour répondre aux besoins fonctionnels d’un exploitant de réseaux tout en prenant en compte les aspects budgétaires et organisationnels.

-
sur Une carte en relief de 13 000 ans révélée par une collaboration internationale
Publié: 20 January 2025, 3:34am CET
Source : « Une carte en relief de 13 000 ans révélée par une collaboration internationale mêlant archéologie, géologie et ingénierie » (Mines de Paris).
C’est en janvier 2025 que Médard Thiry, chercheur au centre de Géosciences de Mines Paris-PSL, et Anthony Milnes, chercheur à l’University of Adelaide, ont décrit une gravure datant de plus de 13 000 ans dans l’abri de La Ségognole 3, à Noisy-sur-École, en Seine-et-Marne, au sud de Paris. Cette gravure, identifiée comme la plus ancienne carte tridimensionnelle connue au monde, témoigne des capacités étonnantes des sociétés humaines du Paléolithique supérieur. Publiée dans l’Oxford Journal of Archaeology, cette étude révèle comment les humains préhistoriques utilisaient l’art et l’ingénierie pour représenter leur quotidien et leurs mythes [...]

L’abri de La Ségognole 3 est remarquable à plusieurs égards. En effet, il fait partie des trois seuls abris attribués au Paléolithique identifiés dans les grès de Fontainebleau. Ces abris constituent également les sites ornés paléolithiques les plus septentrionaux actuellement connus en Europe. Datant de la fin de la dernière glaciation, cet environnement se caractérise par des sols gelés pendant une grande partie de l’année. Les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur y établissaient de grands campements en bordure de la Seine, stratégiquement positionnés sur les routes migratoires des grands gibiers, essentiels à leur subsistance [...]
La comparaison des reliefs et des écoulements gravés sur le site avec les caractéristiques géomorphologiques de la vallée de l’École, où se situe l’abri, révèle une correspondance frappante. La terrasse correspond aux platières de grès, parsemées de mares et de zones humides, qui dominent la vallée. Le réseau d’écoulement gravé rappelle les vallées divagantes et marécages tels qu’ils existaient avant les aménagements humains, tandis que les dépressions dans la partie basse évoquent les marais et étendues d’eau libre qui ponctuaient autrefois la vallée.
Cette découverte ne constitue pas une « carte » au sens moderne, avec ses distances, directions et indications précises. Elle s’apparente plutôt à une représentation tridimensionnelle miniature, illustrant le fonctionnement d’un paysage. Pour les peuples du Paléolithique, la direction des cours d’eau et les caractéristiques fonctionnelles du terrain semblaient primordiales, bien davantage que nos concepts contemporains de distance ou de temps.
Les communautés du Paléolithique supérieur n’avaient probablement pas besoin de cette carte pour se repérer dans un paysage qu’elles pouvaient observer directement depuis le sommet de la colline. Alors, pourquoi un tel aménagement ? Cette représentation tridimensionnelle miniature pourrait avoir rempli plusieurs fonctions : un outil pour planifier des chasses en visualisant les déplacements des animaux en fonction du relief, un marqueur territorial pour signifier des zones d’importance stratégique ou symbolique, ou encore un support de transmission des connaissances entre membres du groupe ou générations [...]
Pour aller plus loin :
Thiry, M., and Milnes, A. (2024), Palaeolithic map engraved for staging water flows in a Paris basin shelter. Oxford Journal of Archaeology, [https:]]
Communiqué de presse de l’University of Adelaide : World’s oldest 3D map discovered, [https:]]Articles connexes
L'histoire par les cartes : la dalle ornée de Saint-Bélec, la plus ancienne carte d'Europe ?
Cartes : des plans sur la planète (émission Eurêka sur France Culture)
L'histoire par les cartes : l'Atlas historique mondial de Christian Grataloup (avec la revue L’Histoire)
L'histoire par les cartes : l'Atlas historique de la France (L'Histoire - Les Arènes)
L'histoire par les cartes
Cartes et atlas historiques
-
sur La carte des pays qui interdisent TikTok : une carte en constante évolution
Publié: 19 January 2025, 7:21am CET
TikTok est une application mobile de partage de courtes vidéos et d'images, ainsi qu'un réseau social, lancée en 2016. Développée par l'entreprise chinoise ByteDance pour le marché non chinois, l'application accessible en Chine est dénommée Douyin (soumise à la vision du Parti communiste chinois sur les contenus et sources appropriés). TikTok est rapidement devenue très populaire chez les jeunes internautes atteignant, selon la plate-forme, plus d'un milliard d'utilisateurs dont 22 millions d'utilisateurs actifs mensuels en France (source : Wikipédia).
Dans le monde, plusieurs pays restreignent ou interdisent TikTok pour différentes motifs moraux ou politiques. L'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, la Jordanie, le Kirghizstan, le Népal, la Somalie ont totalement prohibé l'application chinoise pour des raisons religieuses, pour ne pas « promouvoir l'obscénité » ou préserver « l'harmonie sociale ». Pour ce qui est des pays occidentaux, le réseau social chinois fait aussi l'objet de critiques. S'il n'y a pas d'interdiction au sens propre du terme, des restrictions sont mises en place principalement pour « protéger les enfants » ou pour « préserver la souveraineté nationale », TikTok étant soupçonné de collecter des données pour la Chine.
Le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l'UE, les trois principaux organes de l'UE, ont tous interdit TikTok sur les appareils de leur personnel, invoquant des problèmes de cybersécurité. En France, l'application a été suspendue temporairement par le gouvernement français en mai 2024 en Nouvelle-Calédonie lors d'émeutes meurtrières contre un projet de réforme électorale. Elle est interdite également pour les administrations publiques. D'autres pays comme la Belgique, le Canada, le Danemark, la Norvège, la Nouvelle-Zélande ou encore le Royaume-Uni interdisent l'utilisation de TikTok sur les appareils professionnels ou à leurs collaborateurs.
Pays qui ont interdit ou retreint TikTok (source : Wikipédia)

- En rouge : pays où l'interdiction est complète
- En orange : pays n'autorisant qu'une version locale
- En rose : pays où TikTok n'est plus disponible en téléchargement
- En jaune : pays où des interdictions sont prévues
- En bleu : pays avec interdiction partielle pour les administrations
- En violet : pays où il existe des interdictions de jure, mais qui ne sont pas appliquées de facto
Cette carte, datée de février 2023, pourrait bien évoluer dans les semaines et mois qui viennent (la catégorie en violet a été ajoutée le 20 janvier 2025 pour tenir compte des déclarations de Trump). La décision de la Cour suprême d’interdire complètement TikTok aux États-Unis à partir de janvier 2025 pour des raisons de sécurité nationale vient relancer le débat et lui donner une tournure nettement politique. Les États-Unis deviendraient le premier grand pays occidental à interdire purement et simplement la plateforme à tous ses concitoyens. D'habitude, ces restrictions sont principalement le fait de gouvernements non démocratiques (voir la carte Statista des pays qui bloquent les réseaux sociaux). Dans le monde, ce sont plus de 3 milliards de personnes qui sont peu ou prou interdites d'utilisation de TikTok (voir la liste détaillée des pays avec les motifs invoqués sur Wikipédia).
TikTok conteste les accusations selon lesquelles il recueille plus de données sur les utilisateurs que les autres entreprises de médias sociaux et a qualifié les interdictions de « désinformation fondamentale », affirmant qu'elles avaient été décidées « sans délibération ni preuve ». Alors qu’il voulait interdire TikTok aux États-Unis en 2020, Donald Trump se bat désormais pour que l’application ne disparaisse pas du territoire. Il faut dire que TikTok a grandement contribué au succès de Donald Trump dans sa campagne électorale auprès des jeunes. Le président américain a même invité Shou Chew, le patron de TikTok, à assister à son investiture, aux côtés des proches du républicain et d’officiels de haut rang. Il sera assis à côté d’autres dirigeants du secteur technologique dont Elon Musk, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos.
Les États-Unis sont loin de constituer l’unique marché du réseau social – il cumule aussi un grand nombre d’utilisateurs dans des pays comme l’Indonésie, le Brésil ou le Mexique, ainsi que dans de nombreux États européens. Entre 2023 et 2024, TikTok revendiquait par exemple 134 millions d’utilisateurs mensuels au sein de l’Union européenne et 325 millions en Asie du Sud-Est, contre 170 millions aux États-Unis. L’entreprise n’est pas cotée en Bourse et ne divulgue pas ses informations économiques essentielles mais, selon le Financial Times, les États-Unis représenteraient moins de 15 % de ses revenus mondiaux. En outre, Pékin gagnerait beaucoup à pouvoir dénoncer la censure de TikTok sur le territoire de son principal adversaire.
L’interdiction de TikTok sous couvert de « sécurité nationale » soulève de sérieuses questions sur les excès de pouvoir du gouvernement et leur impact sur la liberté d’expression. Elle est à replacer dans le débat sur l'influence des technologies et des réseaux de communication sur la vie quotidienne des citoyens. Elle interroge aussi la nature des liens entre États souverains et géants mondiaux de l'Internet. Twitter et Facebook véhiculent beaucoup de fake news et ne sont pas pour autant interdits par la justice américaine. Pour Florian Zandt, data journaliste qui a mis à jour sur Statista la carte des pays interdisant TikTok, « les critiques de la campagne en faveur d'une interdiction générale de TikTok affirment que les motivations sont soit une sinophobie latente, soit une limitation du soft power de la Chine dans une nouvelle guerre froide ».Sources
« TikTok, réseau social chinois de partage de vidéo » (Wikipédia). Une bonne synthèse sur l'histoire, le fonctionnement, les principaux motifs d'interdiction de TikTok (addictions, harcèlement et agressions, censure et propagande, désinformation, protection des données, sécurité des États...).
« Quels pays ont interdit TikTok et pourquoi ? ». Si les États-Unis seront probablement le premier pays à interdire purement et simplement TikTok, de nombreux autres pays s'inquiètent des liens entre la plateforme et la Chine (Euronews).
« TikTok banni aux États-Unis : comment Trump espère sauver l’application malgré la décision de la Cour suprême ». Alors qu’il voulait interdire TikTok aux États-Unis en 2020, Donald Trump se bat désormais pour que l’application ne disparaisse pas du territoire (Huffington Post).
« Dans le monde, quels sont les pays qui restreignent TikTok ? ». Dans le monde, plusieurs pays restreignent et interdisent TikTok. Pour la première fois en Europe, l'Albanie a décidé de bloquer le réseau social chinois dans son pays. (TV5 Monde).
« TikTok dans le viseur de la Commission européenne pour ses publicités visant les enfants ». La Commission souhaite que l’application phare des adolescents se conforme aux règles européennes en matière de publicités déguisées vis-à-vis des mineurs (Le Monde).
« Pour Thierry Breton, les géants d’Internet manipulent le concept de liberté de parole ». L’artisan de la législation européenne sur le numérique estime que les géants du web manipulent le concept de censure. Fake news, leur répond-il, l’Europe respecte de manière absolue la liberté de parole. (Ouest-France).
« L’étrange sauvetage de TikTok par Donald Trump ». A la lumière de l’affaire TikTok, il est difficile d’accuser l’Union européenne de vouloir limiter la liberté d’expression et brider l’innovation en régulant les plateformes américaines. Les Etats-Unis, eux, ne régulent pas, ils mettent au pas (Le Monde).
« Le concept de liberté d’expression est devenu une arme de guerre aujourd’hui, il a été complètement arsenalisé... La modération passe pour de la censure ». Asma Mhalla (Linkedin).
« Comment l'application TikTok échoue à protéger ses jeunes utilisateurs de la désinformation ». La viralité des contenus sur l'application de partage de vidéos facilite la diffusion de fausses informations auprès d'un public très jeune qui n'a, souvent, pas les armes pour démêler le vrai du faux (France Info).
« Dans les smartphones des écoliers : TikTok, ça nous rend fous… ». Plusieurs journalistes de l’AFP, membres de l’association Entre les lignes, ont animé des ateliers d’éducation aux médias dans des écoles primaires. Retour sur leur expérience. (Le Monde).
« Les ados ne vont pas sur TikTok uniquement par narcissisme ». Contrairement à d'autres réseaux sociaux, TikTok a un fort potentiel créatif (Slate).
« Blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie : retour sur un fiasco démocratique ». La théorie des « circonstances exceptionnelles » ne permet pas pour autant de sacrifier la liberté d’expression en ligne sur l’autel d’une sacro-sainte sécurité (La Quadrature du Net).
« L’ère TikTok : une histoire industrielle et politique ». Dans une enquête au long cours au cœur de la guerre des capitalismes politiques, Alessandro Aresu raconte l’histoire d’une plateforme qui a changé nos vies — et le basculement d’un monde dont la tiktokisation totale semble inévitable (Le Grand Continent).
« La TikTokisation du monde ». Cette plate-forme donne des sueurs froides aux autorités américaines et européennes. Mais ce n’est pas la seule raison qu’on peut avoir de s’inquiéter de TikTok. Le monde est en train de se « TikTokiniser », entendez par là que les modes et les manières d’exister sur la plateforme s’imposent dans tous les domaines de la vie sociale et culturelle (Serge Tisseron).
« X, Facebook et Instagram menacent nos écosystèmes d’information : quelles alternatives ? ». La tiktokisation (désinformation) du monde est en marche, mais elle concerne aussi les autres plateformes (The Conversation).
« Interdiction de TikTok : problèmes de sécurité ou sinophobie ? ». Alors que les autorités affirment qu'il n'est pas certain que le gouvernement chinois puisse extraire et utiliser les données des utilisateurs occidentaux de TikTok, ce qui pose un risque de sécurité très important, les critiques de la campagne en faveur d'une interdiction générale de TikTok affirment que les motivations sont soit une sinophobie latente, soit une limitation du soft power de la Chine dans une nouvelle guerre froide (Statista).
« Deepseek : un code caché envoie les données à une entreprise proche de l'armée chinoise, selon des chercheurs » (BFM-TV). La nouvelle IA chinoise DeepSeek est également dans le collimateur. Certains chercheurs en cybersécurité auraient découvert dans la version web de l’application que les informations collectées seraient renvoyées vers China Mobile qui appartient au pouvoir.
« Intelligence artificielle : pourquoi certains pays interdisent-ils l’IA chinoise DeepSeek ? » (Ouest-France). La Chine a dénoncé les restrictions récemment imposées par plusieurs pays, y voyant une « politisation des questions économiques, commerciales et technologiques ».
#TikTok pic.twitter.com/QySCA0SHE3
— Nick Anderson/Political Cartoonist (@Nick_Anderson_) January 17, 2025
Articles connexes
Ces pays qui bloquent les réseaux sociaux (Statista)
La carte, objet éminemment politique : les cartes de manifestations à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux
La carte, objet éminemment politique : le monde vu à travers les tweets de Donald Trump
Mesurer la liberté de la presse dans le monde en 2022. Reporters Sans Frontières modifie sa méthodologie
La liberté de la presse dans le monde selon Reporters sans frontières
Cartographie des journalistes tués ou emprisonnés dans le monde
Carte de l'indice de perception de la corruption (Transparency International)
L'indice de perception de la démocratie selon Dalia Research
Géographies de l'exclusion numérique par Mark Graham et Martin Dittus
Quand Facebook révèle nos liens de proximité
Cartographie du réseau social Mastodon
-
sur Revue de presse du 17 janvier 2025
Publié: 17 January 2025, 2:00pm CET
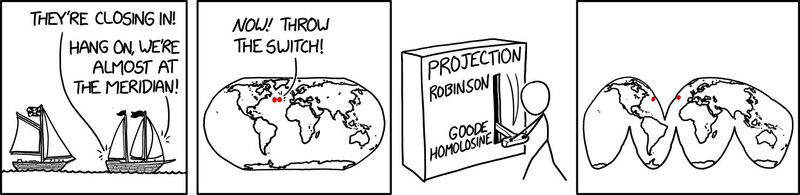 Voici la première GeoRDP de l'année, au quart de tour et à grandes foulées. Vous y découvrirez un mélange de confettis et d'actualités géo qui s'enchaînent, et ceci concocté à plusieurs mains
Voici la première GeoRDP de l'année, au quart de tour et à grandes foulées. Vous y découvrirez un mélange de confettis et d'actualités géo qui s'enchaînent, et ceci concocté à plusieurs mains
-
sur Le modèle organisationnel Oslandia
Publié: 17 January 2025, 6:29am CET par Caroline Chanlon

Depuis sa création, Oslandia s’est appuyée sur ses valeurs pour co-construire son modèle organisationnel : autonomie, confiance et transparence.
Au fil des années et de la croissance de l’entreprise, de nouveaux process, des méthodologies et modes de fonctionnement organisationnels se sont développés grâce à un travail collectif et collaboratif . L’objectif : conserver son ADN qui place l’humain comme moteur de sa croissance !
Voici différentes initiatives mises en place :
Comité RHLe comité RH est en charge de l’application opérationnelle de la politique RH d’Oslandia, et donc de prises de décision sur le suivi RH individuel de l’équipe, dans une optique de délégation et de responsabilité collective. Ce comité met en application la politique RH, il veille notamment à la bonne application de la grille salariale et de la transparence salariale. Après un travail sur le plan de formation du collaborateur, le comité a entamé un travail de refonte de la cartographie des compétences de l’équipe.
Les prises de poulsLa prise de pouls est un rendez-vous individuel de 20 minutes en visio entre chaque collaborateur de l’entreprise et la responsable RH, et a pour objectif :
- « prendre le pouls » de chacun régulièrement, et identifier des problèmes qui n’auraient pas autrement fait surface dans un contexte 100% télétravail
- identifier les besoins nécessitant des réunions collectives et/ou d’assistance interne et aiguiller vers les bons interlocuteurs
- identifier les sujets relatifs au fonctionnement général de l’entreprise
- communiquer (« faire remonter ») les sujets de satisfaction ou non-satisfaction
Les sessions WTF (« Wonderful Team Federation »
Le COPIL et ses invités sont des sessions en visio-conférence qui permettent d’échanger entre membres de l’équipe. Leur fréquence est fixe et la présence est facultative. Une WTF est une présentation d’une thématique par une ou plusieurs personnes. L’objectif est de partager l’information, la veille technique ou de faire du brainstorming ensemble et créer de l’émulation ! Les thèmes sont libres et pas forcément techniques. Une WTF peut s’apparenter à une “éclairation” sur un projet, ou un retour d’expérience. Les WTF ont lieu tous les 15 jours.
sont des sessions en visio-conférence qui permettent d’échanger entre membres de l’équipe. Leur fréquence est fixe et la présence est facultative. Une WTF est une présentation d’une thématique par une ou plusieurs personnes. L’objectif est de partager l’information, la veille technique ou de faire du brainstorming ensemble et créer de l’émulation ! Les thèmes sont libres et pas forcément techniques. Une WTF peut s’apparenter à une “éclairation” sur un projet, ou un retour d’expérience. Les WTF ont lieu tous les 15 jours.Un comité de pilotage d’une journée est organisé en présentiel toutes les 6 semaines avec les membres de la direction, et la particularité que pour chaque session, deux invités tournants, collaborateurs d’Oslandia sont conviés à participer ! Un copil visio plus court permet de traiter les affaires courantes entre chaque réunion en présentiel.
Ask Me AnythingOslandia possède de multiples canaux de communication et d’organisation, tels que le COPIL, le Comité RH, les prises de pouls, les rôles de support, les groupes de travail transverses ou l’accompagnement externe, chacun possédant ses propres fonctions et modalités. En complément des espaces de communication existants, Oslandia a mis en place le principe d’« AMA » pour « Ask Me Anything« (terme original par Reddit ) avec le président, Vincent Picavet, pour permettre de garder un accès direct et garanti des collaborateurs à la direction. Tous les sujets sont admis !
Accompagnement psycho-social externeUne « Hotline » est mise à disposition de tous les collaborateurs pour des échanges téléphoniques avec une accompagnante spécialiste des questions psycho-sociales, Nathalie Guigues ( Reconnessens ). Ce regard tiers et expert permet parfois de débloquer plus facilement des situations que les autres canaux de communications ne pourraient pas résoudre.
IntégrationOslandia a mis en œuvre un parcours d’intégration pour ses nouveaux arrivants. Chaque nouvel arrivant participe à une journée d’intégration en présentiel où l’on aborde le fonctionnement général d’Oslandia, son histoire et ses valeurs. C’est également l’occasion de passer le test MBTI, qui permet d’avoir un éclairage sur les fonctionnements individuels et une meilleure communication au sein de l’équipe. Le parrainage est mis en place pour faciliter l’arrivée du nouvel embauché et fournir une aide à l’insertion dans l’équipe, la prise en main des outils et des procédures Oslandia.
Mini ProjetLe Mini projet est un travail collectif, planifié pour une durée limitée et réduite, sur un sujet de fond pour Oslandia non directement lié à la production. Un budget temps est allouée annuellement à ces mini-projets. Un exemple : Définir le fonctionnement du tutorat chez Oslandia.
CorpoLes Corpos sont des événements en présentiel qui mobilisent tous les collaborateurs. Elles ont lieu 3 fois par an et sont organisées de manière tournante par une équipe de 4 personnes dont 2 membres de l’équipe de production, qui réfléchissent et planifient les ateliers ainsi que les extras !
-
sur La presse des XVIe et XVIIe siècles en Espagne accessible à travers une interface cartographique
Publié: 17 January 2025, 5:21am CET
Source : La BNE edita un mapa para geolocalizar relaciones de sucesos de los siglos XVI a XVIII (Biblioteca Nacional de España)
Les relaciones de sucesos désignent les journaux et canards à succès diffusés dans l'Espagne du Siècle d'or. Ces "relationes" au sens de récits d'époque constituent une source incomparable sur les événements des XVIe et XVIIe siècles lorsque l'Espagne dominait le monde. Les relaciones sont un genre historico-littéraire qui, avec les notices, a précédé le journalisme lui-même aux XVIe et XVIIe siècles. Nieves Pena Sueiro les définit comme des textes occasionnels dans lesquels des événements sont relatés afin d'informer, de divertir et d'émouvoir le destinataire. Habituellement considérés comme des prédécesseurs de la presse actuelle, ils couvrent tous les aspects traités par celle-ci dans ses différentes sections, à l'exception du fait que chaque rapport fait généralement référence à un seul événement. Ils abordent des thèmes variés : fêtes (entrées, mariages royaux, funérailles, béatifications, canonisations...), politiques et religieuses (guerres, autodafés...), extraordinaires (miracles, catastrophes naturelles, malheurs personnels), voyages. , etc. Leur forme et leur longueur sont variables : ils peuvent être brefs (écrits sur une simple feuille de papier, une feuille de papier ou un livre de ficelle), ou étendus (et atteindre la forme d'un livre, qui peut être volumineux) et sont distribués sous forme manuscrite ou imprimée (source : Wikipedia).
La carte de géolocalisation proposée par la Biblioteca Nacional de España (BNE) fournit un nouveau mode d'accès à la riche collection des relaciones de sucesos impresas (journaux imprimés).
Interface cartographique pour accéder aux Relaciones de sucesos (source : BNE)
Sur cette carte, vous pouvez localiser les relations, en fonction de l'endroit où se trouvent les récits, avec une brève description, la référence qui permet de les localiser dans le catalogue et de les insérer dans la numérisation. La localisation n'est pas toujours précise, car dans certains cas le contenu du document ne permet pas de préciser le lieu. Le choix a été alors de fournir une localisation approximative. Dans d'autres cas, plusieurs lieux apparaissent et il a été nécessaire d'en choisir un.
Les sources ont été classées par domaines thématiques de manière à ce que l'utilisateur puisse sélectionner les sujets qui l'intéressent. Les domaines thématiques sont les suivants :- Phénomènes naturels : terrestres et ouragans, inondations, tempêtes, incendies, éruptions volcaniques et phénomènes astronomiques
- Faits historico-politiques : armada, diplomacie, politique, récits de guerre et piraterie
- Solennités et fêtes : fêtes, entrées triomphales, décès et funérailles, voyages, naissances et baptêmes, mariages, couronnements et autres solennités
- Religion : miracles, autodafés, martyres, conversions et islam
- Crimes et délits : homicides et autres
- Curiosités et merveilles : merveilles, monstres et sorcellerie
- Autres succès : thèmes divers, pestes et épidémies, naufrages, us et coutumes
Articles connexes
Europe : 12 cartes et un projet (exposition virtuelle de la Bibliothèque nationale d'Espagne)
Combien de châteaux en Espagne, 10 000 voire plus ? Une story map proposée par le journal El-Confidencial
Une cartographie détaillée des biens appartenant à l'Église en Espagne
L'histoire par les cartes : la recension des symboles franquistes en Espagne
Le monde luso-hispanique à travers les cartes : un guide de la Bibliothèque du Congrès
L'histoire par les cartes : la première carte murale de la Catalogne (1906) par le pédagogue Francesc Flos i Calçat
-
sur La carte de la pauvreté en France en trois dimensions (Observatoire des inégalités)
Publié: 16 January 2025, 2:54pm CET
L’Observatoire des inégalités publie la première carte de France qui affiche à la fois le taux de pauvreté mais aussi le nombre de ménages pauvres, représentés en trois dimensions. Cette carte permet d’explorer la France à une échelle très fine. Elle a été réalisée par le géographe Romain Thomas à partir des données carroyées à 200 mètres fournies par l'Insee.
Carte de la pauvreté en France en trois dimensions (source : Observatoire des inégalités)
La pauvreté en France en trois dimensions
La carte a été réalisée à partir de données qui portent sur des carreaux de 200 mètres de côté, elle présente deux indicateurs. Le premier (en couleur) est la proportion de ménages pauvres. Plus les carreaux sont foncés, plus le taux est élevé. Le second indicateur (en relief) est le nombre de ménages pauvres : plus la colonne est haute, plus les ménages pauvres sont nombreux. Cette représentation en relief constitue une nouveauté. La carte permet de survoler l’ensemble du territoire et d’observer où vivent les ménages pauvres en visualisant leur nombre.
Les carreaux ont le grand intérêt de permettre une visualisation à un niveau très fin, qui ne dépend pas des limites administratives des territoires. Certaines zones très marquées par la pauvreté peuvent devenir invisibles quand on observe uniquement la moyenne d’une commune, c’est le cas par exemple des quartiers nord-est de la ville de Paris. D’autres zones s’étendent de part et d’autre des limites communales.
L’immense majorité des travaux sur la pauvreté à l’échelle locale portent sur les taux. On mesure alors, dans une zone donnée, la concentration de personnes démunies. Ce faisant, on masque l’effet de la densité de population et donc le nombre de personnes pauvres. Ce qui conduit à une mauvaise compréhension : en fonction de sa population, la même surface d’une carte peut représenter quelques ménages pauvres comme des milliers.
Concrètement, quand on observe notre carte d’en haut, en supprimant le relief, des taches foncées ressortent fortement en milieu rural, mais ne représente qu’un très petit nombre de ménages contre des milliers en ville. Quand on incline la carte, le nombre de ménages apparaît en trois dimensions. On voit très nettement où vivent ces derniers : massivement dans les villes et leurs banlieues proches. Là où se trouvent les emplois et les logements sociaux.
On a beaucoup insisté sur la pauvreté en milieu rural ou en milieu périurbain en raisonnant à partir de taux de pauvreté en oubliant la densité et le nombre de personnes pauvres. Notre outil permet une nouvelle lecture, complémentaire. Même si on est peu nombreux, vivre dans un environnement qui concentre la pauvreté n’est pas la même chose que dans un territoire plus mixte.
Les limites de l’outil
Cette carte, expérimentale, a une vocation pédagogique. L'objectif est de la perfectionner en améliorant sa rapidité d’affichage et la possibilité de dézoomer plus largement sur des régions plus vastes. Pour l’instant, elle ne comprend pas les départements d’outre-mer. Les données utilisées sont celles de 2019 (les dernières disponibles) de l’Insee.
Toute la population n’est pas représentée : pour garantir le secret statistique (pour éviter que l’on puisse savoir dans les territoires peu peuplés si tel ou tel ménage est pauvre), chaque carreau de 200 m de côté comprend au moins 11 ménages. Dans le cas contraire, l’Insee donne au carreau une valeur moyenne qui dépend des carreaux voisins. Quand la population est vraiment trop faible, rien ne s’affiche. Par ailleurs, l’Insee ne prend pas en compte les sans-abri, ni les personnes qui vivent en collectivité (une maison de retraite par exemple).
Le seuil de pauvreté utilisé par l’Insee est celui fixé à 60 % du niveau de vie médian, le seul disponible à ce niveau. Ce n’est pas celui que l’Observatoire des inégalités utilise habituellement car il constitue une conception extensive de la pauvreté. Nous représentons des ménages, et non des personnes, car nous ne disposons pas de données individuelles. Un ménage = un logement individuel, pour l’Insee. Celui-ci peut comprendre une ou plusieurs personnes. La taille des ménages est en moyenne de deux individus. En représentant de la même manière les personnes seules et les familles, nous minimisons le poids de la pauvreté dans les logements sociaux car ils comprennent plus souvent des familles.
L'Observatoire des inégalités
L’Observatoire des inégalités est un organisme indépendant de toute institution, entreprise privée ou autre organisation. Fondé en 2003, il dresse un état des lieux le plus fidèle possible des inégalités en France, en Europe et dans le monde. "Nous défendons l’expression d’une pluralité d’opinions pour définir les inégalités qui doivent être considérées comme justes ou injustes. Au-delà des droits, le problème n’est pas celui de l’inégalité en soi mais de la justice sociale. Nous revendiquons que s’expriment des positions morales différentes, mais celles-ci doivent être fondées sur des éléments factuels. Les prises de position sont clairement signalées comme telles."
Articles à lire sur le site- La pauvreté, préoccupation majeure des Français
- Les pauvres vivent principalement dans les grandes villes
- Pauvreté dans les Dom : où sont les chiffres
- DOM : une grande pauvreté, cinq à dix fois plus élevée qu’en métropole
- Les vingt quartiers prioritaires les plus pauvres de France
- Les villes où vivent les riches les plus riches
Articles connexes
Cartographier les inégalités en France à partir des données carroyées de l'INSEE
Des différentes manières de cartographier la pauvreté dans le monde
La cartographie de la pauvreté dans les quartiers des grandes métropoles : un outil au service de la justice spatiale ?
Les aires d'accueil des gens du voyage en France : des territoires marginalisés
L'insécurité alimentaire dans le monde (rapport du FSIN)
Calculer l'indice de richesse relative à une échelle infra-nationale pour les pays pauvres ou intermédiaires
Quand l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique permettent de repérer des bidonvilles à partir d'images satellitaires et aériennes
La cartographie de la pauvreté à Londres à la fin du XIXe siècle
-
sur CityForge 1.0.0 disponible sur le dépôt QGIS !
Publié: 15 January 2025, 6:47am CET par Sophie aubier

Il y a un an l’idée de créer un plugin capable de générer des modèles de bâtiments CityJSON directement dans QGIS germait chez Oslandia. Grâce au travail préparatoire d’étudiants de l’ENSG ainsi qu’au projet CP4SC nous pouvons vous présenter la version 1.0.0 de CityForge en anglais et français !
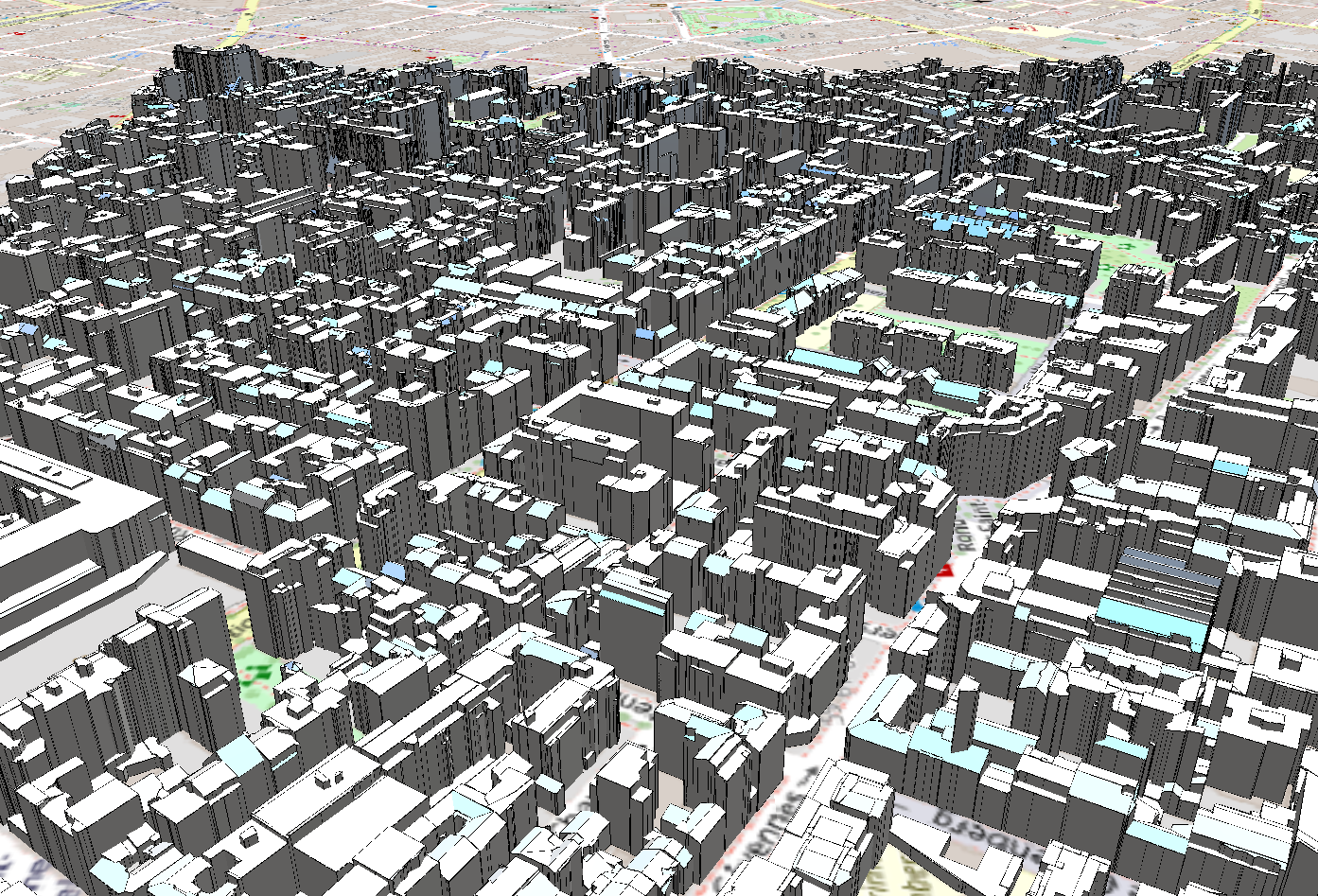
Cette première version permet de générer un modèle CityJSON directement dans QGIS sur Windows ou d’autres OS tels que Linux.
Pour Windows (ou pour les plus téméraires qui n’ont pas peur de compiler sur leur machine) nous appelons en tâche de fond geoflow sous forme d’exécutable préalablement téléchargé. Pour les autres OS nous appelons l’image Docker fournie par l’IGN préalablement construite.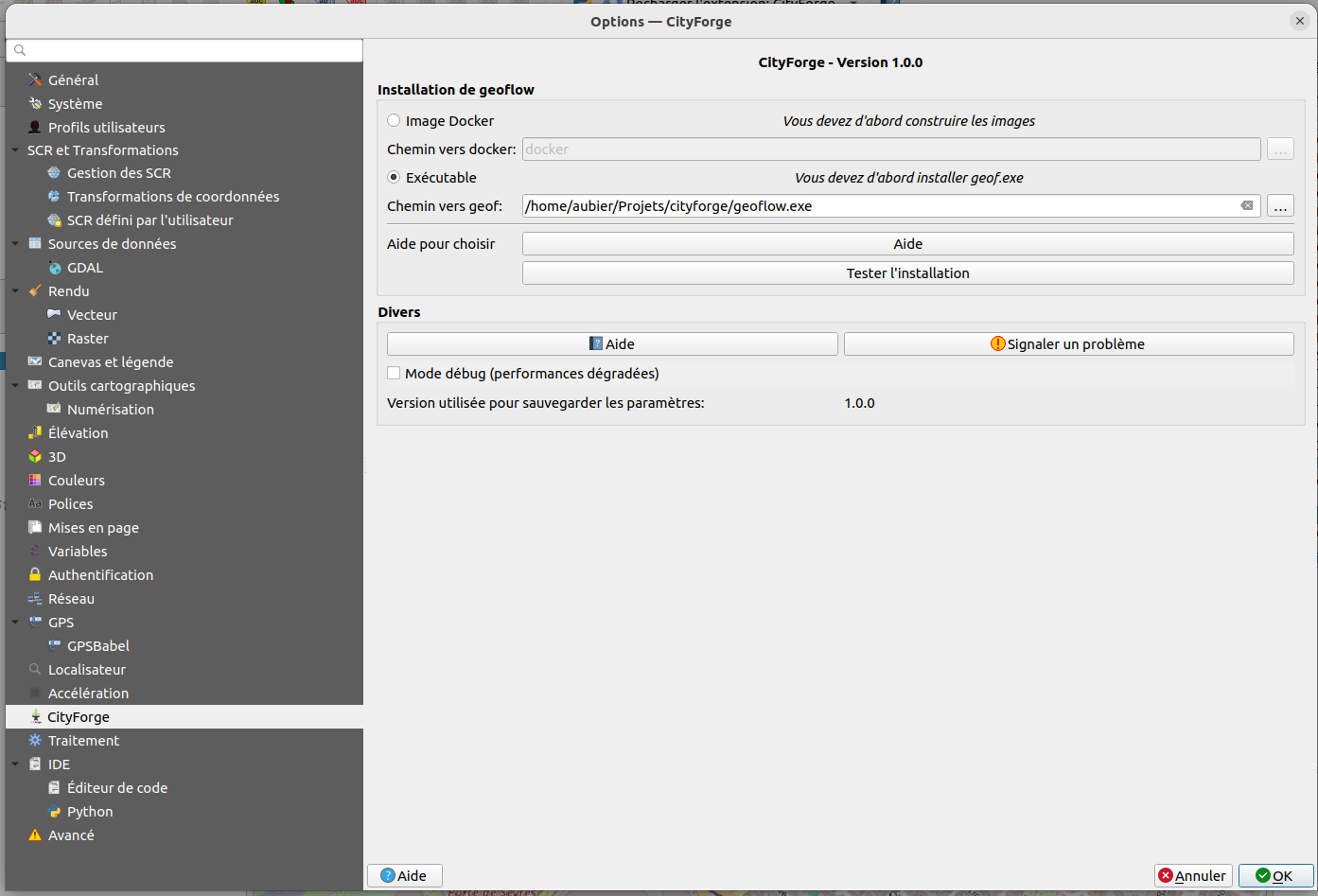
Le plugin prend en argument d’entrée un fichier de nuage de point (laz/las) ainsi que l’emprise de bâtiment (shp ou gpkg). Il est possible d’utiliser une couche enregistrée dans un répertoire ou une couche présente dans les couches QGIS.
Le plugin gère la détection du CRS et prévient l’utilisateur si les deux fichiers ne partagent pas le même CRS.
Le plugin propose de créer le CityJSON avec tous les niveaux de détails (LoD 0.0 à LoD 2.2) ou uniquement le niveau de détails le plus abouti.Une fois le CityJSON créé, il est possible de le visualiser sur QGIS via le plugin CityJSON loader ou dans Piero.
Le plugin, désormais disponible sur le dépôt QGIS, est donc installable directement dans QGIS depuis le gestionnaire d’extensions. Le plugin nécessite toutefois toujours certains pré-requis, notamment sur l’installation de Geoflow : toutes les informations sont disponibles sur le site web du plugin.
Pour la suite, on a quelques idées
Démo vidéo
Ce projet est financé par l’Union européenne – Next Generation EU dans le cadre du plan France Relance.


-
sur Café géo de Chambéry-Annecy, 22 janvier 2025 : « Métagéographies. Des découpages majeurs pour dire le monde », avec Christian Grataloup
Publié: 14 January 2025, 7:44pm CET par Les Cafés Géo
Mercredi 22 janvier 2025, 18h30, O’Cardinal.’S, PLace Métropole, Chambéry
Christian Grataloup, professeur émérite de géographie, Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
-
sur Appel à commentaires sur le projet de standard Opérations d'aménagement
Publié: 14 January 2025, 4:49pm CET
Appel à commentaires sur le projet de standard Opérations d'aménagement
-
sur Vidéos, présentations et interviews des journées QGIS FR 2024
Publié: 14 January 2025, 2:00pm CET
 La Geotribu était bien présente aux journées QGIS FR 2024. Julien a assuré l'animation de la journée de conférences et avec Florian, ils ont renouvelé les mini-interviews.
La Geotribu était bien présente aux journées QGIS FR 2024. Julien a assuré l'animation de la journée de conférences et avec Florian, ils ont renouvelé les mini-interviews.
-
sur La répartition des zones de compétence entre la police et la gendarmerie nationales en France : une carte incohérente ?
Publié: 14 January 2025, 9:18am CET
Source : « La répartition des zones de compétence entre la police et la gendarmerie nationales » (rapport de la Cour des Comptes, 13 janvier 2025)
Résumé
En France, la police et la gendarmerie nationales assurent conjointement les missions de sécurité et de paix publiques. Depuis le rattachement de la gendarmerie au ministère de l’intérieur en 2009, elles dépendent de la même autorité politique. Les forces de sécurité intérieure emploient 253 000 policiers et gendarmes et bénéficient depuis plusieurs années d’un budget en hausse. Pour autant, la répartition territoriale des zones de compétence de la police et de la gendarmerie nationales a peu évolué au cours des 80 dernières années, malgré les modifications intervenues tant sur le plan de la démographie qu’en termes de délinquance. Entre lourdeurs décisionnelles et concurrence entre les deux forces, la carte des zones de compétence est totalement figée depuis dix ans. Face à ce constat, la Cour a analysé la répartition territoriale des forces de sécurité dans la double perspective de répondre au mieux aux besoins de la population en matière de sécurité et d’optimiser l’allocation des moyens publics. La répartition actuelle des forces, datée et incohérente, est source de dysfonctionnements et d’inefficiences au détriment du service rendu à la population. Il est désormais urgent que le ministère de l’intérieur s’empare de ce sujet et procède aux ajustements nécessaires.
Plan et données du rapport
I- Une carte incohérente, source de difficultés et de plus en plus contournée
II- Une conduite des transferts à revoir pour dépasser les rigidités de gestion des forces
III- Sortir de l’immobilisme pour répondre aux enjeux de sécurité publique des territoires
Usages des cartes
A l'appui de ses analyses, la Cour des Comptes propose plusieurs cartes dont l'objectif est de montrer la mauvaise répartition des moyens et les logiques parfois discutables de découpage entre zones urbaines et zones rurales. En 2021 avait été mis en avant l’établissement d’une carte globale fondée sur des seuils de population, de densité et d’intensité de la délinquance. Mais le projet n'a pas été mis en oeuvre. La répartition des zones de compétence entre police et gendarmerie fournit un bon exemple pour interroger les logiques de découpage administratif en France et les déséquilibres entre population et territoire.
Répartition départementale de la délinquance (à gauche, nombre de faits constatés) et des forces de sécurité intérieure (à droite, nombre d’ETP pour 1 000 habitants)

La métropole de Toulouse – zones police et gendarmerie
Articles connexes
Cartes et données sur la géographie de la délinquance à l'échelle communale
La carte, objet éminemment politique : la carte de la Technopolice en France
La carte, objet éminemment politique : la cartographie des inégalités urbaines à Marseille
Cartes et données sur la population carcérale en Europe
Cartographie des fusillades de masse aux Etats-Unis : comment étudier et objectiver le phénomène ?
La cartographie des opportunités dans les quartiers des grandes métropoles : un outil au service de la justice spatiale ?
-
sur Drupal SEO Recipe
Publié: 14 January 2025, 9:15am CET par Simon Georges
L’émergence de « recettes » (recipes) dans Drupal me permet enfin de proposer ce que je considère comme la meilleure configuration par défaut pour le SEO dans Drupal.
-
sur Les nouveautés Giro3D 0.41
Publié: 14 January 2025, 6:39am CET par Sébastien Guimmara

Giro3D est une bibliothèque de visualisation de données géospatiales sur le Web. Libre et open source, elle est compatible avec de nombreuses sources de données géospatiales (rasters, vecteurs, nuages de points…).
Support des nuages de points LAS Voir la liste des changements complets de la version 0.41.
Voir la liste des changements complets de la version 0.41.Giro3D 0.41 ajoute le support très attendu des nuages de points au format LAS. Cela inclut:
- Les fichiers LAS/LAZ simples
- Les LAS optimisés au format COPC
- Les nuages de points Potree au format LAZ
Ces nuages de points sont affichés via la nouvelle entité PointCloud, qui peut être branchée à plusieurs sources de données:
- LASSource pour des fichiers LAS non hiérarchiques
- COPCSource pour des fichiers LAS optimisés en COPC
- PotreeSource pour des jeux de données Potree
- AggregatePointCloudSource permettant de combiner plusieurs sources en une seule (voir plus bas)
Il est également facile d’implémenter de nouvelle source pour des formats de nuages de points tels que XYZ, ou Entwine EPT…
Le format COPCLe format COPC (pour Cloud Optimized Point Cloud), permet de charger un fichier LAS distant en l’optimisant pour le streaming sur le Web. Les points sont structurés selon un index spatial de type octree, qui crée une hiérarchie virtuelle de groupes de points que Giro3D récupère à la demande.
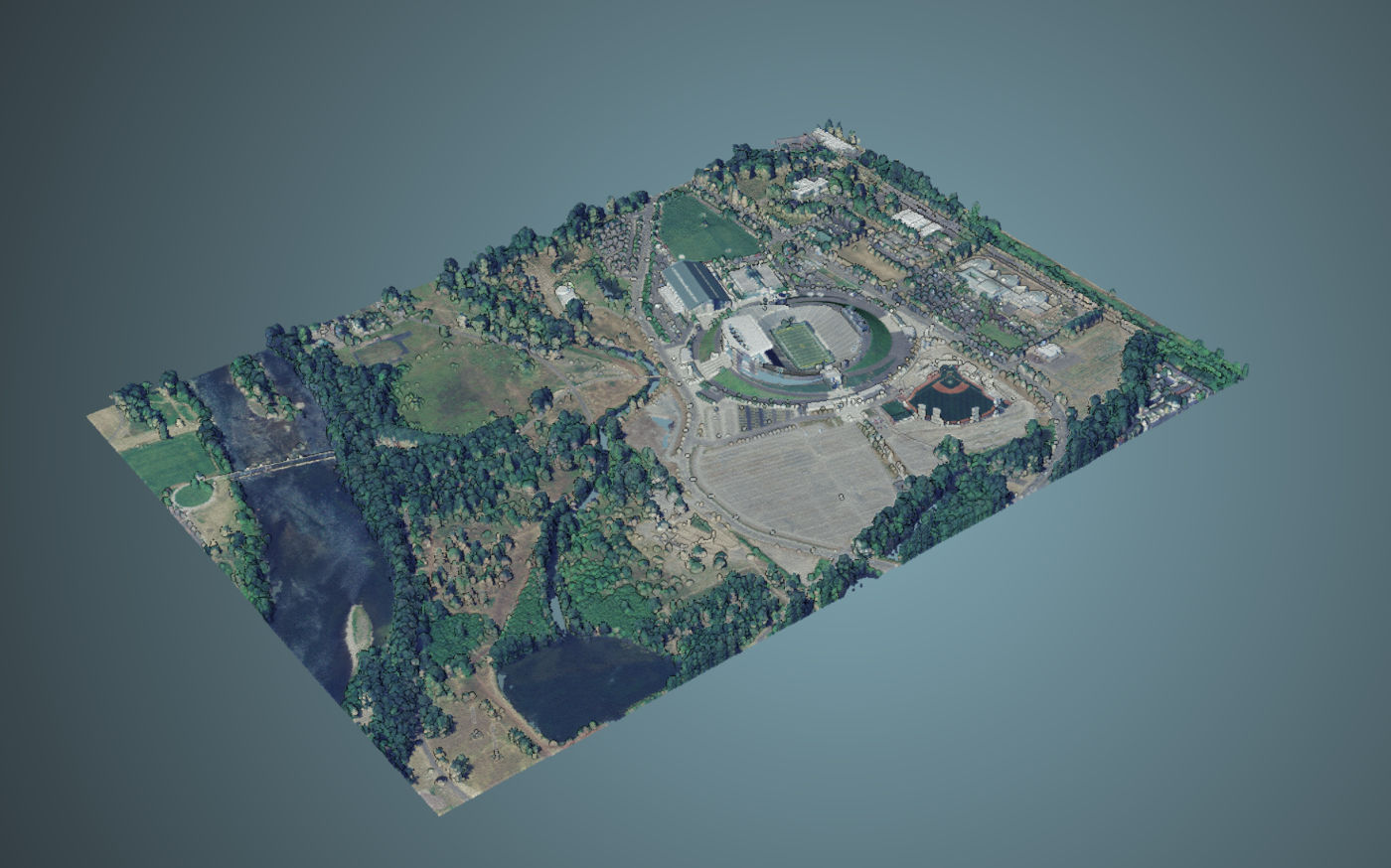 Autzen Stadium
Autzen StadiumLes bénéfices du format COPC sont multiples:
- Un seul fichier permet de servir des millions, voire des dizaines de millions de points
- Un fichier COPC étant un fichier LAS standard, il est lisible par toutes les applications compatibles avec les fichiers LAS, même si elles ne bénéficient pas des optimisations offerte par la structure hiérarchique propre au COPC.
- Compatible avec toutes les variantes de la spécification LAS (Point Data Record).
- Permet de stocker tous les attributs d’un nuage de points: couleur, intensité, classification, nombre de retours…
Pour illustrer la puissance du format COPC et son implémentation dans Giro3D, visitez l’exemple suivant: [https:]] .
Cet exemple combine 180 fichiers COPC fournis par le programme LIDAR HD de l’IGN, totalisant plus de 3 milliards de points. Ces fichiers sont regroupés au sein d’une AggregatePointCloudSource, permettant de fournir une interface unifiée à toutes les sources sous-jacentes (COPC ou autre).
Les filtres de nuages de points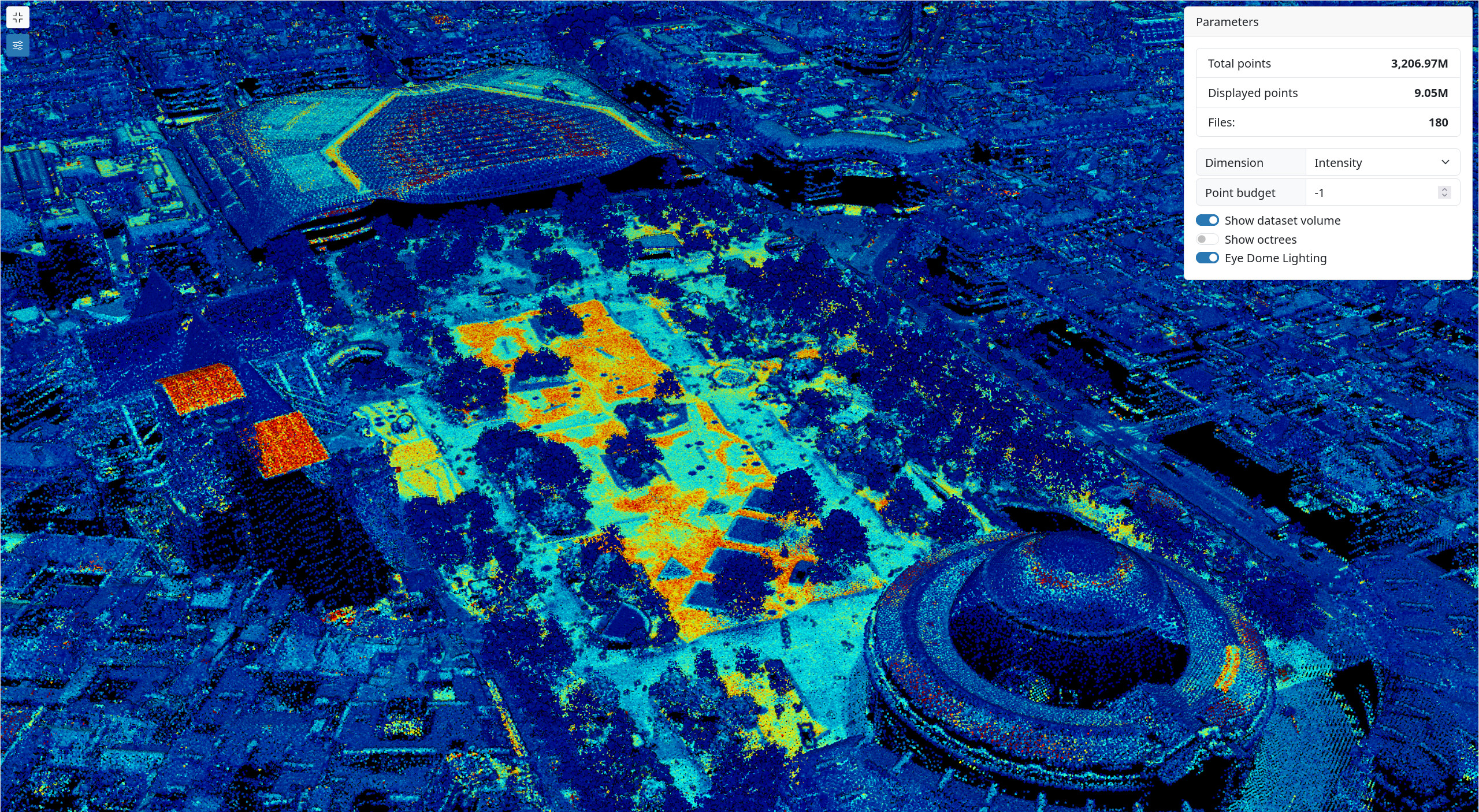 Les intensités de nuage de points
Les intensités de nuage de points 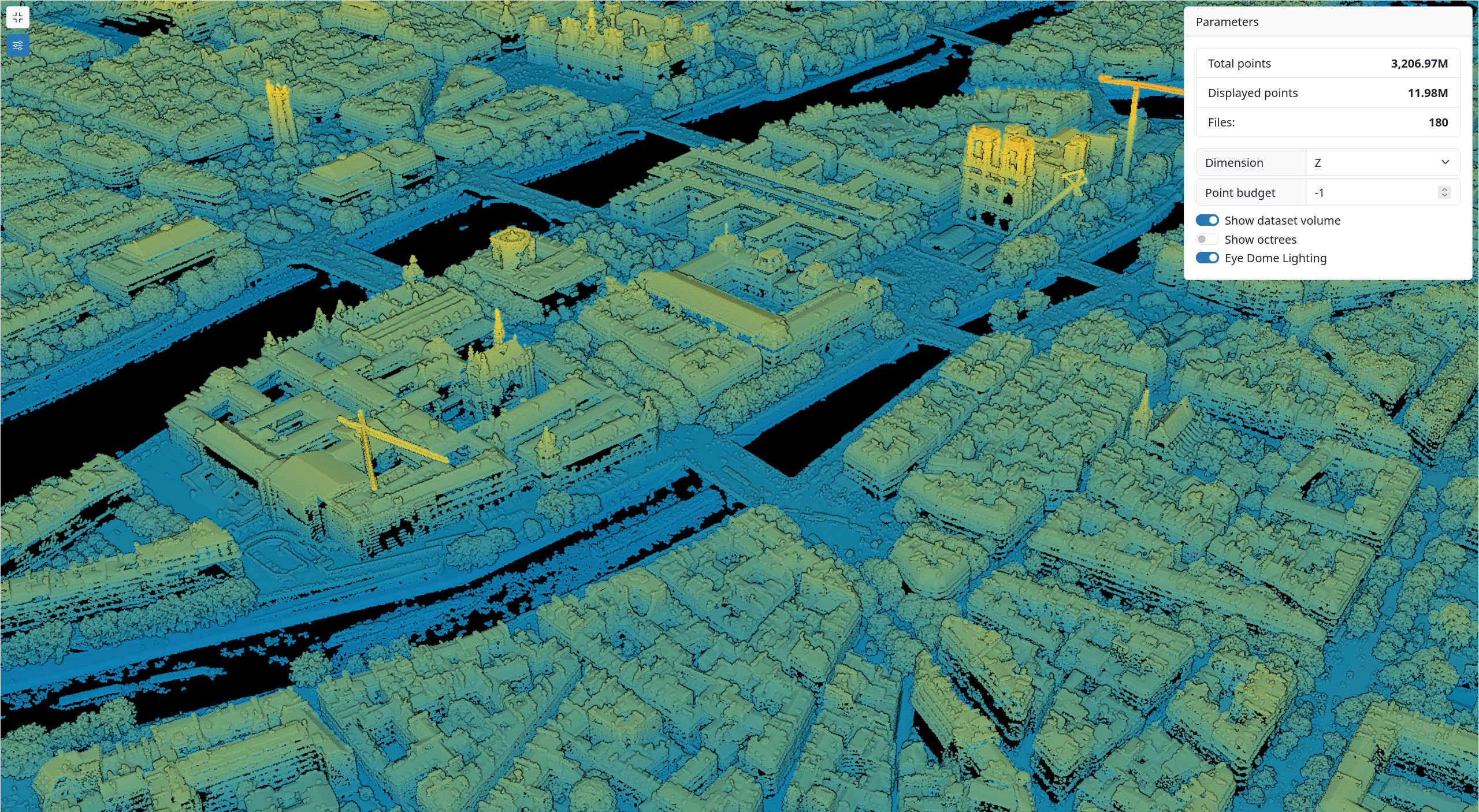 L’élévation colorisée selon une rampe de couleur
L’élévation colorisée selon une rampe de couleurLes sources LASSource et COPCSource fournissent une fonctionalité de filtres par critère. Ces critères s’appliquent sur les attribus existants dans la source de données (intensité, classification, couleur, élévation…).
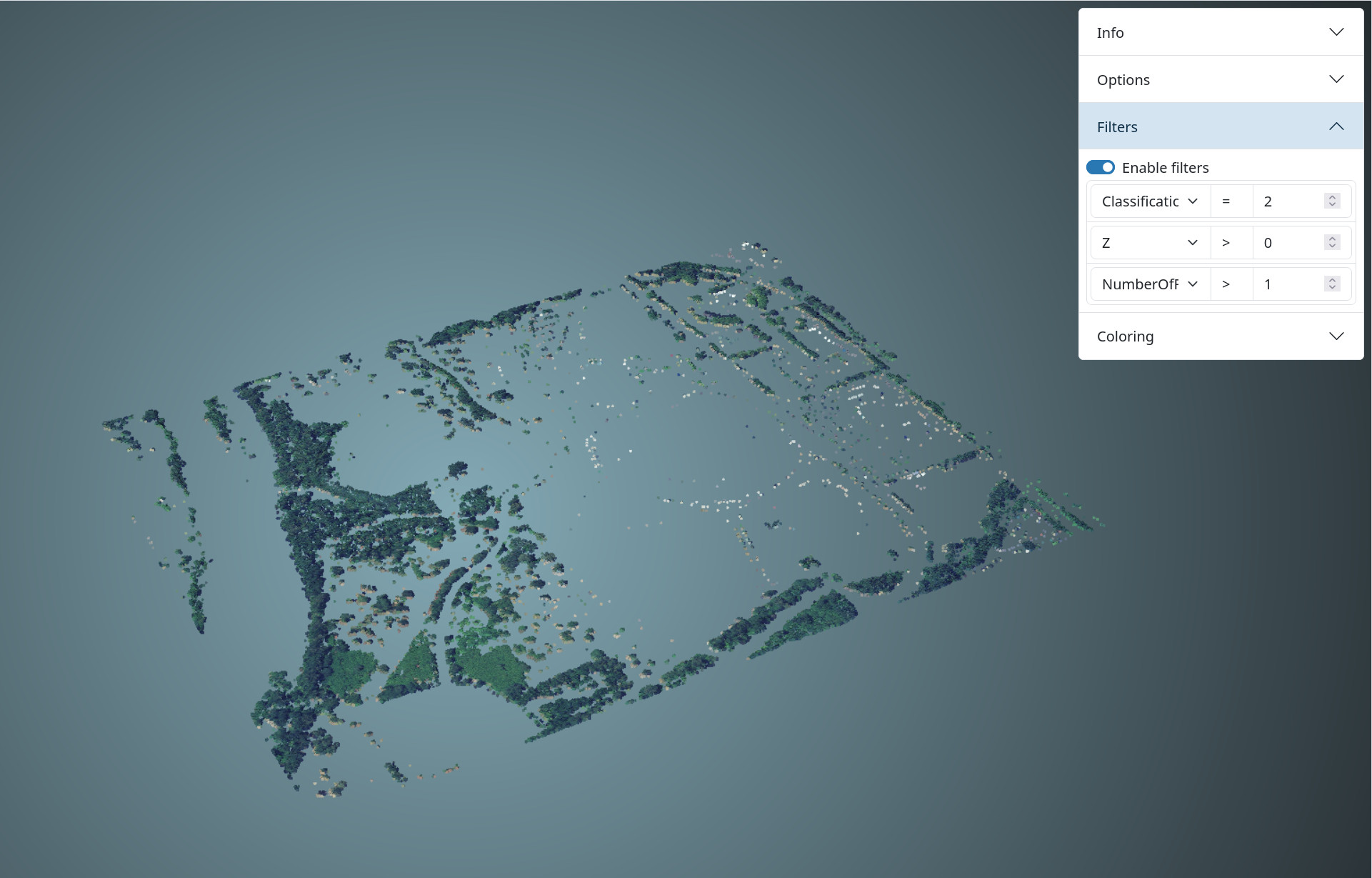 Filtrage des points par critères
Filtrage des points par critèresDans cette illustration, seuls les points répondant aux critères suivants sont affichés:
- l’élévation (Z) est supérieure à zéro
- la classification vaut 2 (correspondant à la végétation)
- le nombre de retours LIDAR est supérieur à 1
 Voir cet exemple interactif pour un récapitulatif de toutes les fonctionnalités offertes par les nuages de points LAS dans Giro3D
Voir cet exemple interactif pour un récapitulatif de toutes les fonctionnalités offertes par les nuages de points LAS dans Giro3D
-
sur Comment les cartes étaient colorées autrefois (blog de la Bibliothèque du Congrès)
Publié: 13 January 2025, 6:35pm CET
Source : « Adding color to the world : how maps got toned » [Ajouter de la couleur au monde : comment les cartes étaient teintées autrefois] (Library of Congress, 10 janvier 2025)Le blog de la Bibliothèque du Congrès consacre un article à l'introduction progressif de la couleur dans les cartes. Il s'agit d'un article de Seanna Tsung, spécialiste du catalogage à la Division de géographie et de cartographie, qui fait partie de la série Fabriquer le monde.
Pendant deux siècles et demi, de 1600 à 1850 environ, la grande majorité des cartes commerciales de style européen publiées en Europe et aux Amériques étaient gravées, principalement sur des plaques de cuivre. Ces cartes étaient imprimées en monochrome, l'encre noire épaisse de l'imprimeur qui restait dans les lignes gravées dans le cuivre étant pressée à l'envers sur le papier. Entre chaque impression, les plaques étaient encrées puis nettoyées pour éliminer toute trace d'encre sur les surfaces planes de la plaque, ce qui permettait au papier de transparaître. En raison des exigences spécifiques et des aspects économiques de ce processus de création de cartes, notamment la possibilité d'ajouter et de modifier les plaques, le grand niveau de détail réalisable et, au fil du temps, la conviction du public que c'est ainsi que les cartes devaient se présenter, la plupart des développements esthétiques des technologies d'impression observés dans l'estampe en tant que forme d'art n'ont pas eu d'incidence sur la production de cartes.
Si vous êtes amateur de cartes imprimées de ces périodes et de ces lieux, vous saurez que de nombreux exemples ne sont pas monochromes. Ils sont plutôt peints à la main. Il existe deux principaux types de peinture à la main pour les cartes, les atlas et les vues. Le premier, parfois appelé « style hollandais », utilise de plus grandes zones de couleurs saturées et vise à ajouter une touche esthétique à la carte ou à certaines parties de celle-ci. Ce style est souvent utilisé pour les pages de titre des atlas et pour les cartouches et les cadres décoratifs. Moins souvent, il est utilisé pour une carte ou une vue entière, comme dans cette carte de Paris tirée de Civitates orbis terrarum de Braun et Hogenberg, un atlas en six volumes publié entre 1612 et 1618.
Le deuxième type général de coloriage à la main utilisait principalement des couleurs pastel pour mettre en évidence les limites, l'hydrologie, les routes ou d'autres caractéristiques des cartes. Il était utilisé pour compléter ou mettre en valeur les données cartographiques fournies par la carte plutôt que pour colorier entièrement l'image ou ajouter aux qualités décoratives de la carte. Il s'agit du type de coloriage à la main le plus courant, en particulier aux XVIIIe et XIXe siècles. Vous trouverez un exemple d'une grande carte du monde de 1754 de Nicolas de Fer, dans laquelle la couleur est utilisée pour indiquer les frontières continentales et autres. Les figures mythologiques sont laissées monochromes.
Certains éditeurs de cartes avaient des coloristes en interne, d'autres sous-traitaient le travail. On pense qu'une certaine partie de la coloration au cours de la période en question était effectuée à domicile par des femmes, qui étaient généralement exclues de la production de cartes commerciales, sauf si elles étaient filles, épouses ou veuves de cartographes, graveurs ou éditeurs de sexe masculin. Les cartes individuelles étaient souvent vendues par les éditeurs, colorées ou non, tout comme les atlas, qui étaient également souvent vendus non reliés ou dans des reliures temporaires, dans l'idée que les acheteurs les feraient relier selon leur goût.
En tant qu’acheteur de matériel cartographique, vous pouviez faire un certain nombre de choix, en fonction de décisions financières et esthétiques, ainsi que de l’usage auquel la carte était destinée. Les exemples de cartes murales, qui ne sont pas conservées en grand nombre parce qu’elles étaient souvent appliquées aux murs ou accrochées pendant de longues périodes exposées à la lumière, aux excès climatiques, à la fumée et à d’autres polluants, incluent généralement beaucoup de couleurs car elles étaient destinées à être lues dans de grands espaces. Les explorateurs, cartographes et érudits pouvaient préférer des cartes non colorées ou légèrement colorées, dans lesquelles aucun détail de la gravure ne serait masqué par la coloration. Même des productions de luxe comme la Civitates orbis terrarum mentionnée précédemment, qui se distingue par sa coloration magnifique et détaillée clairement supervisée, étaient également vendues en monochrome.
Le développement de la lithographie commercialement viable à partir du milieu du XIXe siècle a conduit à la disparition de la coloration à la main, mais ce processus s'est fait progressivement. La Division de géographie et de cartes possède un certain nombre d'atlas allemands des années 1850 et 1860 qui contiennent à la fois des cartes gravées et des cartes lithographiées en couleur coloriées à la main. Les éditeurs semblent avoir continué à utiliser leur stock de cartes coloriées à la main jusqu'à ce qu'elles soient épuisées ou que des événements mondiaux nécessitent une nouvelle carte d'une certaine zone. La coloration à la main était également utilisée sur les cartes produites par lithographie, photocopie et autres techniques d'impression parmi les nombreuses développées à partir du milieu du XIXe siècle. De nombreux atlas fonciers, départementaux et autres atlas locaux publiés aux États-Unis jusqu'au début du XXe siècle contenaient à la fois des cartes locales lithographiées et coloriées à la main et des cartes imprimées en couleur d'États et de pays.
Pour déterminer si une carte est imprimée en couleur ou coloriée à la main, regardez les bords de la couleur, ainsi que les variations de ton typiques de l'aquarelle. Vous voyez sur ce détail d'une planche d'atlas de 1879 de la région de Washington, DC, publiée à Philadelphie, qu'il y a des variations de ton et de petites bosses et tirets de couleur au-delà des lignes imprimées.
De plus, l'utilisation de pochoirs pour colorier à la main, principalement sur les cartes du XIXe siècle, peut entraîner une accumulation de couleurs le long des frontières. Si vous avez la carte ou l'atlas en main, la façon la plus précise de déterminer si la couleur est imprimée ou peinte à la main est d'utiliser une loupe grossissante d'environ 10x. Vous verrez des points individuels dans la couleur imprimée plutôt que les subtiles gradations des aquarelles.
De nombreuses cartes authentiques gravées entre 1600 et 1850 étaient, et sont encore parfois, coloriées à la main pour le marché secondaire des collectionneurs de cartes, des décorateurs et d'autres personnes qui trouvent les cartes en couleur plus attrayantes visuellement et sont prêtes à payer plus cher pour les obtenir. Il est difficile pour l'amateur de déterminer si la couleur a été ajoutée à l'époque de la publication originale de la carte ou au XIXe ou au XXe siècle, d'autant plus que de nombreuses cartes anciennes uniques proviennent d'atlas ou de livres non reliés et n'ont donc pas de provenance. Sans connaissance spécialisée des pigments et sans capacité à faire des tests sur eux, il est pratiquement impossible de dater la coloration à la main, bien que la coloration plus flamboyante de « style hollandais » soit beaucoup plus susceptible d'être un ajout ultérieur que la coloration des limites, qui ajouterait beaucoup moins de valeur monétaire et visuelle.
Pour terminer, on peut prendre un exemple excentrique et exubérant de coloriage à la main du milieu du XIXe siècle. Datant d'environ 1858, il s'agit d'une carte murale avec une projection depuis le pôle Nord, censée être destinée à l'enseignement général. Il s'agit d'une carte lithographique imprimée en bleu, qui montre à la fois des couleurs indiquant les frontières et des couleurs décoratives dans les figures des heures de la journée. Elle est entourée d'un anneau représentant les montagnes, d'un anneau représentant les constellations et de six figures féminines représentant les moments de la journée. Nous ne savons pas si le cartographe a fait le coloriage à la main, ou si c'est l'oeuvre de quelqu'un d'autre dont le nom est inconnu. Lorsque vous regardez des cartes coloriées à la main, pensez aux hommes et aux femmes méconnus qui ont rendu notre monde un peu plus lumineux avec leurs pinceaux !
Nuovo planisferio cosmografico orografico universale ed orologico mondiale per uso di generale istruzione. Ignazio Villa, 1858 ? (source : Library of Congress)

Articles connexes
Créer ses propres palettes de couleurs avec Dicopal
Quand les couleurs révèlent le contenu et la matérialité des cartes. L'exemple de l’Asie orientale du milieu du XVIIe au début du XXe siècle
Quand la couleur rencontre la carte (catalogue d'exposition à télécharger)
Cartographie des noms qui servent à désigner les couleurs en Europe (Mapologies)
Donnez-moi la couleur de votre passeport, je vous dirai où vous avez le droit d'aller (Neocarto)
Ressources de la Bibliothèque du Congrès
-
sur Café géo de Paris, mardi 28 janvier 2025 : « Vivre au bord de la mer », avec Annaig Oiry
Publié: 13 January 2025, 5:36pm CET par r.a.
Mardi 28 janvier 2025, de 19h à 21h, Café de flore, salle du premier étage, 172 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris
Le premier café géo de la rentrée hivernale porte sur la question de géographie des concours d’enseignement (CAPES et agrégations) de l’année 2025. Mais en dehors des étudiants concernés par ces concours, le grand public curieux des grandes questions géographiques de la planète, et en premier lieur lieu du territoire français, aura l’occasion d’aborder les principaux aspects des espaces littoraux, en particulier ceux qui sont en rapport avec le changement climatique et l’aménagement du territoire.

L’intervenante qui animera ce café géo, Annaig Oiry, est maître de conférences en géographie à l’université Gustave Eiffel de Marne-la-Vallée et l’auteur de deux ouvrages récents : Les littoraux (Documentation Photographique, dossier n°8138, CNRS éditions, 2021) et Atlas mondial des littoraux (éditions Autrement, 2023).
Veille des Cafés géographiques sur les littoraux – janvier 2025 -
sur Café géo de Saint-Brieuc, jeudi 6 février 2025 : « Avoir un toit en Amérique latine : une approche des inégalités », avec Jean-François Valette
Publié: 13 January 2025, 5:35pm CET par r.a.
Jeudi 06 février 2025, à 18h
Amphithéâtre du lycée Renan à Saint-Brieuc
« Avoir un toit en Amérique latine : une approche des inégalités »
avec Jean-François VALETTE, maître de conférences en géographie – Université Paris 8
FLYERS CAFE GEO FEV 2025
-
sur Carte mondiale d'exposition aux risques climatiques, de conflit et à la vulnérabilité
Publié: 12 January 2025, 12:41pm CET
Le site climate-conflict.org propose une vue combinée de l’exposition aux risques climatiques, aux risques de conflit et à la vulnérabilité. Il s'agit d'une collaboration de recherche entre les partenaires scientifiques de l'Université de la Bundeswehr de Munich et de l'Institut de recherche sur l'impact climatique de Potsdam avec le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères. La carte de l'indice de vulnérabilité aux conflits climatiques (CCVI) identifie les zones du monde où le changement climatique et les conflits sont susceptibles de se produire, et où les populations sont vulnérables à ces risques. L'Afrique et le Moyen Orient font partie des zones particulièrement vulnérables.

Méthodologie
L’indice de vulnérabilité au climat et aux conflits (CCVI) cartographie les risques mondiaux actuels en intégrant les risques climatiques et de conflit aux vulnérabilités locales. L’indice comprend un ensemble harmonisé de couches de données et une méthodologie de notation transparente pour rendre les régions comparables à l’échelle mondiale. Les données sont mises à jour trimestriellement et quadrillées à 0,5 degré.
Le CCVI est composé de 44 indicateurs provenant de 29 sources de données ouvertes différentes (voir la liste des indicateurs). Tous les indicateurs sont cartographiés sur la même grille spatiale et temporelle et transformés à l'aide d'une méthodologie de notation standardisée. Les scores des indicateurs sont échelonnés de 0 à 10. Le score reflète le niveau de risque relatif ou de vulnérabilité d'un indicateur en fonction de sa distribution mondiale et de son évolution dans le temps, du plus faible au plus élevé. Conformément à la définition du GIEC, les mesures des risques climatiques et de conflit prennent en compte les dangers, l’exposition et la vulnérabilité.Intérêt de ce type de carte
Le principal intérêt est d'aborder les risques de manière systémique et de traiter la question du changement climatique en lien avec d'autres types de risques.
Les dangers ne créent des risques qu’en combinaison avec l’exposition et la vulnérabilité. Par exemple, le fait qu’une sécheresse (aléa) entraîne des pertes de récoltes dépend non seulement de l’événement lui-même, mais aussi du fait qu’il se soit produit là où il y a des cultures (exposition) et que les champs soient irrigués et qu’une quantité suffisante d’eau provenant d’autres sources soit ou non disponible (vulnérabilité). Il est essentiel de comprendre et d’évaluer ces interactions pour gérer et atténuer les impacts négatifs des risques climatiques et des conflits dans un contexte de changement climatique.
Utilisation des données
Les données du CCVI sont sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International - pas d’utilisation commerciale. Elles sont disponibles en téléchargement au format tsv et parquet. La maille de résolution est celle de carrés de 55 km de côté environ à l'échelle de la planète.
Lien ajouté le 16 janvier 2025
Le rapport de l'IofA Planetary Solvency – finding our balance with nature. Global risk management for human prosperity publié en janvier 2025 met en évidence notre sous-estimation collective du risque climatique. Il existe une large gamme d’estimations de pertes de PIB allant de moins de 5 % à environ 25 % en 2050. Les auteurs affirment que « ces dommages dépassent déjà les coûts d’atténuation nécessaires pour limiter le réchauffement climatique à 2°C », c’est-à-dire qu’il sera extrêmement positif sur le plan économique de limiter le réchauffement climatique. Cependant, cette estimation exclut bon nombre des risques les plus graves auxquels on s’attend désormais si nous ne parvenons pas à limiter le réchauffement climatique. Outre l’hypothèse selon laquelle une récession économique est impossible, quelle que soit la gravité des chocs climatiques, l’approche ne prend pas en compte les impacts des points de basculement climatiques, les événements extrêmes liés au climat, les impacts sur la santé humaine, les conflits liés aux ressources ou aux migrations, les tensions géopolitiques, les risques liés à la nature ou à l’élévation du niveau de la mer.Les auteurs eux-mêmes reconnaissent que si ces facteurs supplémentaires étaient pris en compte, l’impact économique réel serait probablement plus important que celui estimé dans leur étude. Cela revient à effectuer une évaluation des risques de l’impact du Titanic sur un iceberg, mais en excluant de notre modèle la possibilité que le navire puisse couler, la pénurie de canots de sauvetage et la mort par noyade ou l’hypothermie. Les résultats modélisés seraient rassurants mais dangereux car ils sous-estimeraient considérablement le niveau de risque. En d’autres termes, même si les résultats montrent une réduction très importante du PIB de 15 % d’ici 2050, il se peut qu’il s’agisse d’une sous-estimation car elle ne tient pas compte de tous les risques à prévoir.
Cependant, certains décideurs politiques continuent d’utiliser l’estimation des dommages de Nordhaus pour justifier l’affirmation selon laquelle bien que le changement climatique soit préoccupant, il ne constitue pas une priorité immédiate en raison de l’impact négligeable attendu de 2 % du PIB d’ici 2100 avec un réchauffement de 3 °C. Une analyse plus approfondie des hypothèses sous-jacentes à cette estimation montre qu’en plus d’exclure de l’analyse de nombreux risques actuellement attendus, elle exclut également 87 % de l’économie de l’analyse, en supposant qu’un certain nombre de secteurs seront négligeablement affectés par le changement climatique. Bien que les modèles fournissent généralement une documentation complète des hypothèses et des limites, peu de décideurs politiques sont susceptibles de les comprendre pleinement. Cela augmente la probabilité que les décisions politiques soient basées sur des résultats de modèles qui sous-estiment considérablement les risques et ne sont pas cohérents avec la science du climat. En d’autres termes, les décideurs politiques qui utilisent ces résultats de modèles peuvent accepter des niveaux de risque bien plus élevés qu’ils ne le pensent.
Articles connexes
Carte de répartition des risques naturels en France métroplitaine (IGN)
Rapport du Forum économique mondial sur la perception des risques globaux
Les risques globaux prévus en 2021 selon le site Control Risks
Etudier les risques de pénurie d'eau dans le monde avec l'Atlas Aqueduct du WRI
Analyser et discuter les cartes de risques : exemple à partir de l'Indice mondial des risques climatiques
Aborder la question de l'inégalité des pays face au changement climatique
La France est-elle préparée aux dérèglements climatiques à l'horizon 2050 ?
Data visualisation sur la responsabilité et la vulnérabilité par rapport au changement climatique
Atlas climatique interactif Copernicus -
sur Étude des mobilités étudiantes à partir des données INSEE et Parcoursup
Publié: 12 January 2025, 9:16am CET
Source : « En 2022, 58 % des nouveaux bacheliers quittent leur zone d’emploi en entrant dans l’enseignement supérieur » (Insee Première, n° 2031, janvier 2025).
L'INSEE a publié début janvier 2025 une étude intéressante sur les mobilités étudiantes à partir des données Parcoursup. L'analyse est conduite à partir des données de 2022 et à l'échelle des 306 zones d'emploi en France (une échelle d’analyse géographique de la mobilité plus fine que les académies). Elle concerne aussi bien l'hexagone que les départements d'outre mer.
En 2022, 58 % des nouveaux bacheliers quittent leur zone d’emploi en entrant dans l’enseignement supérieur. Peu de zones d’emploi sont dépourvues d’établissement d’enseignement supérieur, mais l’offre de formation postbac est plus concentrée dans les grandes agglomérations que la population des lycéens. En 2022, parmi un demi-million de néo-bacheliers résidant en France, 58 % quittent la zone d’emploi de leur domicile au moment du baccalauréat pour rejoindre la formation qu’ils ont acceptée, et 17 % changent de région du fait de cette inadéquation.
Les néo-bacheliers sont plus mobiles quand ils viennent d’une zone d’emploi peu pourvue en formations, sont d’origine sociale favorisée au regard des chances de réussite scolaire, ou obtiennent un baccalauréat général ou une mention Très bien. Ils se déplacent aussi plus souvent pour rejoindre les filières les plus concentrées sur le territoire comme les écoles d’ingénieurs et de commerce. Ces facteurs de mobilité se retrouvent à la fois dans les vœux confirmés sur Parcoursup et dans les vœux acceptés.
Part de néo-bacheliers ayant quitté leur zone d’emploi d’origine à leur entrée dans l’enseignement supérieur (source : Insee)
Parmi les néo-bacheliers mobiles, ceux d’origine sociale très favorisée, provenant de lycées privés ou rejoignant une école de commerce, une école d’ingénieurs ou une classe préparatoire aux grandes écoles sont aussi ceux qui se déplacent le plus loin de leur domicile au moment du baccalauréat. À l’inverse, les néo-bacheliers qui changent le moins souvent de région pour leurs études se destinent à un PASS (5 %), à un BTS ou à une licence accès santé (LAS). Les zones d’emploi dont l’offre est inférieure de plus de 20 % au nombre de néo-bacheliers ont 7 fois moins d’entrants que de sortants. C’est le cas des zones d’emploi résidentielles, ou spécialisées dans les secteurs de l’industrie, du tourisme ou de l’agriculture : plus de 80 % des néo-bacheliers les quittent à l’entrée dans l’enseignement supérieur.
L'un des principaux intérêts de cette étude est de montrer que les mobilités étudiantes ne dépendent pas uniquement de l'offre de formation. Elles sont liées également à l'origine sociale, au sexe, au niveau et au profil des étudiants. Les données disponibles en téléchargement permettent de conduire des analyses plus détaillées et de produire ses propres cartes. Une série d'études à l'échelle régionale permet aussi d'approfondir l'analyse :
- « Orientation post-bac : les bacheliers préfèrent la filière à la proximité. Enseignement supérieur en Auvergne-Rhône-Alpes » (Insee Analyse Auvergne-Rhône-Alpes).
- « Plus d’entrées en BTS qu’ailleurs, peu de départs vers l’Hexagone. Orientations et mobilités post-bac à La Réunion » (Insee Analyse Réunion).
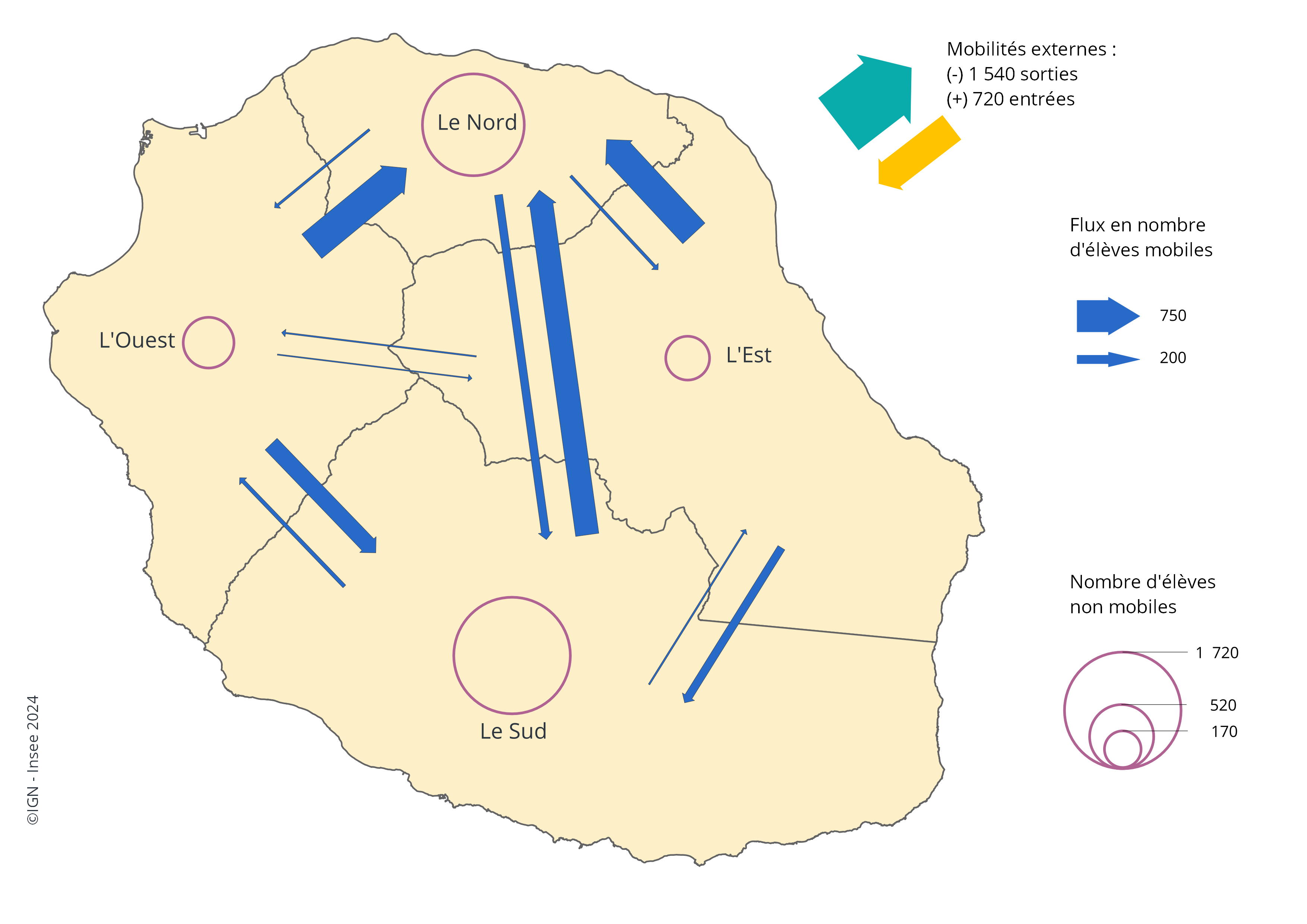
Articles connexes
Géographie de la formation et de la mobilité étudiante d'après une étude de l'Insee
Cartographier les flux de mobilité étudiante en Europe et dans le monde
Publication des données Parcoursup en open data sur le site Data.gouv.fr
Que vaut la data map qui géolocalise les voeux des candidats sur Parcoursup ?
Etudier les mobilités scolaires à partir des données de déplacements domicile-études de l'Insee
Étudier les mobilités résidentielles des élèves à partir des statistiques de la DEPP
Étudier les mobilités résidentielles des jeunes Américains à partir du site Migration Patterns
Le Mobiliscope, un outil de géovisualisation pour explorer les mobilités urbaines heure par heure
Portail des mobilités dans le Grand Paris (APUR)
CAPAMOB, un guide du Cerema pour réaliser des diagnostics de mobilités en territoire rural ou péri-urbain - « Orientation post-bac : les bacheliers préfèrent la filière à la proximité. Enseignement supérieur en Auvergne-Rhône-Alpes » (Insee Analyse Auvergne-Rhône-Alpes).
-
sur Café géo de Saint-Malo, 18 janvier 2025 : Géohistoire des humains sur la Terre, avec Marion Chalot
Publié: 11 January 2025, 6:12pm CET par r.a.
Samedi 18 décembre 2025, de 16h30 à 18h30, Salons de l’Hôtel de l’Univers, Place Chateaubriand, Saint-Malo
microcentrale6
-
sur Itinéraires de randonnée hivernale sur les massifs montagneux français (Géoportail)
Publié: 11 January 2025, 11:27am CET
La Fondation Petzl, en coopération avec le site Skitourenguru.ch, a entrepris de numériser la plupart des itinéraires de randonnée hivernale des Alpes pour les diffuser sur le Géoportail, le portail national de la connaissance du territoire mis en œuvre par l’IGN. Depuis l’automne 2021, la fondation Petzl et Skitourenguru.ch numérisent l’ensemble des courses classiques de ski de randonnée et de raquettes à neige des Alpes françaises. Près de 4000 itinéraires sont actuellement tracés à l’aide d’un logiciel de cartographie également appelé “système d’information géographique” (SIG).
.png)
Le principe consiste à tracer les itinéraires les plus sûrs en évitant autant que possible les terrains avalancheux. Le numériseur peut afficher plusieurs couches d’informations qui lui permettent de louvoyer à l’écart des zones les plus critiques. Sur une carte IGN classique au 1 : 25 000, il consulte la carte des pentes, la carte des terrains avalancheux (ATHM, Avalanche Terrain Hazard Map), la photo satellite en condition estivale ou hivernale et les traces GPS enregistrées par les pratiquants lors de leurs sorties pour tenir compte des passages réellement empruntés.
Après les cartes des pentes, la Fondation Petzl et l’IGN ont conclu un nouveau partenariat en 2023 pour diffuser gratuitement les itinéraires de randonnée hivernale sur le Géoportail.
Les traces de randonnée hivernale proposées par la Fondation Petzl en coopération avec Skitourenguru.ch (traits orange) sont intégrées au fur et à mesure du cycle de production et de diffusion de la carte IGN au 1: 25 000 (SCAN 25®) . Durant cette phase transitoire, les nouvelles traces (orange) vont coexister avec les anciennes traces (traits bleus), puis progressivement les remplacer. Les pratiquants sont invités à privilégier les tracés orange proposés par la Fondation Petzl et Skitourenguru.
Voir les traces sur le Géoportail
Pour accéder à la collection de traces de randonnée hivernale : aller dans le menu Cartes (en haut à gauche de l’écran) ? Données thématiques ? Développement durable ? Risques ? Traces de randonnée hivernale
L'objectif est d’optimiser le tracé des itinéraires en période hivernale en vue de réduire le risque d’avalanche et de glissade dangereuse dans les passages délicats (voir le détail des explications dans cet article). Pour télécharger une trace sous format GPX et préparer vos courses, il est possible d'utiliser les applications Skitourenguru et Yéti
Articles connexes
Les stations de montagne face au changement climatique (rapport de la Cour des comptes)
Etudier les villes moyennes en France en utilisant les cartes au 1/25 000 du Géoportail
La carte de Cassini embellie sur le site du Géoportail
Globes virtuels et applicatifs
-
sur Le data storytelling des populations annuelles
Publié: 9 January 2025, 12:05pm CET par Éric Mauvière
Cas d’école du data storytelling, la mise à jour annuelle des populations communales (dites « de référence ») se dévoile chaque décembre dans un ballet parfaitement réglé : l’Insee publie le même jour un « Focus » national et 17 « Flash » régionaux, immédiatement amplifiés par la presse locale et nationale.
Grande gagnante de la remise des prix : l’Occitanie ! À vrai dire, ce n’est pas nouveau, la vitalité démographique de cette région est régulièrement soulignée. Mais cette année, deux seuils symboliques sont en passe d’être franchis.
Capitale régionale, Toulouse (la commune) parait sur le point de dépasser Lyon, en nombre d’habitants au 1er janvier 2022 – date de référence de la mise à jour. Avec Montpellier, elle continue de progresser à vive allure, avec les plus forts taux de croissance observés parmi les villes de plus 200 000 habitants. Plus globalement, la région Occitanie talonne désormais la Nouvelle-Aquitaine, après avoir doublé, l’année précédente, les Hauts-de-France. C’est parmi les régions de l’Hexagone celle qui progresse le plus vite. Au niveau national, seules la Guyane et la Corse la devancent (peut-être aussi Mayotte, dont les chiffres ne sont pas connus).
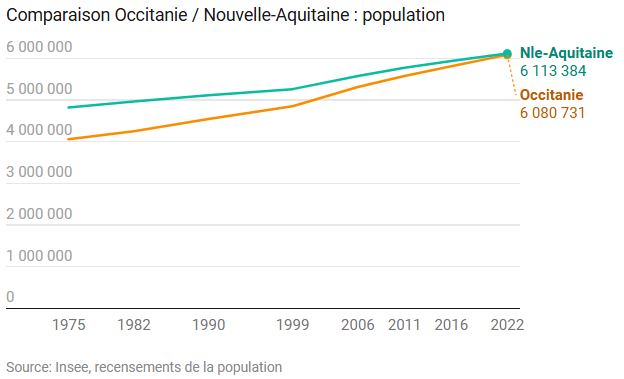
Ce qui explique le dynamisme occitan, ce n’est pas la natalité, mais bien plutôt la formidable attractivité de la région : des étudiants et des jeunes actifs viennent aimantés par les métropoles de Toulouse et de Montpellier ; des retraités affluent de régions plus septentrionales, tout particulièrement friands des franges méditerranéennes.
Voilà pour le storytelling, même s’il provient davantage des commentaires enthousiastes de la presse et des politiques que des plus posés statisticiens de l’Insee Occitanie. Ceux-ci s’efforcent, dans leur analyse, d’en dire un peu plus ; mais le discours technique qu’ils ont appris à tisser est, pour le profane, parfois difficile à démêler.
Car si la notion de population parait simple à saisir, il n’en va pas de même pour la méthode de mesure (l’enquête annuelle de recensement), les indicateurs clés (taux d’évolution annuel moyen, solde naturel et solde migratoire apparent…) ou les grilles géographiques (qu’est-ce qu’une ville, une métropole, comment définir le rural et ses divers degrés de « profondeur » ?).
L’Occitanie, c’est aussi ma région, et la pédagogie par les graphiques, une de mes passions. Voyons maintenant comment résumer et expliquer en 15 images la vive progression de la population occitane. L’outil graphique, bien maitrisé, est un puissant révélateur ; il permet aussi de mieux mémoriser les trouvailles les plus marquantes. J’expliquerai mes choix, y compris dans la présentation des chiffres, endossant l’habit de l’explorateur statisticien et sémiologue.
L’Occitanie, c’est où, c’est quoi ?Faut-il le rappeler, l’Occitanie est une construction administrative toute récente : ce qui est évident pour les services de l’État et les collectivités territoriales de cette région – sa localisation, et surtout son étendue – ne l’est pas forcément pour tout le monde.
Une carte doit donc poser le décor : l’Occitanie est délimitée en rouge, et pour bien se figurer la croissance de la population, exprimons-là d’abord en volume (habitants perdus ou gagnés) et par an.
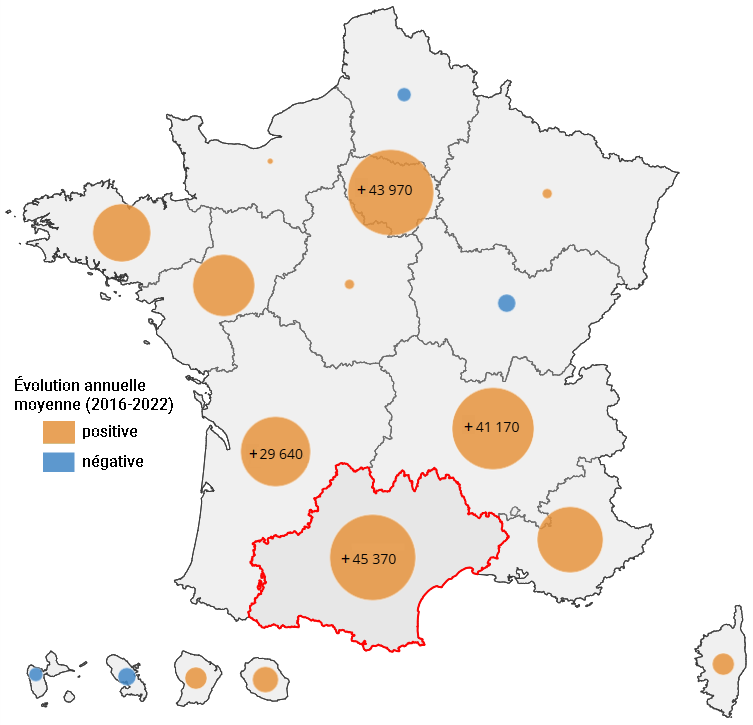
Rares sont les régions qui ont perdu de la population entre 2016 et 2022.
L’ordre de grandeur des sept plus forts gains annuels est celui de la population d’une ville moyenne, entre 30 000 et 50 000 habitants. C’est une concrétisation assez facile à se représenter. Dans un bel ensemble, plusieurs services régionaux de l’Insee en filent du reste l‘image dans leurs « Flash » : chaque année, Paca « gagne l’équivalent de la population d’une commune comme Montélimar », la Nouvelle-Aquitaine s’accroit d’un nouvel Angoulême, et pour l’Occitanie l’Insee donne l’équivalence de Sète ou d’Alès (j’aurais, en bon Midi-Pyrénéen, proposé aussi Tarbes). Quoi qu’il en soit, c’est bien en Occitanie que le gain, en valeur absolue, est le plus élevé.
Bien que les chiffres soient mis à jour chaque année, la population et ses évolutions s’analysent par fenêtres de 5 ou 6 ans. En effet, le recensement de la population est désormais un sondage glissant. En 5 ans (ou 6 ans dernièrement du fait de la pause Covid), chaque habitant des petites communes (moins de 10 000) aura été recensé, et 40 % de ceux des grandes. Ce recul de 5 ou 6 ans est donc nécessaire pour disposer d’une photographie précise des évolutions. La période 2016-2022 sera par la suite comparée à la période précédente : 2011-2016.
Place aux départements, dont le maillage est plus équilibré que celui des régions, ce qui rend les comparaisons en volume un peu plus pertinentes. Avec +18 010 habitants par an, la Haute-Garonne est dans le duo de tête avec la Gironde.
J’ai bien en tête que vous, lecteur et lectrice, ne savez pas tous forcément où se trouvent la Haute-Garonne et la Gironde, mais j’en ai dit et dessiné assez pour que vous les situiez…
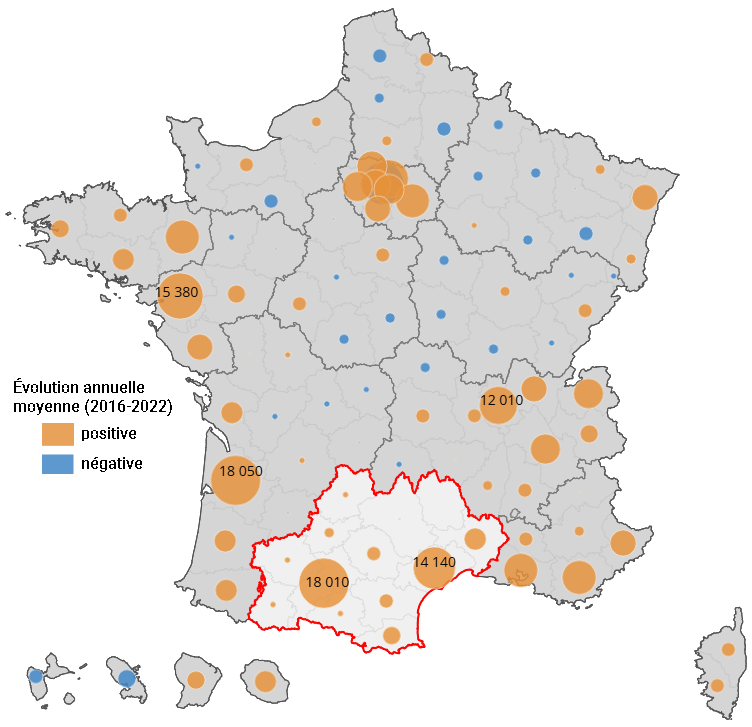
Face à la Nouvelle-Aquitaine ou Auvergne – Rhône-Alpes, considérez la belle assise de l’Occitanie, bénéficiant de la poussée combinée des métropoles de Toulouse et Montpellier.
Qu’est-ce qu’un taux d’évolution annuel moyen ?Par la suite, et pour asseoir plus correctement les comparaisons entre territoires, je vais rapporter ces progressions à la population de départ, comme le fait l’Insee. Le taux d’évolution de la population sur 2016-2022 est calculé en progression annuelle, pour qu’on puisse le comparer avec le taux observé entre 2011 et 2015, dont le pas est différent (6 ans versus 5 ans).
À l’échelle de l’Occitanie, le taux d’évolution 2016-2022 s’établit à 0,77 %, il est très proche de celui observé entre 2011 et 2016.
Comme la plupart des pourcentages, il est difficile de se représenter un tel chiffre, surtout quand il est très faible. En fait, cela veut dire que, chaque année sur la période 2016-2022, la population est multipliée par 1,0077.
Ainsi, pop2022 = pop2016 * 1,0077 * 1,0077 * 1,0077 * 1,0077 * 1,0077 * 1,0077
Ce 0,77 % se calcule donc à partir de la racine sixième de pop2022 / pop2016, mais je vous fais grâce de la formule…
On peut dire aussi que pour 10 000 habitants au départ, on se retrouve un an plus tard avec 77 personnes de plus !
Les deux moteurs des mouvements de populationL’Occitanie progresse à un rythme deux fois plus élevé que la moyenne française.
J’arrondis ici un peu violemment, car le rapport exact entre ces deux rythmes est de 0,77 / 0,35 = 2,2, mais truffer son discours de chiffres et de décimales le rend rarement plus lisible. Le lecteur retiendra bien mieux un ordre de grandeur et ira dans les tableaux chercher, s’il le souhaite, les valeurs exactes.
Comme le détaille le graphe suivant, le taux d’évolution peut – et c’est magique – se décomposer en deux facteurs : le solde migratoire exprime la différence entre les arrivées et les départs de personnes, le solde naturel entre les naissances et les décès. Et c’est bien ainsi que bouge en continu la population de ma commune : des enfants naissent, des personnes meurent, de nouveaux ménages s’installent dans ce lotissement récent, mes voisins déménagent et une famille moins nombreuse les remplace…
Alors qu’en moyenne en France, solde naturel et solde migratoire contribuent de façon égale à la progression, en Occitanie, ce sont les seules migrations qui expliquent le gain de population. Pour 10 000 habitants en moyenne en France, un an plus tard on en a 18 de plus avec les migrations et 16 du fait de la balance naturelle. En Occitanie, on se retrouve avec 77 personnes de plus, en quasi-totalité du fait des migrations.
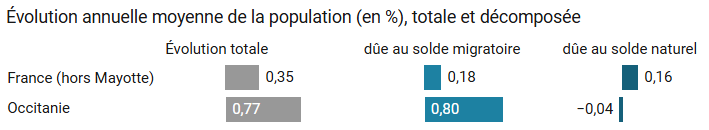
Le détail des 13 départements de la région Occitanie expose trois autres faits remarquables : partout la population progresse (même si très faiblement en Lozère) et les contributions migratoires sont significatives (>= 0,5 %). Elles contrebalancent l’effet du solde naturel, négatif ou quasi nul presque partout, sauf en Haute-Garonne où les deux composantes se renforcent mutuellement.
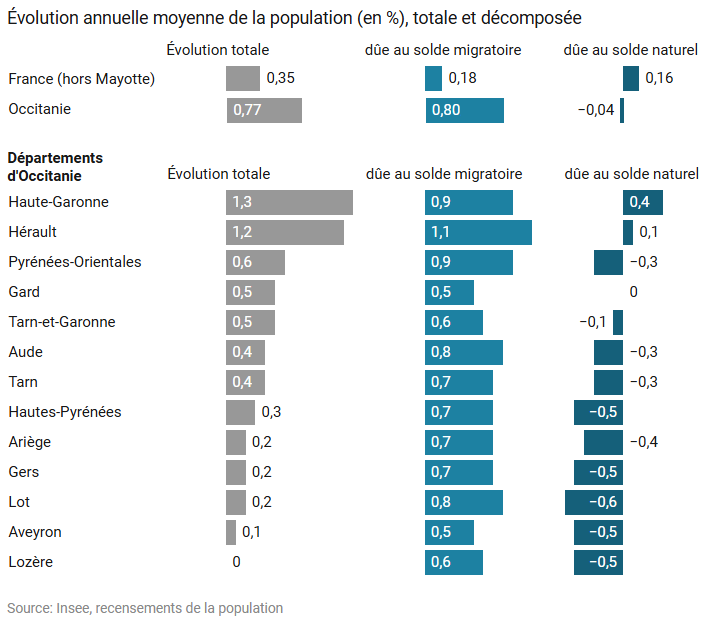
Ce qui dans la note de l’Insee était un tableau alphabétique mérite vraiment d’être mis en graphe, trié par ordre décroissant. Je présente le solde migratoire avant le solde naturel pour une meilleure continuité visuelle.
Le lecteur attentif aura noté la différence de précision entre les deux premières lignes et celles détaillées par département : deux chiffres après la virgule, ou un seul. Curieusement, alors que les populations de référence font historiquement l’objet d’un culte « à l’unité près » (voir le titre « 6 080 731 habitants en Occitanie »), l’Insee diffuse ses taux d’évolution avec un seul chiffre, comme si soudain il n’était plus aussi sûr de la précision de ses données. Le « Focus » national y fait exception, et c’est pour cela que dans le graphique précédent, les taux nationaux ont deux décimales et les taux des départements occitans une seule.
Je suis pour ma part partisan de l’arrondi (à la dizaine ou la centaine), toujours plus lisible, des chiffres de population dès qu’ils sont agrégés au delà de la commune, mais en faveur d’un taux d’évolution à deux chiffres quand il faut comparer deux valeurs.
Par exemple, les taux d’évolution de population à Toulouse et Montpellier sont respectivement, recalculés par mes soins, de 1,23 % et 1,45 %, soit un écart de 0,22 point, mais publiés avec un écart apparent de 0,3 point sous la forme arrondie 1,2 % / 1,5 %.
Qu'est-ce qui a changé ces dix dernières années ?Le portrait dressé jusqu’à présent, sur la période 2016-2022, n’est pas très différent de l’analyse que l’on pouvait faire, il y a un an, de la fenêtre précédente (2015-2021). Élargissons donc la perspective en remontant le temps, et comparons 2011-2016 et 2016-2022.
Apparait alors un autre fait remarquable : le moteur migratoire accélère (ou se maintient) dans la plupart des départements. Et plutôt nettement dans des territoires assez peu peuplés comme la Lozère, l’Ariège ou le Lot. C’est peut-être bien là l’information majeure à retenir des chiffres publiés cette année.
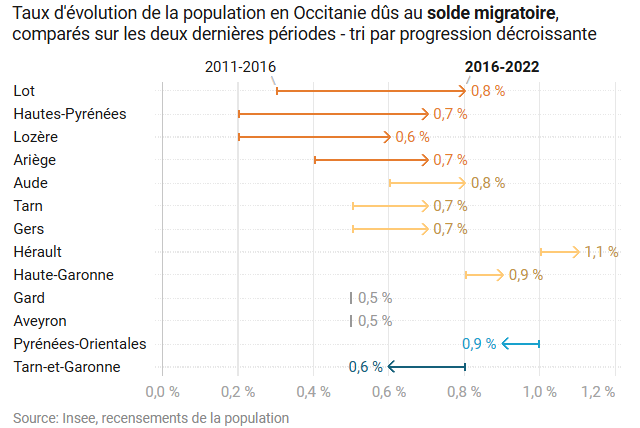
Ce graphique, trié selon l’intensité de la variation d’une période à l’autre (la largeur des flèches), met en évidence quatre groupes, soulignés par un léger dégradé de couleurs.
À ce stade, le lecteur peut s’interroger : mais qu’est-ce qui explique cette attractivité forte et même croissante de l’Occitanie ? L’exercice annuel de l’Insee est très cadré (en nombre de caractères et de graphiques) et ne répond pas vraiment à cette légitime curiosité. Les Flash et Focus sur les populations de référence pour l’essentiel commentent des tableaux à partir des dernières données de comptage du recensement et de l’état civil, ils ne cherchent pas à faire de la pédagogie sur les causes.
Je suis donc allé chercher des réponses dans la bibliothèque et, bonne pioche, l’Insee a publié en partenariat avec la Région un dossier fouillé sur les migrations résidentielles en Occitanie. C’était fin 2020, ce n’est pas si vieux, je fais l’hypothèse que les migrations obéissent à des lois relativement stables à court-moyen terme.
En voici quelques extraits : « La quasi-totalité des territoires bénéficient de l’attractivité de la région et gagnent des habitants au jeu des migrations externes. 60 % des nouveaux arrivants viennent des trois régions voisines ou de l’Île-de-France. 18 % de l’étranger, mais cette part est inférieure à la moyenne nationale.
Outre étudiants et cadres réputés mobiles, les nouveaux arrivants sont aussi des chômeurs et des seniors. L’Occitanie est plus attractive vis-à-vis des couples sans enfant, des chômeurs et des seniors que les autres régions métropolitaines. Dans de nombreux territoires du littoral ou de l’arrière-pays méditerranéen, au moins un arrivant sur cinq est retraité. »
En réalité, l’Occitanie brasse beaucoup : « C’est une région que l’on quitte aussi, mais les arrivants (25 pour 1 000 hab. chaque année) sont plus nombreux que les sortants (15 pour 1 000 hab.). »
La baisse des naissances s’accélère,
le déficit naturel se creuseDepuis 2012, les naissances reculent dans la région, alors que les décès augmentent. Le solde naturel est devenu négatif en 2017 et ne cesse de se creuser depuis. Les derniers chiffres 2023 confirment cette tendance et laissent supposer que le dynamisme de la population occitane ne sera plus aussi vif à l’avenir – ou alors il faudrait que les migrations augmentent encore davantage…
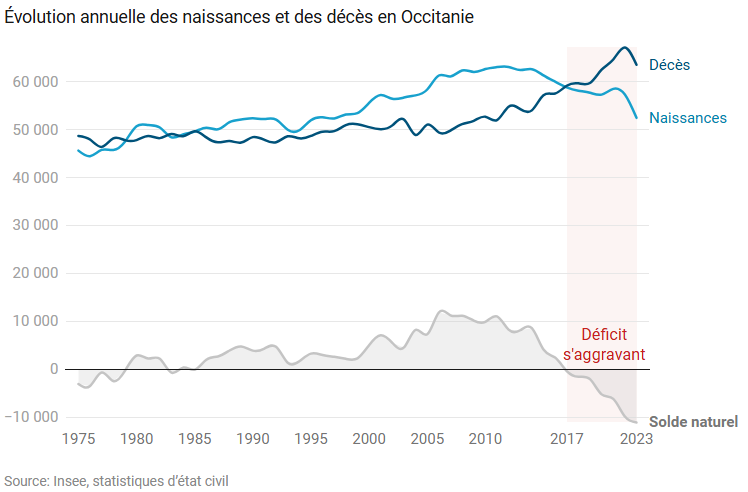 Le graphique ci-dessus est reconstruit à partir d’une étude récente de l’Insee, qui prodigue d’éclairantes explications : « En Occitanie, la baisse de la fécondité explique à elle seule le fort recul des naissances en 2023, car la population en âge d’avoir des enfants progresse légèrement. En 2023, la fécondité recule fortement. L’indicateur conjoncturel de fécondité s’établit à 1,53 enfant par femme contre 1,67 en 2022 . L’Occitanie est la 4e région de France où les femmes ont le moins d’enfants, derrière la Corse, Grand Est et Nouvelle-Aquitaine. »
Villes et campagnes, quelles différences ?
Le graphique ci-dessus est reconstruit à partir d’une étude récente de l’Insee, qui prodigue d’éclairantes explications : « En Occitanie, la baisse de la fécondité explique à elle seule le fort recul des naissances en 2023, car la population en âge d’avoir des enfants progresse légèrement. En 2023, la fécondité recule fortement. L’indicateur conjoncturel de fécondité s’établit à 1,53 enfant par femme contre 1,67 en 2022 . L’Occitanie est la 4e région de France où les femmes ont le moins d’enfants, derrière la Corse, Grand Est et Nouvelle-Aquitaine. »
Villes et campagnes, quelles différences ?
Le graphique suivant par catégorie d’espace, tiré du Flash de l’Insee Occitanie, est à l’origine de cet article : n’y voyant rien de facilement mémorisable, j’ai voulu en construire une version plus pédagogique. Certes, il est correct sur le plan sémiologique : les barres sont proportionnelles à la valeur de l’indicateur, la couleur distingue les deux périodes. Mais ce rouge vif fait mal aux yeux, et il met en évidence non pas la dernière période, mais la précédente. Le graphique est trié selon l’ordre de la nomenclature et pas en fonction des valeurs, si bien que l’on voit alterner des ralentissements et des progressions : en faire la synthèse demande un gros effort cognitif.
Enfin, je me suis demandé d’où venait cette typologie des catégories d’espace, et notamment la définition du rural non périurbain, dont le graphique laisse d’ailleurs à penser, si l’on n’est pas attentif, qu’il ne représente rien en Occitanie…
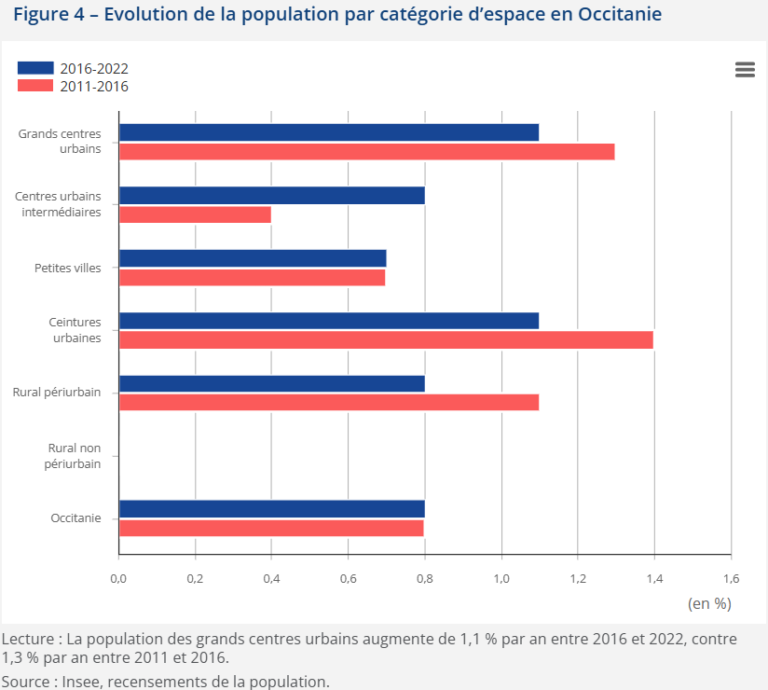
Mais sur le fond, ce qui m’a troublé le plus, c’est qu’après avoir vu vanter dans le Flash Insee la vigoureuse croissance de Toulouse et Montpellier, son accélération même en 2016-2022, voilà que la catégorie « grands centres urbains » de la région m’apparait globalement ralentir ! Quels sont donc, au juste, ces grands centres urbains d’Occitanie ?
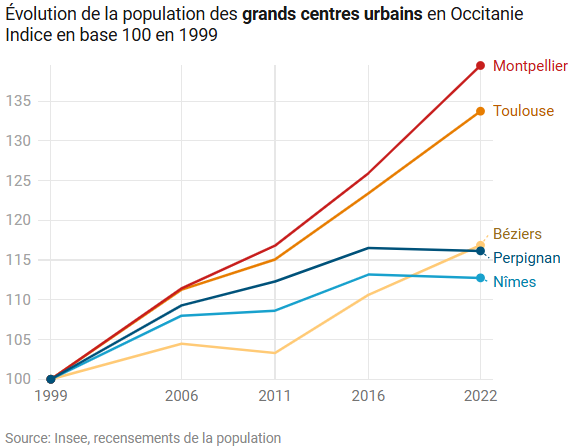
Après quelques efforts pour comprendre et reconstruire cette typologie communale (elle n’est pas explicitée dans l’étude), j’isole 5 grands centres urbains, qui se divisent en 3 groupes :
- Toulouse et Montpellier, en accélération,
- Béziers, en croissance un peu ralentie,
- Nîmes et Perpignan, qui soudain marquent le pas (et même décroissent un peu).
Que se passe-t-il donc à Nîmes et Perpignan ? Voilà un nouvel angle d’exploration pour souligner ce qui est en train de changer dans la région. Mais je n’ai pas de quoi éclairer ce retournement.
Cette catégorie des grands centres urbains m’apparait donc trop hétérogène pour figurer dans un graphique.
Examinons maintenant la forte évolution opposée, l’accélération des « centres urbains intermédiaires ». Une carte les présentant arrive bientôt. J’isole dans le graphique suivant les villes les plus importantes et, par la couleur, je souligne les inflexions majeures, qui expliquent la montée en force de cette catégorie d’espace.
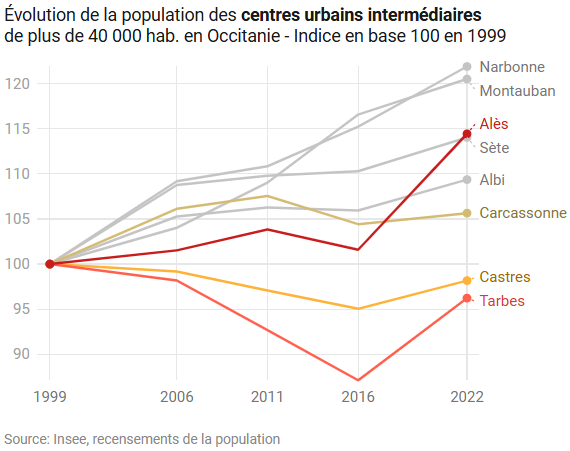
Alès et Tarbes, en particulier, rebondissent de façon spectaculaire, affichant une vive croissance après une période de baisse – baisse assez ancienne dans le cas de Tarbes.
Que se passe-t-il donc à Alès et Tarbes, voire Castres ou Carcassonne ? Je n’ai pas d’explication à ce stade. Mais c’est à nouveau un bel angle journalistique.
Voici donc ma reconstruction du graphique de synthèse de l’Insee, celui avec les barres rouges et bleues : j’isole Toulouse et Montpellier, et je dégage trois groupes de croissance, chacun trié. La stabilité du rural non périurbain est cette fois-ci clairement indiquée, et c’est aussi un fait marquant : les campagnes et bourgs ruraux éloignés des grands pôles urbains ne perdent globalement pas de population, et c’est grâce aux migrations.
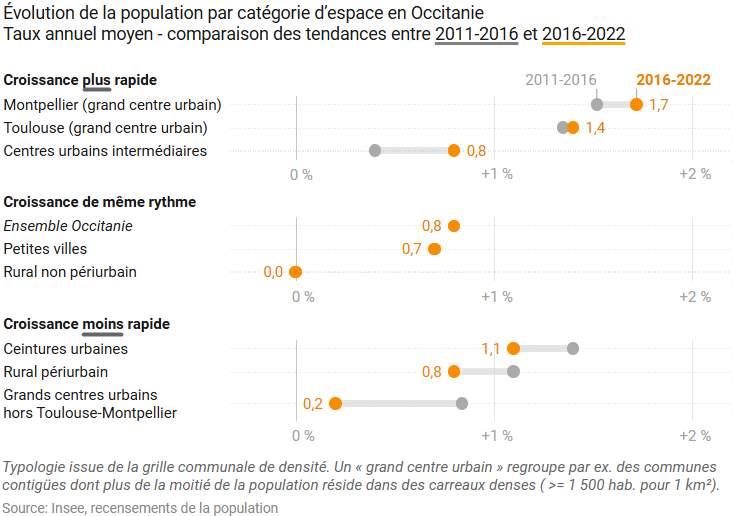
Pas très documentée par l’Insee, cette nouvelle typologie des catégories d’espaces est un hybride de deux typologies mieux connues : la grille communale de densité et le zonage en aires d’attraction des villes (AAV). Mise en carte, cette typologie apparait assez élégante – et j’ai toujours eu un faible pour les typologies spatiales.
Ce qui dans la grille communale de densité est décrit comme rural, dans cette nouvelle catégorisation se subdivise :
- en un « rural périurbain », des communes rurales dans une aire d’attraction des villes de plus de 50 000 habitants,
- et le reste du rural, dénommé « non périurbain ».
Ainsi, l’Ariège ou la Lozère sont presque entièrement, hors quelques villes, dans un « rural non périurbain », car les aires d’attraction de Saint-Girons (ouest de l’Ariège), Foix-Pamiers ou Mende comptent moins de 50 000 habitants.
En Occitanie, ces catégories d’espace traduisent un bel équilibre, elles représentent chacune une part substantielle de population, et quatre d’entre elles voisinent ou dépassent le million d’habitants.
J’arrondis ici les chiffres à la centaine, pour un abord bien plus amical.
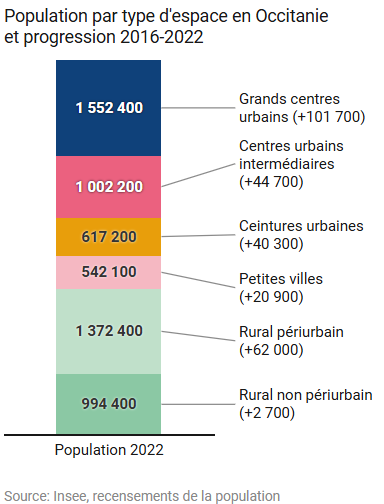 Qu’est-ce qu’une ville ?
Qu’est-ce qu’une ville ?
À la lecture des publications de l’Insee sur les populations de référence, lecteurs et lectrices peuvent ressentir un léger flottement face aux multiples définitions d’une ville, par exemple comme Toulouse : il peut s’agir de la commune, de l’agglomération ou d’un « grand centre urbain ».
Mais cette diversité d’approches se justifie. Pour accueillir de nouveaux habitants, une commune se verra contrainte par ses limites, ses réserves foncières ou ses possibilités de transformation de friches industrielles en espaces habitables. En conséquence, la commune n’est pas le cadre le plus adapté pour comparer deux pôles en expansion, qui vont « s’étaler » en densifiant les communes périphériques.
L’agglomération se définit d’abord par la reconnaissance d’espaces où le bâti est continu (moins de 200 m) et regroupe au moins 2 000 habitants. Si une commune comprend un tel espace, elle est urbaine. Si de plus la moitié de sa population au moins réside dans cet espace continu, cette commune est susceptible de former avec une autre voisine et répondant au même critère une « agglomération ».
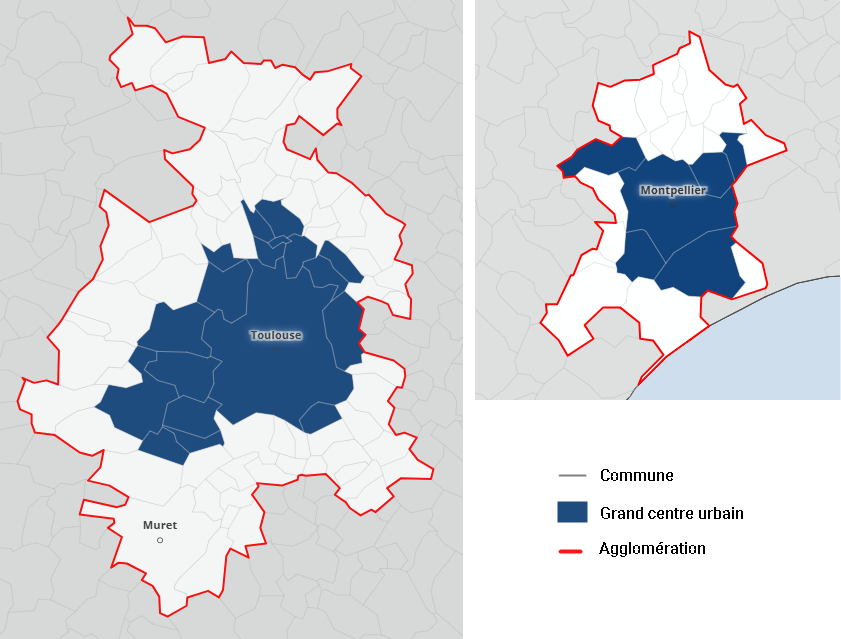
Ainsi, une agglomération peut s’étendre assez loin autour d’un centre, voire de multiples centres, tout en comprenant de vastes zones agricoles ou naturelles.
L’agglomération de Toulouse comprend 81 communes.
Le grand centre urbain est le cœur dense de l’agglomération : la méthode de délimitation, européenne, ignore elle-aussi dans un premier temps les limites communales et agrège des carreaux contigus de 1 km², chacun d’au moins 1 500 hab. et qui rassemblés finissent par dépasser 50 000 habitants. Un tel agrégat dense, ou « cluster » conduit à définir le « grand centre urbain » comme l’ensemble des communes dont la moitié de la population au moins réside dans ce cluster.
L’aire d’attraction des villes (AAV) dépasse ces critères morphologiques, comme « vus du ciel », pour y associer des communes encore plus périphériques, mais dont une part significative de la population active (15 % au moins) travaille dans le pôle centre. L’AAV de Toulouse englobe ainsi 527 communes !
Comment s’analyse le dynamisme démo-graphique de Toulouse et Montpellier selon ces différentes définitions ? Dans les deux cas, la population croit plus vite si l’on élargit le périmètre au grand centre urbain ou à l’agglo (et même à l’AAV dans le cas de Toulouse). Choisir la bonne délimitation n’est donc pas un geste neutre.
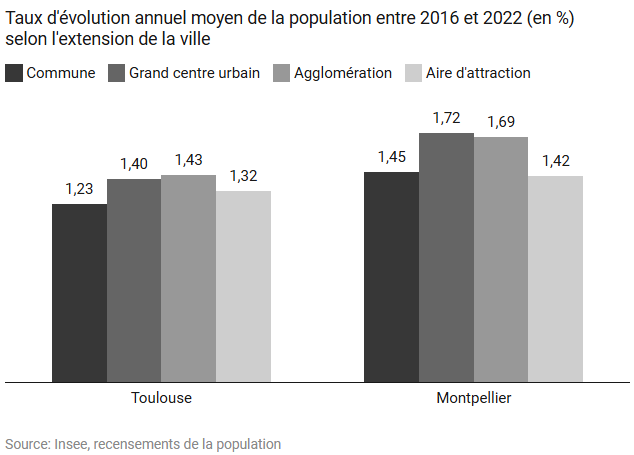 Le duel haletant Toulouse / Lyon
Le duel haletant Toulouse / Lyon
Après la conférence de presse de l’Insee, la Dépêche du Midi, le quotidien régional, n’a pas craint d’affirmer : « Il y aurait désormais plus d’habitants à Toulouse qu’à Lyon ». Et le maire de Toulouse de surenchérir : « En considérant ces résultats, nous pourrions être, aujourd’hui, la 3e ville de France. »
Au 1er janvier 2022, ce n’était pas encore le cas. Mais vu la différence de rythme avant 2022, on peut en effet imaginer que, début 2025, la commune de Toulouse a déjà dépassé celle de Lyon.
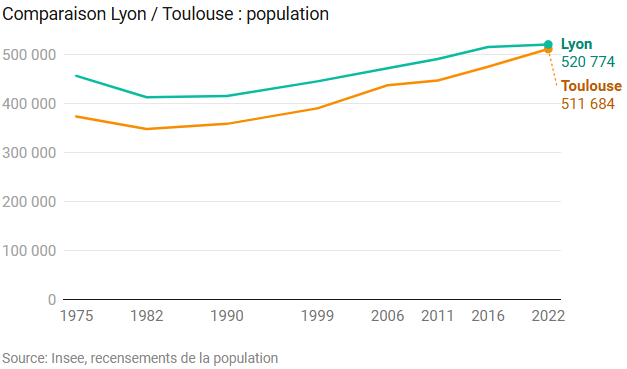
Mais il faut tout de même relativiser. En superficie, Toulouse est 2,5 fois plus grande que Lyon. Toulouse disposait et dispose encore de vastes surfaces constructibles, ce qui la rend bien plus apte à se densifier que Lyon, où la densité de population est déjà très élevée.
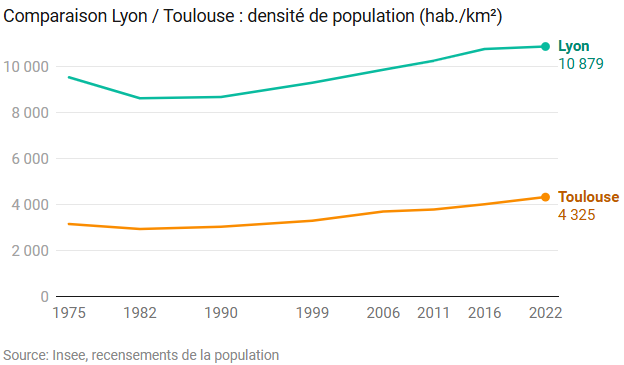
Tentons une comparaison plus équitable, en étendant le cadre de comparaison aux agglomérations et aux aires d’attraction : alors que, on l’a vu, la commune de Toulouse fait jeu égal avec Lyon, l’agglo ou l’aire d’attraction (AAV) de Toulouse ne représentent que les deux tiers de la population de l’agglo ou de l’AAV de Lyon. Ces deux métropoles ne sont pas encore comparables en volume, loin de là.
Mais, comme le montre le graphe suivant, il se confirme tout de même que la métropole toulousaine (AAV ou agglo) croit bien plus vite que la lyonnaise !
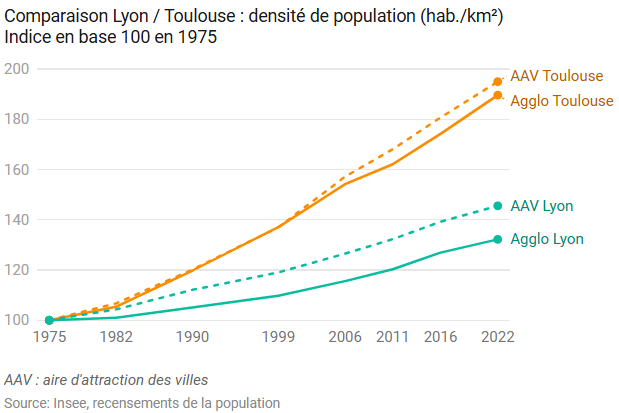 Pour en savoir plus
Publications
Pour en savoir plus
Publications- Population de référence au 1er janvier 2022 : 6 080 731 habitants en Occitanie, Insee Occitanie
- En 2023, forte baisse des naissances en Occitanie, Insee Occitanie
- Migrations résidentielles en Occitanie, Insee et Région Occitanie
- Les populations de référence des communes au 1er janvier 2022, Insee
Savoir compter, savoir conter, Daniel Temam & al., Courrier des statistiques 2009
Données et nomenclaturesPour mener mon exploration, j’ai utilisé dans un 1er temps l’outil Statistiques locales, déjà très puissant par ses capacités de sélection de zonages et de croisement d’indicateurs.
Ensuite, j’ai rassemblé les différentes ressources nécessaires, souvent disponibles dans un format excel zippé – ce qui n’est pas le plus commode – mais qui, après extraction, se manipulent fort bien avec mon outil de requête favori, DuckDB.
Cet article vous a plu ?
Découvrez nos formations sur mesure à la sémiologie graphique et au data storytelling.
L’article Le data storytelling des populations annuelles est apparu en premier sur Icem7.
-
sur La carte, objet éminemment politique : quand Trump dessine sa carte du monde
Publié: 9 January 2025, 11:10am CET
A peine élu et avant même de prendre officiellement ses fonctions pour un second mandat, le président américain Donald Trump a esquissé sa carte du monde lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le 7 janvier 2025 depuis Mar-a-Lago. Le Canada devrait, selon lui, devenir le 51e état des États-Unis pour des raisons économiques. Le Groenland sur lequel il avait déjà manifesté des vues expansionnistes, devrait être annexé au territoire américain pour des questions de sécurité nationale. Trump souhaiterait aussi récupérer le canal de Panama pour contrecarrer l'influence de la Chine. Le Golfe du Mexique devrait être renommé Golfe de l'Amérique. A l'appui de ces revendications territoriales, le président américain a publié sur son réseau Truth Social une carte fusionnant les États-Unis et le Canada avec un drapeau américain couvrant tout le territoire.

Pour un président qui ne se prive pas de dénoncer les fausses rumeurs (fakes), cette fakemap ne manque pas de saveur. Il faut dire que Donald Trump n'en est pas à son premier coup d'essai et qu'il s'était déjà arrangé avec la réalité lors du passage du cyclone Dorian en montrant une carte de trajectoire du cyclone dessinée à sa façon (#SharpieGate).
— Kenneth Field (@kennethfield) January 16, 2025
Le pouvoir performatif de la carte dont use et abuse Donald Trump a largement été relayé par les médias et les réseaux sociaux qui ont pris souvent ses déclarations au pied de la lettre, tout en s'en moquant pour une partie d'entre eux (voir par exemple cette carte-caricature de la Donroe Doctrine par le New York Post en référence à la doctrine Monroe revisitée par Donald Trump).
Le président Trump, qui se plaint régulièrement des relations avec le Canada et le Mexique qui côutent trop chères aux États-Unis selon lui, s'est dit prêt à user de la force économique si nécessaire pour parvenir à ses fins. Il est probable que ces déclarations provovatrices soient destinées à obtenir des accords commerciaux plus favorables pour les États-Unis. Les menaces d’annexion visent surtout à mettre une pression maximale sur le Panama pour réduire les droits de douane pour les navires américains. Pour rappel, le contrôle du canal de Panama achevé par les Etats-Unis en 1914, a été entièrement rendu à l'Etat du Panama en 1999, en vertu d'un accord signé par le président américain démocrate Jimmy Carter en 1977.
Dans le cas du Groenland, ce sont les richesses naturelles promises par la fonte de la banquise qui l'intéressent. L’intérêt de Trump pour le Groenland est lié à ses gisements de terres rares, essentiels pour des technologies comme les semi-conducteurs, les F-35 et l’IA. Avec 90 % des terres rares contrôlées par la Chine et la Russie, le Groenland est à même d'offrir une indépendance stratégique. L'objectif est également géopolitique de manière à contrebalancer la présence russe dans la région arctique. Le Groenland constitue un enjeu depuis l'époque de la Guerre froide avec la base américaine de Thulé.
[1/5] Donald Trump évoque l'annexion militaire du #Groenland, territoire stratégique de 2,16 M km² riche en minerais et crucial pour le passage du N-Ouest. L’île attire les convoitises, avec 25% de ses exportations dépendant de transferts danois couvrant 25% de son PIB. #HGGSP #geography #Greenland
— Patrick Marques (@pmarques35.bsky.social) 9 janvier 2025 à 10:27
[image or embed]
Cuba, Sicile, Philippines, Islande, port de Brême...
— Le Grand Continent (@Grand_Continent) January 7, 2025
Derrière les plans de Trump pour le Canada et le Groenland se trouve un projet impérialiste de «Grande Amérique»
Cartes exclusives et analyses à lire absolument [https:]] pic.twitter.com/4zsNW3Ypxh
Face aux vélléités trumpiennes d'expansion territoriale, les réactions n'ont pas tardé à se manifester dans différents pays. La présidente du Mexique Claudia Sheinbaum a riposté à la proposition de Donald Trump de renommer le golfe du Mexique, en suggérant que le territoire américain qui faisait auparavant partie du Mexique puisse s'appeler « Amérique mexicaine ». A l'appui de cette proposition, la présidente du Mexique a utilisé une carte du Mexique datant de 1607 montrant une partie des États-Unis actuels sous contrôle du Mexique (ce que l'on nomme aujourd'hui la Mexamerica).Claudia Sheinbaum was responding to the US president-elect's call for the Gulf of Mexico to be renamed the 'Gulf of America'. [https:]] pic.twitter.com/PfSxHS80od
— Financial Times (@FT) January 9, 2025
À la différence des dirigeants du Canada ou de Panama, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, n’a pas répondu aux menaces de Donald Trump proférées à Mar-a-Lago où le président élu exprimait sa volonté de s’en prendre au Danemark par la force ou par le rachat, s’il refusait de vendre le Groenland aux États-Unis. D. Trump entend peser de tout son poids pour arriver à arracher des concessions. Paris et Berlin ont condamné les menaces d’annexion. La Russie a également semblé être inquiète par les propos de D. Trump. Le Danemark a déclaré que son territoire n’était pas à vendre.[1/5] Le réchauffement climatique redessine la géopolitique mondiale. Alice Hill, experte au Council on Foreign Relations, explique que la fonte rapide des glaces en Arctique rend le Groenland stratégique pour ses ressources minières, tandis que la sécheresse perturbe le canal de Panama. #geography
— Patrick Marques (@pmarques35.bsky.social) 14 janvier 2025 à 11:55
[image or embed]
Bien qu'elles soient à prendre au sérieux pour les conséquences géopolitiques et géoéconomiques qu'elles risquent d'entraîner dans les années qui viennent, les vélléités impérialistes de Donald Trump peuvent prêter à sourire tant elles paraissent irréalistes...? URGENT : Donald Trump envisage d’annexer le Listenbourg pour son intérêt géostratégique. pic.twitter.com/PMXeFvEws6
— Olivier Varlan (@VarlanOlivier) January 8, 2025
Vilains rêves carto ?? Par Michael de Adder
— Le Cartographe ??? (@lecartographe.bsky.social) 13 janvier 2025 à 00:27
[image or embed]
Earth is flat
— Emad Hajjaj Cartoons (@EmadHajjaj) January 22, 2025
????? ???????? #Trump pic.twitter.com/mVRDUPqoG1Liens ajoutés le 20 janvier 2025
Paru en février 2019, l'ouvrage de Daniel Immerwahr How to Hide an empire. A history of the Greater United States met en lumière le côté expansionniste de l’Amérique. Nous connaissons les cartes qui délimitent les cinquante États. Nous savons aussi que les États-Unis sont un « empire » qui exerce son pouvoir dans le monde entier. Mais qu'en est-il des territoires réels – les îles, les atolls et les archipels – que ce pays a gouvernés et habités ? Le mot « empire » occupe une place particulière dans le lexique américain : il s’applique facilement à d’autres pays, mais rarement voire jamais aux États-Unis eux-mêmes (voir la conférence donnée par l'auteur en 2019 pour le Chicago Institute for the Humanities).
Le Danemark n'est pas une petite nation ! (Reddit.com/r/imaginarymaps/)Inspirée d'une ancienne carte coloniale portugaise, cette carte de propagande publiée sur Reddit est destinée à montrer l'étendue du Danemark avec ses possessions d'outre-mer. L'empire colonial danois était de fait plus étendu que celui du Portugal. Au lieu de simplement établir de petites stations commerciales le long de la Côte d'or et ailleurs, le Danemark règnait sur de vastes colonies en Inde (Tamil Nadu) et en Afrique de l'Ouest (Ghana). De plus, le Danemark possèdait la Tasmanie et les « îles Mikkelsen » de l'archipel arctique. Le Groenland, l'Islande, le Svalbard et les îles Féroé ont tous été découverts et colonisés par les Norvégiens. Ils faisaient alors partie de la Norvège (ou en font encore partie) jusqu'à ce qu'ils soient unis au Danemark. Puis, après les guerres napoléoniennes, la Suède a pris la Norvège, mais le Danemark a pu garder les territoires d'outre-mer (à l'exception du Svalbard).
Liens ajoutés le 22 janvier 2025Sur le site officiel de la Maison Blanche, l'ordonnance prise par D. Trump est présentée comme une volonté de "Restaurer les noms qui honorent la grandeur de l'Amérique" (sic).
Le changement de nom du point culminant de l'Alaska en Mont McKinley se veut tout un symbole :
"Le président William McKinley, 25e président des États-Unis, a mené héroïquement notre nation à la victoire dans la guerre hispano-américaine. Sous sa direction, les États-Unis ont connu une croissance économique et une prospérité rapides, y compris une expansion des gains territoriaux pour la nation. Le président McKinley a défendu les tarifs douaniers pour protéger l'industrie manufacturière américaine, stimuler la production nationale et porter l'industrialisation américaine et la portée mondiale vers de nouveaux sommets. Il a été tragiquement assassiné lors d'une attaque contre les valeurs de notre nation et notre succès, et il devrait être honoré pour son engagement indéfectible envers la grandeur américaine."
Concernant le golfe du Mexique rebaptisé "Golfe d'Amérique", tout un paragraphe est consacré à l'intérêt économique et stratégique de la région :"La région autrefois connue sous le nom de Golfe du Mexique a longtemps été un atout essentiel pour notre nation autrefois en plein essor et est restée une partie indélébile de l'Amérique. Le Golfe était une artère cruciale pour les premiers échanges commerciaux de l'Amérique et du monde. C'est le plus grand golfe du monde, et le littoral des États-Unis le long de cette remarquable étendue d'eau s'étend sur plus de 1 700 milles et contient près de 160 millions d'acres. Ses ressources naturelles et sa faune restent aujourd'hui au cœur de l'économie américaine. La géologie abondante de ce bassin en a fait l'une des régions pétrolières et gazières les plus prodigieuses du monde, fournissant environ 14 % de la production de pétrole brut de notre nation et une abondance de gaz naturel, et favorisant constamment de nouvelles technologies innovantes qui nous ont permis d'exploiter certains des réservoirs de pétrole les plus profonds et les plus riches du monde. Le Golfe abrite également des pêcheries américaines dynamiques regorgeant de vivaneaux, de crevettes, de mérous, de crabes de pierre et d'autres espèces, et il est reconnu comme l'une des pêcheries les plus productives au monde, avec le deuxième plus grand volume de débarquements de pêche commerciale par région du pays, contribuant à hauteur de plusieurs millions de dollars aux économies locales américaines. Le Golfe est également une destination préférée pour le tourisme et les activités de loisirs des Américains. En outre, le Golfe est une région vitale pour l'industrie maritime américaine de plusieurs milliards de dollars, offrant certains des ports les plus grands et les plus impressionnants du monde. Le Golfe continuera de jouer un rôle central dans le façonnement de l'avenir de l'Amérique et de l'économie mondiale, et en reconnaissance de cette ressource économique florissante et de son importance cruciale pour l'économie de notre pays et sa population, je demande qu'il soit officiellement rebaptisé Golfe d'Amérique."Il semble que ce paragraphe ainsi que certains autres passages des 46 décrets pris par l'Administration Trump aient été rédigés à l'aide de l'IA : un "travail bâclé et profondément discutable" selon certains analystes. La page de discussion de l’article de Wikipédia sur le Golfe du Mexique a explosé du fait que des utilisateurs sont venus exiger le changement de nom. "Quelle que soit votre opinion sur la rhétorique de Trump selon laquelle le golfe du Mexique fait partie intégrante des États-Unis, le nom du golfe du Mexique est antérieur à ce statut... vous ne pouvez forcer personne à utiliser le nouveau nom" (source : MapRoomBlog qui consacre un article à l'historique des cartes et de la manière de nommer le golfe du Mexique). Fait assez exceptionnel : le décret demande la modification du GNIS (Système d'information sur les noms géographiques), la base de données des noms officiels aux États-Unis.
Lien ajouté le 24 janvier 2025
L'expression "lac américain" était plutôt utilisée pour désigner la domination des Etats-Unis dans le Pacifique. Avec le regain d'intérêt US pour le golfe du Mexique, une nouvelle "Méditerranée américaine" en perspective ?
— Sylvain Genevois (@mirbole01.bsky.social) 24 janvier 2025 à 15:26
[image or embed]Lien ajouté le 27 janvier 2025
Carte du "Technat d'Amérique" (1940) donnant la vision du mouvement fascisant Technocracy auquel appartenait Joshua Haldeman, le grand père d'Elon Musk. "La technocratie a cherché de vastes territoires dotés de ressources abondantes pour lui permettre de s'autosuffire. Un technat est en fait une vaste étendue de terre gouvernée par une technocratie qui n'a besoin que d'un commerce minimal... Les technocrates croyaient fermement au continentalisme". On ne peut qu'être frappé par la ressemblance avec l'Amérique isolationniste défendue par Trump aujourd'hui. Bien qu'imaginaire, cette carte de l'influence des Etats-Unis va du Groenland au canal de Panama et inclut même une partie de l'Amérique du Sud.
Technate of America, 1940 (source : Wikipedia)
Lien ajouté le 31 janvier 2025Le golfe a eu de nombreux noms, du golfe de Floride au golfe de Cortès, mais il existe des preuves que le nom "Golfe du Mexique" remonte aux années 1550 (source : Historical Sketch of the Explorations in the Gulf of Mexico). On en trouve la trace sur cette carte de Mercator de 1559.
Extrait de la carte du monde de Mercator (source : Wikipédia)

En 2016, lors de la première élection du président Trump, Libération avait publié une carte du monde selon Trump (Trumpland). "Je ne suis pas le président du monde ; j'ai été élu président des Etats-Unis."
Lien ajouté le 2 février 2025Carte de Trumpland par Big © (source : Libération)
:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/BV4UGTFXQA3YA6F6JBHT7MJXSE.png)
Dans la même veine, le journal The New Yorker a publié en janvier 2025 une carte parodique du dessinateur-illustrateur Bary Blitt. Intitulée "La dernière carte autorisée et presque légale des Etats-Unis", elle représente les Etats-Unis triomphants au sein d'une Amérique du Nord quasiment entièrement annexée.
Sources
« Donald Trump : Etats-Unis + Canada + Groenland + canal de Panama… Le monde vu par le président américain en une carte » (20 minutes)
« Groenland, Panama : Donald Trump renoue avec l’impérialisme de Theodore Roosevelt » (Le Monde)
« Nouvelle nomination du golfe du Mexique : la toponymie est à l’avant-garde d’un projet impérialiste aux conséquences incommensurables » (Le Monde)
« Donald Trump Jr. au Groenland : le projet impérial trumpiste d’une Grande Amérique en deux cartes exclusives » (Le Grand Continent)
« Donald Trump dessine les contours d’un nouvel impérialisme états-unien » (Mediapart)
« La présidente du Mexique demande à ce que certaines régions des États-Unis soient rebaptisées Amérique mexicaine » (The Financial Times)
« Trump peut-il faire main basse sur le Groenland ? » (Les Echos)
« Groenland : la Première ministre danoise dit à Trump que c’est au territoire de décider de son indépendance ou non » (Libération)
« En cartes. Pourquoi Trump s’intéresse au Groenland » (Cartes en mouvement). « Groenland : les enjeux de l’Arctique » (France Culture)
« Canal de Panama : en réponse à Donald Trump, le pays affirme que sa souveraineté sur l'axe maritime n'est "pas négociable" » (France-Info)
« La carte du canal de Panama, un raccourci commercial incontournable dans l'ombre des États-Unis » (El Orden Mundial)
« C'est ironique : comment la crise climatique alimente la campagne de Trump contre le Groenland et le Panama » (The Guardian)« Golfe du Mexique, mont McKinley… Pourquoi Trump veut-il renommer des sites naturels à sa façon ? Le peut-il vraiment ? » (RTBF)
« Jeux de noms : la stratégie de Trump pour le « Golfe d'Amérique » bafoue l'histoire et la coopération internationale » (Texas Observer)
« Trump peut-il simplement ordonner de nouveaux noms pour le Denali et le golfe du Mexique ? » (The Conversation). La géographe Innisfree McKinnon analyse les processus officiels de renaming aux USA gérés par le U.S. Board on Geographic Names. Elle s’intéresse aux débats sur des lieux emblématiques comme Denali ou le Golfe du Mexique, et aux implications géopolitiques.
« Google Maps va renommer le « Golfe du Mexique » en « Golfe d'Amérique » uniquement pour les utilisateurs américains et lorsque le changement de nom aura été reconnu dans les cartes officielles » (Reuters).
Articles connexes
Le monde vu à travers les tweets de Donald Trump
L'attaque du Capitole reconstituée en cartes et en vidéosLes pays bénéficiaires de l'aide des Etats-Unis depuis 1945
Qu'est-ce que le Listenbourg, ce nouveau pays fictif qui enflamme les réseaux sociaux ? (fake map)
Les nouvelles façons de « faire mentir les cartes » à l'ère numérique
La carte, objet éminemment politique
-
sur Du 23 au 25 septembre et du 5 au 6 novembre 2025 à Lille : formation "Données Foncières"
Publié: 8 January 2025, 10:30am CET
Publié le 08 janvier 2025Une session de formation sur les "Données Foncières" se tiendra du 23 au 25 septembre et du 5 au 6 novembre 2025 dans les locaux du Cerema Hauts-de-France à Lille.Cette session est à destination des bénéficiaires des fichiers données foncières (Fichiers Fonciers et DV3F) et des bureaux d'études.Vous trouverez le contenu et le coût de la formation dans la rubrique AccompagnementInscription jusqu'au 31 août (…)
Lire la suite
-
sur Labellisation Aqua-Valley du projet Récolt'Ô
Publié: 8 January 2025, 10:30am CET par Amandine Boivin
Le projet Récolt’Ô labellisé par le pôle Aqua-Valley : une reconnaissance pour l’innovation au service de la gestion de l’eau.
-
sur Du 24 au 26 juin 2025 à Lille : formation "savoir utiliser DV3F" - Cloned
Publié: 8 January 2025, 9:30am CET
Publié le 08 janvier 2025Une session de formation "Savoir utiliser DV3F" se tiendra du 24 au 26 juin 2025 dans les locaux du Cerema Hauts-de-France à Lille.Cette session est à destination des bénéficiaires des fichiers DV3F et des bureaux d'études.Vous trouverez le contenu et le coût de la formation dans la rubrique AccompagnementInscription jusqu'au 23 mai (…)
Lire la suite
-
sur 18-19 mars 2025 à Bordeaux: RDV autour de l’archéomatique en archéologie funéraire
Publié: 8 January 2025, 9:26am CET par archeomatic
4e séminaire-atelier : Production et analyse d’images en anthropologie et archéologie funéraire Programme et pré-inscriptions Bonjour à tous ! Voici venu le temps de l’annonce de la quatrième et dernière édition des Rendez-Vous autour de l’archéomatique en archéologie funéraire qui auront lieu à la MSH de Bordeaux. Cette collaboration fructueuse entre les Ateliers Archéomatiques et […]
-
sur Conférence de Michel Bruneau sur le Cambodge, Institut de Géographie (Paris), samedi 18 janvier 2025
Publié: 6 January 2025, 1:12pm CET par r.a.
Samedi 18 janvier 2025, de 10h à 12h, à l’Institut de Géographie, 191 rue Saint-Jacques, 75005 Paris, le géographe Michel Bruneau viendra animer une conférence sur le Cambodge.
Dans son ouvrage Parcours d’un géographe de transitions (L’Harmattan, 2023), Michel Bruneau revient sur le chemin qui l’a conduit de la géographie tropicale à la géographie critique. Après sa thèse sur la Thaïlande, il est devenu un éminent spécialiste de l’Asie du Sud-Est qui a proposé notamment un modèle d’organisation de l’espace du Cambodge.
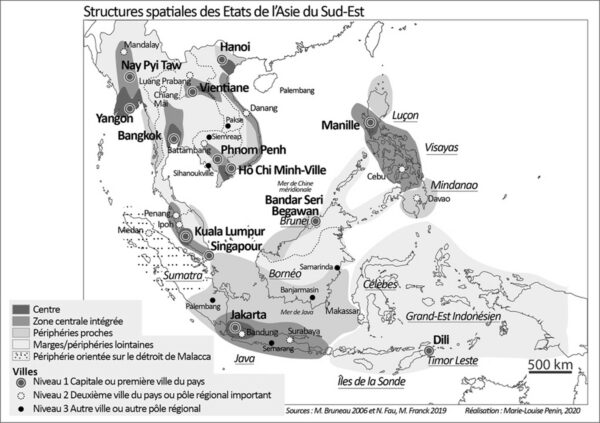
Source : Michel Bruneau, Carte reproduite dans BAGF ( [https:]] )
Au-delà d’une meilleure compréhension de l’organisation de l’espace cambodgien, il faudra se demander si la relation entre les structures territoriales de l’Etat-nation actuel et celles de la période précoloniale est toujours lisible.
A lire sur le site des Cafés Géo : Les Cafés Géo » Michel Bruneau, un « géographe de transitions »
-
sur Café géo d’Orléans, 15 janvier 2025 : « La révolution du millet en Inde du Sud. La souveraineté alimentaire au défi du changement climatique et de la santé » avec Bertrand Sajaloli
Publié: 5 January 2025, 12:42pm CET par Les Cafés Géo
-
sur Géohistoire des humains sur la Terre
Publié: 2 January 2025, 10:31pm CET par r.a.

Café de Flore, Paris, mardi 17 décembre 2024, C. Grataloup et D. Oster (de droite à gauche, photo de M. Huvet-Martinet)
Ce mardi soir, un public nombreux assiste au Café géo dont le sujet porte sur la « géohistoire des humains sur la Terre ». Pour aborder cette question un unique intervenant : Christian Grataloup, le géohistorien bien connu qui incarne largement la réflexion géohistorique depuis de nombreuses années. Auteur d’un livre d’une ambition rare (Géohistoire. Une autre histoire des humains sur la Terre, Les Arènes, 2023), C. Grataloup se propose durant cette soirée d’éclairer ce que l’histoire des sociétés doit à leur espace. Rien que cela !
DO : Ton livre Géohistoire paru l’année dernière marque l’aboutissement d’un long cheminement dans ta réflexion géohistorique. C’est peut-être pour cela que tu as choisi de le titrer sobrement Géohistoire, même si un sous-titre plus explicite l’accompagne : Une autre histoire des humains sur la Terre.
CG : En fait, le titre Géohistoire est un choix éditorial qui montre bien que l’expression créée par Fernand Braudel est tout à fait passée dans le domaine public.
DO : Les médias qui t’ont interviewé n’ont pas manqué de te demander une énième fois ta définition de la géohistoire. Tu réponds souvent qu’il s’agit d’éclairer ce que l’histoire des sociétés doit à leur espace. Dans ce livre tu évoques une synthèse de deux types de relations : les relations entre les sociétés et les relations avec le reste de la biosphère. Peux-tu préciser cet objectif ?
CG : La géohistoire assume sa bâtardise (histoire et géographie). Il faut articuler constamment les logiques d’organisation spatiale avec les processus de temporalité. Il faut tenir compte de tous ces éléments. Certains journalistes aiment dire que je suis le plus historien des géographes. Mais peut-être suis-je le plus géographe des historiens ?
Pour moi, par exemple, un des éléments clés du livre est la distance, c’est-à-dire l’éloignement ou la proximité entre les différentes sociétés, soit un élément géographique fondamental de l’évolution historique. Je parle d’un « singulier pluriel » pour une seule espèce humaine et des sociétés très différentes les unes des autres. L’histoire humaine est prise entre proximité et mobilité. Cette diversité des sociétés est un élément essentiel en même temps que le regroupement, les fusions, les diminutions, par exemple du nombre des langues D’où l’importance à mes yeux de la carte des langues au XVe siècle (17 000 à cette époque contre 6 000 aujourd’hui).
DO : Ton travail consiste à faire de la géohistoire à l’échelle mondiale comme le prouvent les titres de la plupart de tes livres. Mais il est bien sûr possible de faire de la géohistoire à une autre échelle, par exemple nationale ou locale.
CG : C’est vrai qu’aujourd’hui, en France, la géohistoire est rangée dans la catégorie de l’histoire globale. Je pense que la première est particulièrement bien adaptée à la seconde. Mais le problème de distance entre les différents acteurs sociaux est le même à toutes les échelles. Par exemple, c’est ce que j’ai essayé de faire avec l’Atlas historique de la France (Les Arènes-L’Histoire, 2019).
DO : On te questionne souvent sur ton utilisation de l’histoire contrefactuelle qu’on appelle aussi l’histoire des possibles. Peux-tu rappeler ce qu’est ce type d’histoire et pourquoi tu y as recours quelquefois ?
CG : L’uchronie raisonnée est une démarche expérimentale dans un processus temporel, elle aide à la réflexion et notamment permet de relativiser. Par exemple, si le monde avait été tissé par les Polynésiens, le monde aurait été totalement différent de ce qu’il est devenu à partir du XVIe siècle, lorsque les Européens ont influencé considérablement les interrelations entre les sociétés humaines.
DO : Abordons maintenant l’histoire des humains sur la Terre avec la préhistoire, plus précisément le paléolithique, avant donc la révolution néolithique. C’est le moment où l’animal humain sort de la savane arborée pour migrer vers des environnements très divers. Une carte très intéressante représente l’aire de diffusion des homo erectus, elle est titrée très pertinemment « sortir de son écosystème : le propre des humains ». Peux-tu expliquer ce titre ?
CG : Il y a actuellement des discussions à propos de la traduction du titre de l’ouvrage (5 traductions en cours). Les Néerlandais ont choisi de titrer le livre en utilisant l’expression De la savane à la ville. Ceci pour dire que ce qui me semble caractériser l’espèce humaine par rapport à tous les autres primates, c’est son ubiquité : il y a des humains partout. Ce processus a commencé il y a 2 millions d’années quand homo erectus est sorti d’Afrique ; les différentes espèces humaines ont su vivre dans des milieux qui n’étaient pas biologiquement le leur grâce à la maîtrise du feu, à la maîtrise du vêtement, à la construction de logements complexes, donc grâce à leur capacité à produire des micro-milieux. C’est vrai pour Sapiens depuis 300 000 ans.
Ce qui est à l’origine d’une part, de l’unité de l’espèce, et d’autre part, du fractionnement en de multiples sociétés (diversité des langues, des modes de vie, etc.)
DO : Sapiens vit donc dans tous les milieux. On peut parler de diffusion-dispersion avec pour corollaire le fractionnement en sociétés sans contact. A cet endroit du livre, tu cites la controverse de Valladolid et La Planète des singes de l’écrivain Pierre Boulle. Pourquoi cela ?
CG : Selon l’Eglise, ce qui prouvait l’humanité des populations autochtones rencontrées lors des « Grandes Découvertes » c’était l’interfécondité entre ces populations et les Européens. Quant au livre La planète des singes, il montre à sa manière comment le romancier Pierre Boulle s’est emparé de la question d’une commune espèce humaine.
DO : Evoquons maintenant l’avènement du Néolithique qui se caractérise par la domestication du vivant (végétaux et animaux) et la sédentarisation des populations. Au lieu du néolithique tu préfères parler des néolithiques, sans doute à cause de la dispersion des foyers de néolithisation dans le monde. Comment peut-on expliquer la simultanéité relative de cette dispersion ?
CG : Effectivement, les premières domestications sont apparues dans plusieurs foyers très dispersés sur la terre (Proche-Orient, Chine, Asie méridionale, Afrique occidentale, etc.) mais dans une fourchette de temps assez réduite. Pourquoi ces foyers indépendants de domestication ? Une première explication : l’absence de communications avérées. Une autre cause : la très forte coïncidence chronologique a empêché le déploiement d’un processus de diffusion. Il faut donc admettre le polygénisme des sociétés agricoles.
DO : Qu’en est-il des conséquences de la synchronie hétérogène au niveau des domestications (« le lama et la vache ») ?
CG : Les deux grands ensembles géographiques de plantes et d’animaux domestiqués (l’Eufrasie et l’Amérique) diffèrent par les potentialités préalables de domestication. Il semble bien s’agir d’une question d’offre. Le déséquilibre est flagrant dans le domaine animal. L’Amérique ne disposait d’aucun gros mammifère domesticable comme le cheval ou le dromadaire. Cela a eu des conséquences pour l’alimentation, le transport, le travail et même l’art militaire.
DO : Un chapitre passionnant traite des dernières diffusions spatiales, notamment en Amérique et en Océanie. La science archéologique progresse au point de donner aujourd’hui une profondeur historique à des espaces tels que les grandes plaines centrales d’Amérique du Nord et l’Amazonie. Prenons l’exemple de cette dernière qui illustre parfaitement ce qu’on appelle les « peuples sans histoire ». Que sait-on de nos jours de l’histoire de l’Amazonie ?
CG : Des régions entières n’ont entretenu que des liens rares et distendus avec l’axe de l’Ancien Monde. Certaines sociétés ont tout de même été partiellement reliées à cet axe comme celles du littoral de l’est africain. D’autres sociétés étaient entièrement coupées de cet axe comme les sociétés amérindiennes qui ont vécu indépendamment de l’histoire de l’Eufrasie et qui de ce fait ont eu une histoire de pandémies tout à fait particulière.
Grâce aux progrès de l’archéologie, deux grandes régions ont acquis une profondeur historique à peine perçue jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle : les grandes plaines centrales d’Amérique septentrionale et l’Amazonie.
DO : La carte « L’Axe de l’Eufrasie au début de notre ère » montre un monde connecté de la Chine à Rome en l’an 200. Depuis le Néolithique, une zone de forte densité humaine (au moins les deux tiers de l’humanité) s’est structurée des mers de Chine à la Méditerranée. Au IIe siècle, elle est organisée autour de grands empires. Ceux-ci font face, au nord, aux peuples des steppes, éleveurs et caravaniers. Plus au sud se trouvent des ensembles plus petits. C’est une « première mondialisation » avec les routes de la soie et celles des épices maritimes. Peux-tu développer ce que tu appelles « l’origine axiale du Monde ».
CG : Depuis plusieurs milliers d’années, entre Chine et Méditerranée, l’axe de l’Ancien Monde regroupe approximativement les trois quarts de l’humanité. Là, les sociétés sont nécessairement interconnectées puisque voisines ; quand une société a une innovation, celle-ci va se répandre chez les autres. Il y a d’ailleurs toutes sortes de passages : des mers littorales, des axes fluviaux, des steppes qui vont être peuplées par des peuples faisant le choix de l’élevage. Se sont donc développées des sociétés très différenciées : au sud, des sociétés « à racines » (des cultivateurs) ; au nord, des sociétés « à pattes » (des pasteurs).
DO : Abordons maintenant « la bifurcation du Monde » avec les « Grandes Découvertes » et l’Europe qui devient le centre du Monde. Pourquoi le succès de l’Europe (des hasards et des envies) ?
CG : La connexion avec les sociétés autres que celles de l’axe de l’Ancien Monde ne pouvait a priori être faite que par une société de l’Ancien Monde. Ensuite pourquoi les Européens ? La situation d’extrême occident de l’Europe pouvait inciter ses sociétés à l’aventure maritime. Madère et les Açores furent les premières îles à sucre des Européens qui n’eurent plus qu’à déplacer vers l’ouest au XVIe siècle le complexe socio-économique de la plantation.
DO : Et si le Sud avait créé le Nord ?
CG : Une petite uchronie radicale. Imaginons un rapport Nord-Sud inversé avec des sociétés tropicales qui auraient eu envie de produits tels que le lait ou la viande produits sur des terres avec hivers. Tout ceci pour dire que la péjoration du Sud n’est pas un phénomène naturel.
DO : Pour terminer, quels sont les principaux aspects géohistoriques du XXe siècle et du début du XXIe siècle ? Peut-on distinguer ceux qui se situent dans la continuité du siècle précédent et ceux qui sont en rupture avec lui ? Il me semble que le tableau de notre monde actuel met en jeu trois données fondamentales : une interdépendance accrue, les fractures profondes entre les sociétés, la gestion indispensable de la planète.
CG : Commençons par une mutation fondamentale : la croissance démographique avec un milliard d’habitants sur la Terre en 1800 et plus de 8 milliards aujourd’hui. Les humains sont devenus une espèce invasive qui détruit la mince pellicule de vie végétale et animale. Rien qu’à cause de cela, toutes les sociétés sont interconnectées. La question centrale c’est comment affronter ensemble, avec des sociétés si différentes, ce problème de gestion de notre unique bien commun qui est cette pellicule de vie. Aujourd’hui, on est à la fois dans une urgence d’agir en commun et de prendre en compte la diversité liée souvent à l’héritage colonial… La réflexion géohistorique traduit la nécessité de comprendre le fractionnement des sociétés et de pouvoir contribuer à essayer de le dépasser.
Un deuxième élément de réponse réside dans les rejeux d’héritages. Dans la diversité des sociétés on a des types de configurations sociales qui se sont construites en position les unes par rapport aux autres. Le planisphère politique est un puzzle, celui des Etats-nations. Parmi les plus grandes pièces du puzzle se trouvent en particulier les Etats héritiers des anciens empires de l’Axe (Chine et Russie). Parmi les plus petites pièces du puzzle, il y a de nombreux supports à des activités qui se jouent de l’international (paradis fiscaux, narcotrafic, etc.). Au total, on a un certain nombre d’éléments qui nous posent d’énormes problèmes pour pouvoir organiser ensemble la gestion de notre Planète.
Questions de la salle :
Q1 : Peut-on imaginer l’évolution du monde si Néandertal l’avait emporté ?
CG : Le Musée de l’homme a organisé récemment une exposition sur Néandertal. Celle-ci montre que Néandertal a changé de statut. Il y a 30 ans on le représentait comme une brute épaisse, contrairement à l’Homo Sapiens, qui lui apparaissant comme un civilisé (en devenir). Cela traduisait une vision du monde, celle qui opposait le sauvage à l’homme civilisé (c’est-à-dire l’Européen). Aujourd’hui, une parfaite inversion oppose Néandertal, le « gentil écolo », à Sapiens « qui recherchait le profit et avait tous les défauts ». En fait, on apprendra peut-être que Sapiens avait quelques avantages (sur les possibilités langagières ?) par rapport à Néandertal. Des processus historiques très différents n’auraient sans doute pas existé si Néandertal l’avait emporté.
Q2 : L’Europe affectée à la fin du Moyen Age par le « précapitalisme » a-t-elle bénéficié de ces conditions pour impulser à son profit la mondialisation amorcée par les « Grandes Découvertes » ?
CG : Là, vous posez la question des configurations sociales internes des sociétés. Ma réflexion géohistorique a fait le choix de s’intéresser avant tout aux logiques externes, c’est-à-dire essentiellement aux interrelations entre les sociétés (connexion, pas connexion, hiérarchie ou égalité dans les connexions, etc.). Ce qui se passe à l’intérieur des sociétés n’a pas été un élément important de ma réflexion mais mon livre donne les éléments de contextualisation qui peuvent permettre ensuite de s’intéresser aux structures internes (chinoises, indiennes, ottomanes, etc.) qui sont des éléments importants.
Q3 : Et si Napoléon n’avait pas vendu la Louisiane ?
CG : La Louisiane est très largement un mythe. Au XVIIIe siècle, la Louisiane française (la Nouvelle-France) forme un vaste espace entre le Saint-Laurent et le delta du Mississipi, peuplé (modestement) de colons, l’essentiel étant constitué de territoires où une poignés de Français et de « coureurs des bois » s’adonnent au commerce avec les nations amérindiennes. La configuration géopolitique principale dans le sud des Grandes Plaines était la Comancheria (l’empire comanche, qu’on peut qualifier d’« empire cavalier »), qui avait une réalité plus importante que la Nouvelle-France des chancelleries. Napoléon qui n’avait pas la maîtrise des mers a préféré vendre la Louisiane qu’il n’avait pas la possibilité de contrôler, ni de développer.
Compte rendu rédigé par Daniel Oster, décembre 2024
-
sur Géopolitique de l’Ouzbékistan dans une Asie centrale très convoitée
Publié: 28 December 2024, 11:58am CET par r.a.
C’est au retour d’un voyage en Ouzbékistan que Maryse Verfaillie retrace le rôle qu’a eu ce pays au cœur de l’Asie pendant plus de deux millénaires d’histoire.
-
sur LMFP : LE catalogue magique !
Publié: 24 December 2024, 2:00pm CET
 Une extension QGIS peut-être (trop) méconnue : Layers Menu From Project permet de simplifier la vie des administrateurs ET des utilisateurs, retour d'expérience à deux voix.
Une extension QGIS peut-être (trop) méconnue : Layers Menu From Project permet de simplifier la vie des administrateurs ET des utilisateurs, retour d'expérience à deux voix.
-
sur 2024 chez Geomatys
Publié: 23 December 2024, 11:23am CET par Jordan Serviere
 2024 chez Geomatys
2024 chez Geomatys
- 23/12/2024
- Jordan Serviere
Alors que 2024 s’achève, Geomatys se distingue une fois de plus comme un acteur clé dans le domaine de l’information géospatiale, des systèmes d’information environnementale et de la défense. Cette année a été marquée par des avancées technologiques concrètes, des reconnaissances importantes et des collaborations stratégiques qui ont renforcé notre position dans des secteurs en constante évolution. Retour sur ces douze mois faits de projets ambitieux et de réalisations collectives.
Examind C2 : réinvention de la gestion tactiqueLe lancement d’Examind C2 représente une étape cruciale en 2024, tant pour Geomatys que pour les secteurs de la défense, de la cybersécurité et de la gestion de crise. Cette plateforme de Commande et Contrôle (C2), conçue pour répondre aux besoins complexes des environnements multi-milieux et multi-champs, se distingue par son interopérabilité avancée et son traitement en quasi-temps réel. Les visualisations dynamiques qu’elle propose offrent une supériorité informationnelle essentielle pour optimiser les prises de décision dans des situations critiques. Avec des capacités étendues en traitement de données spatiales, Examind C2 anticipe également les attentes futures des utilisateurs. Pour une analyse approfondie de ses capacités et de ses cas d’utilisation, rendez-vous sur le site officiel.
AQUALIT : vers une gestion durable de l’eau potableEn 2024, Geomatys a franchi une nouvelle étape avec la commercialisation d’AQUALIT, une plateforme novatrice destinée à l’analyse des mesures d’eau. Conçue spécifiquement pour les producteurs d’eau potable, AQUALIT leur fournit des outils puissants pour surveiller, analyser et optimiser la qualité de leurs ressources. Cette solution intègre des fonctionnalités avancées en gestion des données hydrologiques, en analyse prédictive et en visualisation cartographique. Dans un contexte où la gestion durable de l’eau est devenue un enjeu prioritaire, AQUALIT illustre parfaitement l’engagement de Geomatys en faveur de l’environnement et de l’innovation. Pour en savoir plus et découvrir toutes ses fonctionnalités, consultez le site d’AQUALIT.
OPAT devient ShoreInt : une évolution pour mieux répondre aux besoins côtiersEn 2024, notre projet OPAT a connu une évolution majeure en devenant ShoreInt. Cette transition reflète notre désir d’offrir une solution toujours plus adaptée aux enjeux complexes de la gestion des zones côtières. ShoreInt intègre des données issues de technologies comme l’AIS, les images satellites et la modélisation spatiale pour fournir une analyse précise des activités maritimes et des dynamiques environnementales. Avec une interface ergonomique et des outils avancés de visualisation, ShoreInt est conçu pour aider les décisionnaires à gérer les interactions complexes entre les activités humaines et les écosystèmes côtiers. Pour en savoir plus sur cette solution innovante, consultez le site de ShoreInt.
Lauréat du Concours d’innovation avec EpiWiseUn des temps forts de 2024 est sans conteste la distinction obtenue par Geomatys pour son projet EpiWise lors des Concours d’innovation de l’État. Soutenu par France 2030, ce projet épidémiologique figure parmi les 177 initiatives lauréates reconnues pour leur potentiel à transformer durablement leur secteur. Cette récompense reflète notre capacité à innover tout en répondant à des besoins sociétaux majeurs, tels que la prévention des pandémies et la modélisation épidémiologique. En s’appuyant sur des technologies de machine learning et de traitement des big data, EpiWise offre des perspectives nouvelles pour la santé publique.
Collaboration et continuité : une stratégie collectiveAu-delà de ces projets phares, Geomatys a maintenu en 2024 un rythme soutenu de collaboration dans des initiatives d’envergure. Parmi elles, FairEase, le portail Géosud et nos partenariats stratégiques avec Mercator Ocean et l’Office Français de la Biodiversité. Ces travaux, axés sur la valorisation des données spatiales, l’interopérabilité et la gestion des ressources naturelles, témoignent de notre engagement à développer des solutions ouvertes, accessibles et adaptées aux enjeux environnementaux contemporains. Ces projets, loin de s’arrêter en 2024, constituent un socle solide pour notre développement en 2025 et au-delà.
Et en 2025...Alors que nous nous tournons vers 2025, Geomatys se prépare à renforcer son impact et à ouvrir de nouvelles perspectives. En poursuivant nos investissements dans la recherche et le développement, notamment en télédétection, modélisation environnementale et gestion des données massives, nous ambitionnons de créer des solutions toujours plus performantes et adaptées aux besoins d’un monde en mutation rapide. L’année à venir sera marquée par le renforcement de nos relations avec nos partenaires stratégiques, dans une perspective de collaboration continue et durable. Nous adressons nos sincères remerciements à nos collaborateurs, dont l’engagement et les compétences sont le moteur de nos réussites, ainsi qu’à nos clients et partenaires pour leur soutien indéfectible. Ensemble, faisons de 2025 une année riche en projets et accomplissements. Toute l’équipe vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. Rendez-vous en 2025 !
Menu Linkedin
Twitter
Youtube
Linkedin
Twitter
Youtube

The post 2024 chez Geomatys first appeared on Geomatys.
-
sur Appel à participants - GT Dessertes pour les transports de bois
Publié: 20 December 2024, 11:50am CET
Appel à participants - GT Dessertes pour les transports de bois
-
sur « TERRES ». Dossier spécial FIG 2024 de la revue La Géographie (n°1594, automne 2024)
Publié: 19 December 2024, 7:01pm CET par r.a.
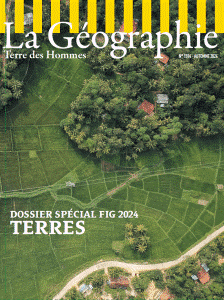
Ce dossier s’intéresse aux « Terres », thème du Festival international de géographie de Saint-Dié en octobre 2024.
Parmi les articles, nous retrouvons ceux d’amis des Cafés géographiques comme Amaury Lorin et Gilles Fumey. Le premier nous avait fait le plaisir de traiter au Café de Flore le sujet évoqué ici, La Birmanie : pivot stratégique entre l’Inde et la Chine, en février dernier ( [https:]] ). Le second alerte sur le vol des terres à leurs premiers habitants dans Terres convoitées, terres accaparées. Le phénomène remonte à l’Antiquité mais prend au XXIe siècle la forme d’un accaparement dû à quelques Etats mais surtout aux firmes de pays riches dans un but financier. En France, seuls quelques vignobles de prestige sont aux mains de sociétés étrangères mais la financiarisation du foncier est défavorable à l’installation des jeunes agriculteurs. Grands acheteurs de terres dans les pays en développement, surtout en Afrique subsaharienne, la Chine et les pays du Golfe invoquent leur souci d’assurer la sécurité alimentaire à leurs populations. En fait beaucoup d’investissements fonciers servent à produire des agrocarburants. Seules des ONG cherchent à lutter contre ces spoliations, parfois avec succès.
François-Michel Le Tourneau explique quels enjeux fonciers se cachent derrière la déforestation de l’Amazonie. Il rappelle d’abord que si la baisse de la déforestation en Amazonie a été notable en 2023 (elle a dépassé 30% par rapport à 2022), ce qui a donné une image positive au gouvernement de Lula, la hausse a été très importante dans les savanes du Centre (« cerrado »). Il s’est donc agi d’un choix essentiellement politique. L’objectif d’une déforestation zéro semble impossible à atteindre car la déforestation peut être légale. Une partie du patrimoine public forestier est devenu privé au profit de ceux qui occupaient ces terres depuis plus de 10 ans. En ont profité les petits propriétaires puis les grands. La délivrance des titres de propriété est néanmoins conditionnée à la mise en valeur des terres, ce qui favorise la déforestation, souvent au profit de l’élevage bovin.
C’est à l’échelle mondiale que Paul Arnould pose la question du statut foncier de la forêt. Ce n’est pas une question marginale car la forêt occupe le tiers des terres émergées. Sur le plan juridique, le bilan est simple : 76% de la terre forestière appartiennent à un Etat, 20% à des propriétaires privés (en général, de grands groupes multinationaux, à l’exception de la France où la propriété est très émiettée), 4% n’ont pas de propriétaires identifiés. Mais en dehors du droit, les situations sur le terrain sont plus complexes. Des droits d’usage anciens sont fortement revendiqués par leurs bénéficiaires, sans être reconnus par la loi. Pour beaucoup de randonneurs contemporains, il va de soi que la forêt est un bien public où tout est permis (cueillette des champignons et des baies etc…). Trois impératifs s’opposent : rationalité économique, situation écologique, réalités sociales. Les situations des terres forestières sont donc très diverses selon les lieux.
Forêts et autres lieux ont été nommés par les hommes qui inscrivent ainsi leur pouvoir dans les paysages. Camille Escudé s’est particulièrement intéressée au « renaming » (pour « changement de nom ») des territoires autochtones. Une des formes du pouvoir colonial a consisté à supprimer les noms donnés par les autochtones aux lieux pour les rebaptiser. Ainsi Chuquiago Marka (« vallée de l’or ») en Amérique du sud est devenue Nuestra Senora de la Paz après la conquête espagnole de 1548. Supprimer aujourd’hui ces noms donnés par le colonisateur fait partie des pratiques de décolonisation et de résistance au pouvoir dominant. Le territoire autonome du Nunavut au Canada, administré par les Inuit, en donne de nombreux exemples. Frobisher Bay (nom d’un explorateur britannique) s’appelle aujourd’hui Iqaluit (« les poissons » en inuktitut).
C’est donc la diversité des approches qui fait tout l’intérêt de cette revue consacrée à un sujet fondamentalement géographique : les terres.
Michèle Vignaux, décembre 2024
-
sur [Equipe Oslandia] Sophie Aubier, développeuse SIG
Publié: 19 December 2024, 7:25am CET par Caroline Chanlon
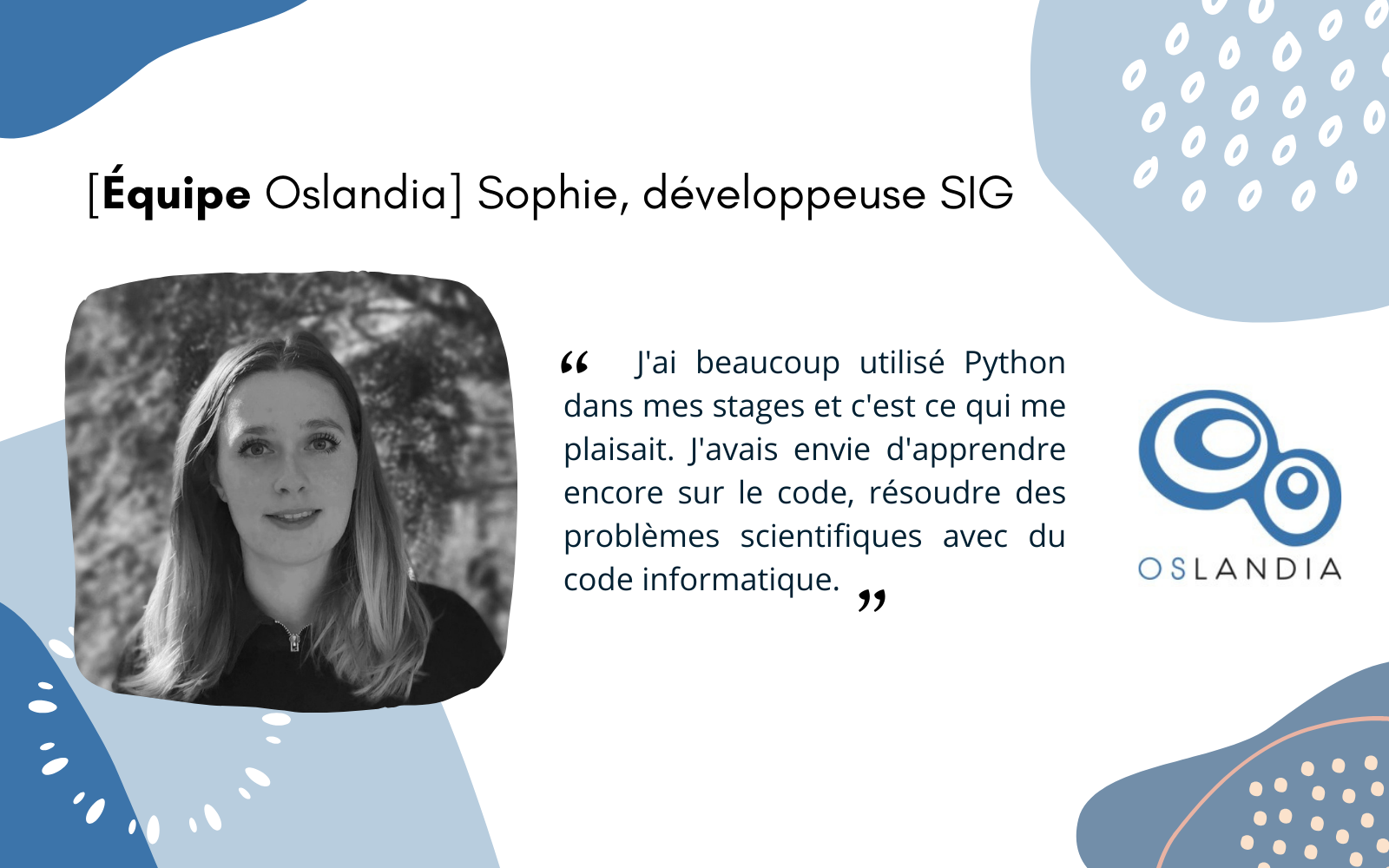
Après le BAC, le rêve de Sophie, c’est de tailler des pierres précieuses. Elle effectue un stage chez un artisan parisien où elle se rend vite compte que c’est un travail précaire qui est soumis à des règles qui ne lui conviennent pas.
Elle décide d’en apprendre plus sur la formation des roches et s’oriente vers une Licence de Géosciences à Paris Sorbonne puis un master de Physique de l’Océan, de l’Atmosphère et du Climat qu’elle complète avec un Master d’Hydrogéologie à Paris Saclay pour « plus de pratique et moins de théorie ».« Je me suis intéressée à la géologie pour finalement plus me passionner pour le calcaire que pour les pierres précieuses ! »
Pendant ses études, Sophie réalise plusieurs stages pendant lesquels elle mobilise les grands modèles utilisés par le GIEC pour les prédictions afin de réaliser des modélisations du climat.
« J’ai beaucoup utilisé Python dans mes stages et c’est ce qui me plaisait. J’avais envie d’apprendre encore sur le code, résoudre des problèmes scientifiques avec du code informatique. »
Sophie postule à une offre d’emploi chez Oslandia à un poste de développeur SIG junior. Elle est embauchée en janvier 2022 pour notamment développer des plugins QGIS en Python.
Projets emblématiques- Développement du plugin Cityforge : intégration de bâtiments 3D dans QGIS. Un plugin réalisé dans le cadre de la R&D Oslandia.
- Développement du plugin ELAN pour INRAE : un plugin d’outils de gestion des eaux urbaines.
« C’est un outil d’aide à la décision pour le traitement des eaux usées, le déversement des eaux de pluie et des eaux usées «
Python
PhilosophieApprendre !
Oslandia en 1 motAutonomie
-
sur Suivre le Vendée Globe 2024 depuis un SIG - Partie 2
Publié: 18 December 2024, 2:00pm CET
 Après avoir récupéré, nettoyé et visualisé les données SIG du Vendée Globe 2024 dans QGIS, voyons comment automatiser tout cela et développer une application application Web de suivi avec MapLibre.
Après avoir récupéré, nettoyé et visualisé les données SIG du Vendée Globe 2024 dans QGIS, voyons comment automatiser tout cela et développer une application application Web de suivi avec MapLibre.
-
sur Regard d'Altitude : recenser les effets du changement climatique sur les milieux alpins
Publié: 18 December 2024, 9:30am CET par Bastien Potiron
Le projet Regard d’Altitude vise à structurer et centraliser de manière collaborative les observations des phénomènes naturels se produisant en montagne.
-
sur Petite histoire du logo Oslandia
Publié: 18 December 2024, 7:18am CET par Caroline Chanlon

Fin 2009, Oslandia est sur le point d’être créée… et a besoin d’une identité visuelle. Vincent contacte son ancien collègue Sylvain pour travailler sur un logo.
Le cahier des charges est lancé !Le logo doit être identifiable immédiatement, le plus simple possible (“ça va ensemble” dixit Sylvain), déclinable au trait (N&B), niveau de gris, quadrichromie, 256 couleurs et couleurs pleines. Il faut aussi qu’il soit symbole de dynamisme, avec une symbolique rattachée au métier, et ne ressemblant à rien de connu !
La première série d’idées ne se fait pas attendre, voilà quelques logos proposés :
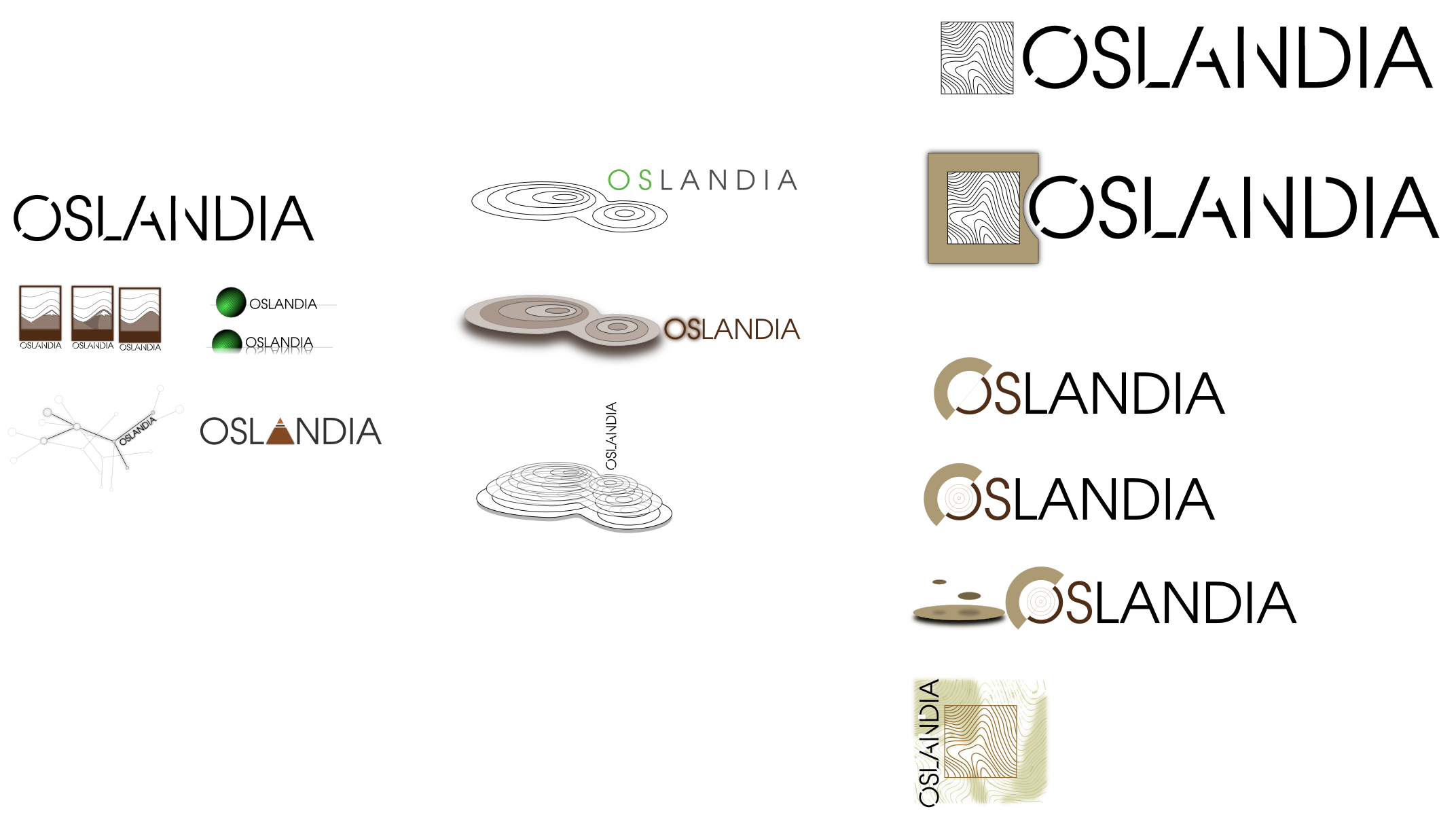
Les partages d’idées se font via des emails et sont centralisés sur un wiki. Les premiers échanges débutent ! Et une série de modifications qui donne lieu à une nouvelle itération.
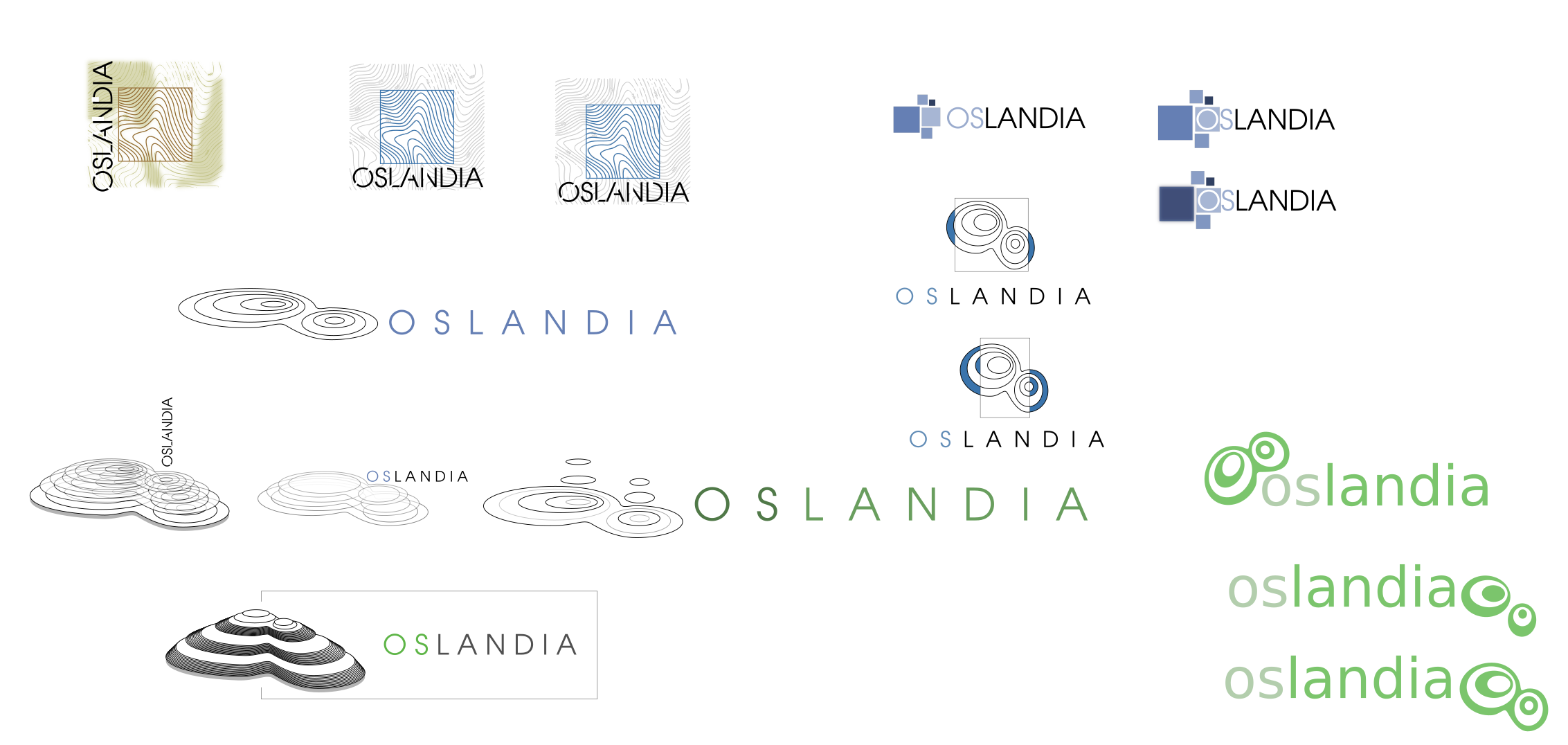
On avance !
Pour s’approcher d’une version finale
Qui ne tarde pas à arriver !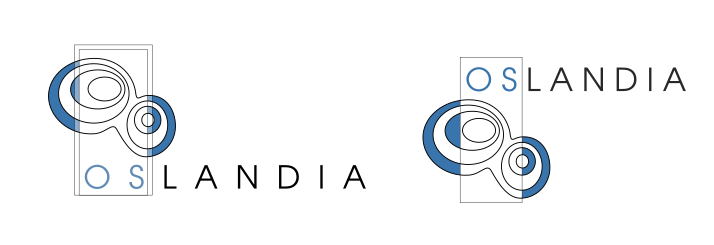
Retour d’expérience de Sylvain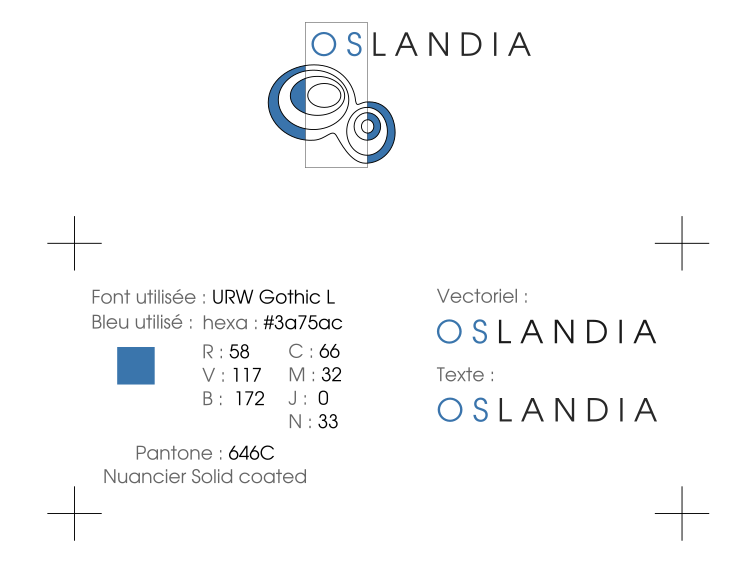
« J’ai exclusivement travaillé avec Inkscape, toujours en vectoriel et uniquement à la souris. Sur ce type d’exercice, je n’ai pas besoin de crayon pour élaborer des ébauches, je pars souvent d’une forme géométrique simple ou d’un texte. Je me suis basé sur mon intuition pour les premières séries et les itérations m’ont permis d’avancer pas à pas. «
Au final, le logo Oslandia représente une sorte d’intersection spatiale entre des courbes de niveau ( une île ? ) et un rectangle, qui fait le lien avec le nom de l’entreprise.
Certains y voient cependant plutôt des attracteurs étranges, ce qui in fine pourrait aussi nous caractériser !
Le logo s’est construit à l’image d’Oslandia : de manière collaborative, démocratique, par itération et tout cela dans un soucis d’excellence et de travail bien fait

Depuis, le logo a évolué pour aboutir à la version actuelle. Cette nouvelle version, largement inspirée de la précédente, est simplifiée et modernisée. Elle est toujours facile à intégrer sur des pages web, des affiches ou des documents, et elle corrige le bug de la version précédente : un affichage possible au format carré !

-
sur Qu’est-devenue la Yougoslavie ? Avec Jean-Arnault Dérens et Laurent Geslin
Publié: 17 December 2024, 8:28pm CET par r.a.

De gauche à droite, Jean-Arnault Dérens, Laurent Geslin et Daniel Oster, mardi 26 novembre 2024, au Café de la Mairie (Paris 3ème) (Photo Denis Wolff)
La salle du premier étage du Café de la Mairie (Paris 3ème) était comble mardi soir 26 novembre pour écouter deux éminents spécialistes des Balkans, Jean-Arnault Dérens (JAD) et Laurent Geslin (LG). Les intervenants, tous deux journalistes, notamment au Courrier des Balkans et pour de nombreux organes de presse (Le Monde diplomatique, Mediapart, etc.), auteurs de plusieurs livres sur la région des Balkans, étaient présents pour faire le point sur la situation de l’espace ex-yougoslave, trente ans après la dislocation de la Yougoslavie socialiste de Tito.
J-A.D. : D’où vient l’idée yougoslave, c’est-à-dire l’idée de réunir tous les Slaves du Sud dans un même Etat ?
Cette idée apparaît au XIXème siècle, dans les années 1860, portée par des intellectuels croates, vivant donc dans l’Empire des Habsbourg. Elle est contemporaine du mouvement des nationalités qui se développe alors en Europe, notamment dans les Etats italiens et germaniques. Dès 1850, une base grammaticale commune a été fixée par une convention pour le serbo-croate, langue commune de ces populations slaves du Sud. Malgré leurs différences historiques et confessionnelles, ces populations formaient donc un ensemble ayant toute légitimité à se regrouper au même titre que les populations italiennes ou allemandes par exemple. Les guerres balkaniques de 1912-1913 et la Grande guerre de 1914-1918 favorisent la formation en 1918 d’un Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes qui prend le nom de royaume de Yougoslavie en 1929. Cet Etat est en réalité une construction politique grand-serbe qui nie tous les rêves d’unification de ces peuples slaves du Sud.La Seconde Guerre mondiale provoque la naissance d’une « seconde Yougoslavie », fédérative et socialiste, proclamée le 29 novembre 1943, qui va durer 45 ans avec une représentation assez équilibrée de toutes les nationalités (6 républiques, 2 républiques autonomes, soit le modèle de l’organisation étatique de l’URSS). Cette Yougoslavie « titiste » (Tito la dirige de 1943 à 1980, date de sa mort) s’effondre pour des raisons externes et internes. Sur le plan extérieur, elle perd son importance géopolitique de « pont » entre les deux parties du monde bipolaire de la guerre froide, elle est en quelque sorte la principale victime collatérale de la chute du mur de Berlin. Sur le plan intérieur, elle a évolué vers une sorte de confédéralisme marqué par des tensions accrues entre les républiques, principalement de nature économique. Les républiques les plus riches (la Slovénie grâce à son industrie, la Croatie grâce au tourisme) ne supportent plus de verser beaucoup d’argent en direction des républiques les plus pauvres (phénomène comparable entre le Nord et le Sud en Italie).
L’éclatement tragique de la Yougoslavie dans les années 1990 se fait dans la guerre. Aujourd’hui, le souvenir de la Yougoslavie reste bien présent dans les pays qui en sont issus. Face aux crises à répétition que traverse l’espace post-yougoslave, nombreux sont ceux qui regrettent « ce passé où l’on vivait mieux ». C’est la « yougonostalgie ».
A l’issue des guerres yougoslaves, les nouveaux Etats créés à partir des anciennes républiques étaient tous supposés rejoindre l’Union européenne. Ce qui est le cas pour la Slovénie en 2004 et finalement pour la Croatie en 2023. Mais constatons qu’il n’en est rien pour tous les autres Etats qui sont toujours candidats pour entrer dans l’UE (et même « candidat potentiel » pour le Kosovo). L’absence de frontières cadastrées en Serbie, en Bosnie-Herzégovine et au Monténégro facilite dans les années dans les années 2010 d’ailleurs les contentieux interétatiques même si l’émergence d’une « yougosphère » émerge dans les années 2010 avec les incertitudes de l’intégration européenne et la prise en compte de similitudes, notamment culturelles, dans tout l’espace autrefois yougoslave.
L.G. : Où en est-on aujourd’hui ?
Depuis 20 ans, l’espace post-yougoslave fait l’objet d’un double discours : d’un côté, l’UE et les dirigeants régionaux rappellent l’objectif d’entrée dans l’UE ; d’un autre côté, l’UE comme les dirigeants des Balkans occidentaux se satisfont de la situation politique actuelle. Plusieurs raisons à cela. Pour l’UE les Balkans occidentaux représentent, surtout depuis 2010, un sas sur la route migratoire qui aboutit à l’Europe occidentale. Ce sas permet de freiner et de contrôler les flux migratoires, des camps de rétention sont installés, des subsides sont versés aux pays de transit. Les Balkans forment ainsi une barrière et jouent un rôle d’amortisseur à la migration.Il y a également des raisons d’ordre démographique au maintien du statu quo politique entre l’UE et les Balkans occidentaux. Malgré les difficultés actuelles, ceux-ci ont des populations bien formées grâce à des systèmes éducatifs qui restent de bonne qualité. Les pays d’Europe occidentale, en particulier l’Allemagne, considèrent le Sud-Est de l’Europe comme un réservoir de main d’œuvre, très qualifiée (médecins…) et peu qualifiée (boulangers, plombiers…). Ces départs d’actifs aggravent la situation démographique marquée par un déficit des naissances accentué, déficit qui existe d’ailleurs dans une grande partie du continent européen.
Un autre fait constitue un grand problème pour les populations des Etats ex-yougoslaves, celui des lacunes récurrentes de l’état de droit. Ce phénomène est largement ignoré par les dirigeants de l’UE. Les manipulations électorales, la corruption, sont monnaie courante dans les Balkans occidentaux. On comprend que certains dirigeants des Etats de la région ne souhaitent pas forcément l’adhésion à l’UE qui signifierait le strict respect des règles de l’état de droit.
Tout ceci sans compter deux points de blocage qui empêchent l’intégration européenne d’avancer : en Bosnie-Herzégovine (entre Croates et Bosniaques) et au Kosovo (non reconnu par 5 Etas de l’UE). Ajoutons la guerre en Ukraine depuis 2022 qui a rebattu les cartes géopolitiques avec, par exemple, la décision de la Serbie de ne pas soutenir les sanctions de l’UE prises contre la Russie. Une majorité des Etats de l’UE vient de décider que l’élargissement européen n’était pas encore opportun.
J-A.D. : Quel est le rôle des puissances comme la Chine, la Turquie et le Moyen-Orient dans l’espace autrefois yougoslave ?
Au début du XXème siècle, la situation dans les Balkans montrait les rapports complexes entre les petits Etats balkaniques et les grandes puissances de l’époque, soucieux de jouer des rapports de force afin de renforcer leurs intérêts respectifs. Aujourd’hui, il en va de même avec les petits Etats anciennement yougoslaves qui exploitent la concurrence, notamment entre les Occidentaux et les Chinois ou les Turcs. Dans le même temps, les grandes puissances investissent dans la région pour pousser leurs pions économiques et/ou géopolitiques.Alors que l’UE apparaît comme le principal acteur extérieur depuis la crise de 2008, de nouveaux acteurs jouent un rôle important dans cette partie de l’Europe : avant tout la Turquie, la Russie, la Chine, les pays du Golfe arabo-persique. Au point que des questions se posent aujourd’hui avec plus ou moins de pertinence : la Turquie est-elle de retour dans les Balkans ? La Serbie est-elle le cheval de Troie dans la région ? La Chine est-elle en train d’acheter les Balkans ? Pourquoi les pays du Golfe investissent-ils dans cet espace européen ?
Depuis l’arrivée au pouvoir d’Erdogan et de l’AKP, les investissements turcs se sont généralisés dans les pays post-ottomans mais différents facteurs internes et externes ont modifié les priorités d’Ankara, mobilisée sur d’autres fronts. Et aujourd’hui la Turquie mise davantage sur la Serbie que sur la Bosnie-Herzégovine ou l’Albanie.
Les intérêts économiques de la Russie sont relativement modestes dans les Balkans, mais la région occupe une place symbolique importante dans les préoccupations du Kremlin. Si la Serbie n’a pas adopté les sanctions européennes contre la Russie après l’invasion de l’Ukraine, elle s’oppose en revanche à l’effondrement de l’intégrité territoriale de tout Etat membre de l’ONU (sans doute en pensant au cas du Kosovo).
Ce n’est que depuis la fin des années 2000 que les Balkans sont devenus une cible importante de la projection de la Chine à l’étranger (lancement en 2013 de la « Nouvelle route de la soie » entre Pékin et l’Union européenne). Plusieurs chantiers chinois ont été réalisés en Serbie et au Monténégro, particulièrement dans les infrastructures de transports, les minerais et l’éolien.
Quant aux pays du Golfe (Arabie saoudite et Emirats arabes unis, leurs investissements privilégient le tourisme, l’immobilier et l’armement, notamment en Serbie.
L.G. : Qu’en est-il de l’évolution de certaines régions comme la Dalmatie croate ou d’espaces particuliers comme les îles ?
La Dalmatie a connu un important essor du tourisme dès les années 1970-1980. Elle profite largement de la reprise touristique depuis la fin de la guerre civile à la fin des années 1990 au moment même où la transition économique post-communiste provoque la désindustrialisation de la côte adriatique (disparition des chantiers navals, etc.). Les méfaits du surtourisme sont aggravés par le manque de main d’œuvre régionale (Indonésiens, Philippins et d’autres nationalités sont employés pendant la saison touristique). Avec Airbnb c’est une société à deux vitesses qui se développe en bénéficiant aux propriétaires de maisons et d’appartements pouvant être loués tandis que le reste des populations locales subit surtout les prix élevés à Split, Zadar, etc. Les îles de la mer Adriatique sont particulièrement affectées par les difficultés et la déprise démographique.QUESTIONS DE LA SALLE :
Q1 : Pourquoi les Etats anciennement yougoslaves ne connaissent-ils pas des mobilisations populaires comme celles qui ont existé (Ukraine) ou qui existent (Géorgie) ?
Les mobilisations populaires existent dans les Balkans occidentaux, notamment en Serbie et au Monténégro, mais elles ne brandissent plus les drapeaux européens contrairement à ce qu’elles faisaient il y a 15 ans. Les raisons de ces manifestations peuvent être d’ordre écologique (par exemple, contre l’ouverture de mines de lithium en Serbie), ou dénoncer la corruption (par exemple, à la suite de l’accident mortel lié à un effondrement en gare de Novi Sad en novembre 2024). Sur tous ces problèmes les ambassades européennes se taisent, laissant les gouvernements locaux réagir …ou ne pas agir. De plus, le départ massif des actifs vers l’Europe occidentale entame la capacité de réaction de la société civile.Q2 : Comment décrire la situation actuelle au Kosovo ?
Les relations entre la Serbie et le Kosovo sont à la fois intimes, complexes et mauvaises. Pour les Serbes le Kosovo représente le centre historique et religieux de la Serbie au Moyen Age. Mais les albanophones, musulmans pour la plupart, forment aujourd’hui plus de 90% de la population. Pour comprendre cette évolution, il faut remonter à la « grande migration » de 1689. Une grande part de la population chrétienne, notamment serbe, quitte le Kosovo en suivant les armées autrichiennes par crainte de la répression ottomane. Depuis, la balance démographique n’a cessé de peser en faveur des Albanais et au détriment des Serbes. L’exode des Serbes (mais aussi des Roms, voire des Bosniaques) après la guerre de 1998-1999 a renforcé un processus engagé de longue date.Le dialogue entre le Kosovo et la Serbie a-t-il une chance d’aboutir alors que l’indépendance proclamée par le Kosovo en 2008 est toujours contestée par la Serbie. L’UE a pris en 2011 l’initiative d’initier un dialogue « technique » sur les problèmes concrets des citoyens concernés. Constatons que l’existence des Serbes au Kosovo est plus compliquée de jour en jour, ceux-ci d’ailleurs étant utilisés comme des pions par Belgrade.
Q3 : Quel rôle ont joué et jouent encore les différentes religions dans l’espace autrefois yougoslave ?
Rappelons que les guerres de Yougoslavie n’ont pas été des guerres de religion. D’ailleurs la Yougoslavie socialiste a été touchée par une vague profonde de sécularisation. Pendant la guerre civile, les religions orthodoxe, catholique et musulmane ont été utilisées, manipulées par les pouvoirs politiques, comme marqueur identitaire (durant le conflit en Croatie) et surtout comme facteur de légitimation politique. De leur côté, les hiérarchies religieuses ont commis l’erreur de ne pas se distancier assez clairement de cette récupération politique. Encore aujourd’hui, la clé du problème réside moins dans les Eglises que dans la manière dont les pouvoirs utilisent ces Eglises et les communautés confessionnelles. Ajoutons, pour le cas de l’islam, la lutte d’influence entre la Turquie et les pays du Golfe pour le contrôle des communautés islamiques.Q4 : Les Cafés géographiques organisent en mai 2025 un voyage à Trieste et en Istrie (Slovénie et Croatie). Que retenir de ce petit morceau de l’ancienne Yougoslavie, aujourd’hui faisant partie de l’Union européenne ?
Trieste, l’Istrie et la Dalmatie, c’est-à-dire la plus grande partie du rivage oriental de la mer Adriatique, forment une ligne de fracture majeure de l’espace européen. « Rideau de fer », « frontières de sang », frontières fantômes », sont quelques expressions qui ont été utilisées à propos de Trieste et de ce petit morceau de Yougoslavie appartenant aujourd’hui à l’Union européenne. Et les deux intervenants d’évoquer un voyage maritime qu’ils ont fait des Balkans au Caucase à partir de Trieste, voyage qui a donné lieu à la publication d’un beau récit en 2018.ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES :
Jean-Arnault Dérens et Laurent Geslin, Les Balkans. Carrefour sous influences, Tallandier, 2023
Sous la direction de Jean-Arnault Dérens et Benoît Goffin, Balkans, collection Odyssées, ENS Editions, 2024
Jean-Arnault Dérens et Laurent Geslin, Là où se mêlent les eaux, La Découverte, 2018
Jean-Arnault Dérens, Adriatique. La mer sérénissime, collection L’âme des peuples, Editions Nevicata, 2024Compte rendu rédigé par Daniel Oster, décembre 2024
-
sur ICHC LYON 2024- Compte rendu d’une conférence réussie
Publié: 17 December 2024, 5:23pm CET par Emmanuelle Vagnon
30e Conférence internationale sur l’histoire de la cartographie [ICHC], 1er au 5 juillet 2024- « Confluences – Interdisciplinarité et nouveaux défis dans l’histoire de la cartographie »
30th International Conference on the History of Cartography, 01-05 juillet 2024 – “Confluences – Interdisciplinarity and new Challenges in the History of Cartography”/
ICHC LYON 2024- Un projet collectifLa Conférence internationale sur l’histoire de la cartographie [ICHC] est le seul congrès consacré exclusivement à l’histoire des cartes et de la cartographie dans le monde. Depuis 1964, elle promeut une collaboration libre et sans entraves entre les cartographes de toutes les disciplines, les conservateurs, les collectionneurs, les marchands et les institutions. L’événement est fait de conférences illustrées, de posters, d’expositions et d’un programme social. Afin de mieux faire connaître les enjeux et les ressources, chaque conférence est parrainée par des institutions éducatives et culturelles de premier plan. Les conférences ont lieu tous les deux ans et sont administrées par des organisateurs locaux en collaboration avec Imago Mundi Ltd ( [https:]] ). La première participation française eut lieu en 1987 à Paris. La candidature de Lyon a été proposée et retenue pour 2024, après Amsterdam en 2019 et Bucarest en 2022.
Le comité d’organisation a été piloté par le professeur Bernard Gauthiez et sa collègue Enali De Biaggi, à l’Université Jean Moulin Lyon 3/UMR 5600 EVS (ichc2024@univ-lyon3.fr) et a compté avec la participation de nombreux collègues d’EVS.
Comité d’organisation
Enali De Biaggi (Université Jean Moulin – UMR 5600 EVS)
Bernard Gauthiez (Université Jean Moulin – UMR 5600 EVS)
Catherine Hofmann (BnF Département des cartes et plans)
Emmanuelle Vagnon – Chureau (Université de Paris I CNRS –
UMR 8589 – LAMOP)
Quentin Morcrette (CY Cergy Paris Université)
Claire Cunty (Université Lumière – UMR 5600 EVS)
Axelle Chassagnette (Université Lumière – LARHRA)
Damien Petermann (Université Jean Moulin – UMR 5600
EVS)
Marc Bourgeois (Université Jean Moulin – UMR 5600 EVS)
Virginie Chasles (Université Jean Monnet – UMR 5600 EVS)
Hélène Mathian (École Normale Supérieure CNRS – UMR
5600 EVS)Comité scientifique : Wouter Bracke, Tony Campbell,
Axelle Chassagnette, Imre Demhardt, Bernard Gauthiez, Nick
Millea, Emmanuelle Vagnon-Chureau
Secrétariat et comptabilité : Carla Wehbé
Communication : Emmanuelle Bruyas, Jean-Loup Miquel
Networking : Marine Préault
IT support : Jérémie Fernandes ; English editorial support : Francis HerbertUn grand merci aux étudiants et volontaires qui ont accompagné les invités !
La réalisation de la conférence à Lyon autour du thème : Confluences- Interdisciplinarité et nouveaux défis dans l’histoire de la cartographie visait également à renforcer les liens établis depuis les dernières années entre la communauté académique et les différences instances culturelles et administratives de la ville autour de l’approche cartographique, le tout avec une ouverture internationale. Ainsi, pendant la période allant d’avril à septembre 2024, 5 expositions ont été organisées (voir liste ci-dessous) et toute une série de conférences, visites guidées, master class et ateliers ont eu lieu pour discuter et rendre accessible à un public très large l’histoire de la cartographie, français et anglophone (traduction des cartels des expositions). Les partenaires pour les expositions ont été la Bibliothèque municipale de Lyon, les Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon, les Archives Municipales de Lyon, la Bibliothèque Diderot de Lyon à l’ENS, la Bibliothèque de la Manufacture de l’Université Jean Moulin Lyon 3
La réalisation d’un site web dédié ( [https:]] ) a été prise en charge par les services de l’université de Lyon 3, engagés également dans les services de logistique, sécurité, audiovisuel et accueil en général de l’événementiel. La Bibliothèque nationale de France a aussi été associée, de même que nombreuses autres institutions françaises : l’Université Lumière Lyon 2, le Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes LARHRA, le Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris LAMOP, le Comité Français de Cartographie/CFC, CY Cergy Paris Université. La conférence a pu compter sur le mécénat de l’Afigéo – Association française pour l’information géographique, de Business Geografic, CS Carto – Cyrille Suss Cartographe, de l’IGN et de Latitude Cartagène.
ProgrammeSix jours, du lundi 01/07/2024 au vendredi 05/07/2024 :
- 4 Séances plénières, 24 sessions de communications et une séance de posters
- Des vernissages autour d’un programme d’expositions originales le soir.
- 4 ateliers/workshops organisés en parallèle
- Une Map Fair
- Un espace d’exposition partenaires
Quelques thèmes déjà présents dans les conférences antérieures ont particulièrement été proposés :
- Évolution de la cartographie des villes et de leur planification.
- Nouvelles perspectives de la transition numérique.
- Imagerie du monde : cartes et autres images (livres d’art, manuscrits, guides, imprimés…).
- Cartes et environnement.
- Et tous autres aspects de l’histoire de la cartographie ont été abordés, selon les propositions faites par les participants.
Deux cérémonies ont ouvert et clôturé la conférence, dans des lieux prestigieux : le Grand Amphithéâtre de l’Université de Lyon 2 et au Musée des Confluences. Le reste de la semaine a eu lieu dans les locaux de l’IUT Lyon 3 et à l’UdL.
Une grande diversité de participants : Nous nous sommes attachés à donner la voix à différentes sensibilités et regards, respectant avec autant que possible la parité Homme-Femme, une plus grande représentativité des différents pays et régions (32 pour l’édition lyonnaise à partir de 35 pays d’origine des propositions) avec la conviction que nous ne pouvons qu’apprendre de la diversité.
Plus de 300 personnes se sont inscrites pour les différentes journées, dont 115 pour la présentation de communication orales et 20 pour la session de posters. Le recrutement de 8 étudiants.e.s-vacataires a permis de compléter une équipe de 10 personnes ressources. Le retour à un événement présentiel insistait sur l’occasion de renforcer nos liens d’amitié et d’imaginer de nouvelles formes de coopération pour la suite.
Expositions- Représenter le lointain : un regard Européen / Representing the far away: an European perspective (Bibliothèque Municipale de Lyon) – 2 avril – 13 juillet 2024
Représenter le lointain : un regard européen (1450-1950)
Qu’est-ce que le lointain ? Un autre monde, une contrée, un bout de terre ou de mer, un morceau d’univers qu’il est difficile – parfois impossible – d’atteindre et d’appréhender. Sa perception évolue dans le temps, en fonction des modes de vie, des projets politiques, des moyens techniques de celles et ceux qui le saisissent. Nous adopterons un point de vue : le lointain vu d’Europe et par les Européens entre 1450 et 1950 en s’interrogeant sur la dimension critique de ces représentations.
Evènements associés :
- Cartes marines et oeuvres d’art. Les atlas portulans de la Bibliothèque municipale de Lyon (XIVe-XVIIe siècle) – Emmanuelle Vagnon-Chureau, le 21/05/2024 ( [https:]] )
- Les écrivains américains et la cartographie – Julien Nègre, le 11/06/2024 ( [https:]] )
- L’exploration du monde : une autre histoire des Grandes Découvertes – Guillaume Calafat, le 6/06/2024 ( [https:]] )
- Mondes inférieurs et terres célestes : les géographies verticales de la modernité – Jean-Marc Besse, le 13/06/2024 ( [https:]] )
- Éditathon Wikipédia “Représenter le lointain” – le 13 juin 2024
- Le détail et l’ensemble. Cartes et images du territoire rhodanien et lyonnais / The detail and the whole. Maps and images of the Rhône and Lyon area (Archives départementales et Métropolitaines) – 4 avril – 12 juillet 2024
Les Archives départementales et métropolitaines proposent de suivre au fil du temps, la façon dont la représentation de l’espace de ces territoires a évolué. Les cartes doivent répondre à des fonctions différentes, de plus en plus variées et complexes. Certaines demandes s’observent cependant à toutes les périodes, comme lorsqu’il s’agit de valoriser des terres ou de fortifier des places. Lyon occupe naturellement une place à part : les villes ont très tôt fait l’objet de l’attention du politique et du militaire, et les enjeux de cartographie y sont particulièrement importants.
Evènements associés :
- Cartographier Lyon : quelle histoire en comparaison des autres villes ? Bernard Gauthiez et Agnès de Zolt, le 18/04/2024
- La grande histoire des cartes (Les rendez-vous avec l’INA) Film d’Eric Wastiaux, le 15 mai 2024
- La Guillotière depuis 200 ans : du cadastre napoléonien à nos jours – Pierre Chico-Sarro et Guy Milou, le 30 mai 2024
- Documentaires sur la cartographie (Les rendez-vous avec l’INA) : Projection de 3 documentaires : – La carte de France : son histoire (film de Gérard Dolet – 23′ – 1979) – Jeux de cartes (film de Dominique Planche – 25’ – 1990) – Pierre Novat, panoramiste alpin (Alpes Sud – 8’ – 1992), le 5 juin 2024
- Vulnérabilité … qu’en disent les cartes ? / Vulnerability … what do maps say? (Archives Municipales de Lyon) – 3 mai – 28 septembre 2024
La ville de Lyon est vulnérable à des événements variés, soudains ou au cheminement long et indécelable, jusqu’au moment où ils s’imposent et menacent. La plupart d’entre eux n’ont laissé que des mots, bien insuffisants à nous permettre de comprendre ce qui s’est passé, ni comment les hommes composaient avec. Cette histoire est parfois représentée sur des cartes ou par des images qui nous permettent d’en saisir l’ampleur et les particularités. La carte, de ce point de vue, est venue tardivement, accompagnant une vision de plus en plus nourrie scientifiquement. Cette exposition interroge la ville sous l’angle de ses vulnérabilités, au travers de documents rarement vus et encore moins montrés, alors que la ville d’aujourd’hui regorge de dispositifs instaurant la plus grande sécurité.
Evénements associés :
- Risques et territoire : le pari du paysage – CAUE 69, le 16 mai 2024
- Risques et mémoire : un tandem subtil ! – Antoine Le Blanc en partenariat avec la Géothèque, le 30 mai 2024
- À vos cartes – Mapathon/Atelier de cartographe sensible/Découverte des jeux cartographiques – le 1er juin 2024
- Projection & rencontre : Brise-lames de Jérémy Perrin et Hélène Robert et en avant-première Ingérentes et incurables, de Marie Cornen – Cinéma Comoedia et à partir de 14h, aux archives municipales, le 8 juin 2024
- La fabrique des cartes – atelier gratuit ouvert à tous, le 13 juin 2024
- Les défenses de Lyon – Pierre-Jean Souriac, le 13 juin 2024
- La carte de l’insurrection des canuts en 1834 et ses suites – Bernard Gauthiez, le 20 juin 2024
- Déjouer les risques (matinée jeux en famille) – le 12 juillet 2024
- Fabriquer une carte de A à Z – IGN, le 5 septembre 2024
- Cartes et archéologie à Lyon – Conférence de Mélanie Foucault et Hervé Tronchère, le 12 septembre 2024
- Chemins de papier – Cartes et images du voyage en France et ailleurs, XIXe-XXIe siècle / Paper paths – Maps and images of travel in France and elsewhere, 19th-21st century (Bibliothèque Diderot de Lyon)15 mai – 22 septembre 2024
Les mobilités, phénomènes complexes, mêlent – entre autres – des dimensions technique, politique et culturelle. Pour les périodes récentes, elles s’accompagnent de la diffusion d’une grande variété de documents imprimés aux fonctions diverses, qu’il s’agisse d’aider le voyageur (guide ou carte touristique), de le faire rêver (fiction, iconographie), ou encore de reproduire le voyage (récit et itinéraire d’exploration). Entre le XIXe et le XXIe siècle, les mobilités individuelles se complexifient et s’intensifient en Europe. En lien avec celles-ci, les cartes et les guides, instruments indissociables du voyage et de sa représentation, connaissent de nombreuses transformations. Cette exposition retrace ces évolutions, depuis le guide imprimé jusqu’à l’écran tactile numérique.
Evènements associés :
- Parlez-nous de… Cartes et voyages – Quentin Morcrette et Damien Petermann, 23 mai 2024
- Enjeux et défis de la cartographie contemporaine à l’usage des voyageurs. Christophe Biez, Quentin Morcrette, Damien Petermann, Cyrille Suss, le 25 septembre 2024
- Teaching maps : sur les traces de la cartographie à l’université de Lyon/ Teaching maps: on the trail of cartography at the University of Lyon / (Bibliothèque universitaire de la Manufacture des Tabacs Lyon 3)
L’approche cartographique a accompagné les mutations de l’enseignement de la géographie depuis le XIXème siècle, toujours présente, sa place s’est peu à peu affirmée au sein de l’université de Lyon. C’est par le biais des productions et collections cartographiques des différents géographes et cartographes qui se sont succédés au sein des différentes universités de Lyon que nous vous proposons de suivre 150 ans d’analyses géographiques, parfois locales, parfois lointaines élaborées sur place. 18 juin – 22 septembre 2024
Evènements associés :
- Les cartes postales anciennes de Lyon (fin XIXe-milieu XXe siècle) – master class – Présentation par Enali De Biaggi, Michaël Douvégheant et Damien Petermann du projet d’indexation et de spatialisation des cartes postales anciennes de Lyon : étude géohistorique et valorisation numérique
- Mapathon : un atelier de cartographie collaborative sur OpenStreetMap – le 25 juin 2024
- Visites guidées de l’exposition – le 18 juillet 2024, le 9 septembre 2024, le 19 septembre 2024, le 20 septembre 2024, le 21 septembre 2024 (Journées du Patrimoine)
- Podcast Commun Campus – Le dessous des cartes ( [https:]] )
-
sur Récolt’Ô est le lauréat des Trophées Innovation aux Aqua Business Days 2024
Publié: 17 December 2024, 9:30am CET par Amandine Boivin
L’application Récolt’Ô de valorisation de l’eau de pluie remporte les Trophées Innovation Aqua Business Days 2024. Avec Récolt’Ô préservez votre territoire.
-
sur IASBIM, ou l’IA au service du BIM
Publié: 17 December 2024, 6:25am CET par Raphaël Delhome
Pièce jointe: [télécharger]
 Oslandia s’est récemment illustré au côté de Bimdata et le LIRIS dans le cadre du projet IASBIM, un projet R&D Booster financé par la région Auvergne Rhône-Alpes.
Oslandia s’est récemment illustré au côté de Bimdata et le LIRIS dans le cadre du projet IASBIM, un projet R&D Booster financé par la région Auvergne Rhône-Alpes.L’occasion nous était donnée d’explorer les relations entre les données BIM et le couple Py3dtiles/Giro3D, ainsi que de découvrir le potentiel de la segmentation sémantique appliquée aux nuages de points en 3D.
Contexte du projetLe projet IASBIM se proposait de mettre en avant les méthodes Scan-to-bim pour les acteurs du bâtiment et de la construction, en comblant le fossé entre les nuages de points 3D (captés notamment par Lidar) et les maquettes BIM (au format IFC). Dans cette optique, il s’agissait d’employer des méthodes d’intelligence artificielle et de reconstruction géométrique. Construire une méthodologie de scan-to-bim automatisée ou semi-automatisée peut ainsi permettre de participer à la transformation numérique du secteur de la construction.
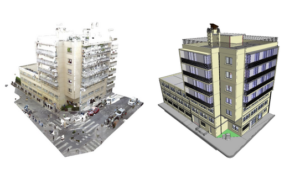
Scan-to-BIM: du nuage de points à la maquette BIM
Vers un nouveau procédé de Scan-to-BIMAinsi, à partir de scans 3D opérés sur le terrain fournis par Bimdata, Oslandia a ainsi eu l’opportunité de mettre en oeuvre un algorithme de segmentation sématnique 3D pour produire des nuages de points annotés. Cette information, une fois transmise au LIRIS, a alimenté les algorithmes de reconstruction géométrique développé par le laboratoire. Enfin, les géométries obtenues ont été récupérées par Bimdata, pour finalement être transformées en maquette BIM. Ces maquettes sont proposées en visualisation dans la plateforme Bimdata, qui a la particularité d’exploiter Giro3D.

Chaîne de traitement de données construite à l’occasion de IASBIM
Réalisations OslandiaLes principaux chantiers pris en charge par Oslandia sont d’une part la visualisation web 3D, se décomposant en une partie backend représentée par Py3dtiles, pour le traitement amont des données 3D et une partie frontend représentée par Giro3D, et d’autre part, l’annotation sémantique de nuage de points, travail réalisé au moyen d’une implémentation de l’algorithme KPConv.
Visualisation web 3DPour la partie backend, nous avons pu établir l’importance de la hiérarchisation de la donnée BIM, avec le format 3DTiles ( [https:]] ), et détailler les éléments nécessaires à sa conversion vers ce format, notamment en respectant la hiérarchie intrinsèque des éléments constituant un jeu de données BIM ( [https:]] ).
Hiérarchie naturelle d’une donnée BIM
Du côté de la partie frontend, on peut noter qu’IASBIM a permis à la Giro3D de supporter l’affichage de maquettes BIM au format .ifc ( [https:]] ).
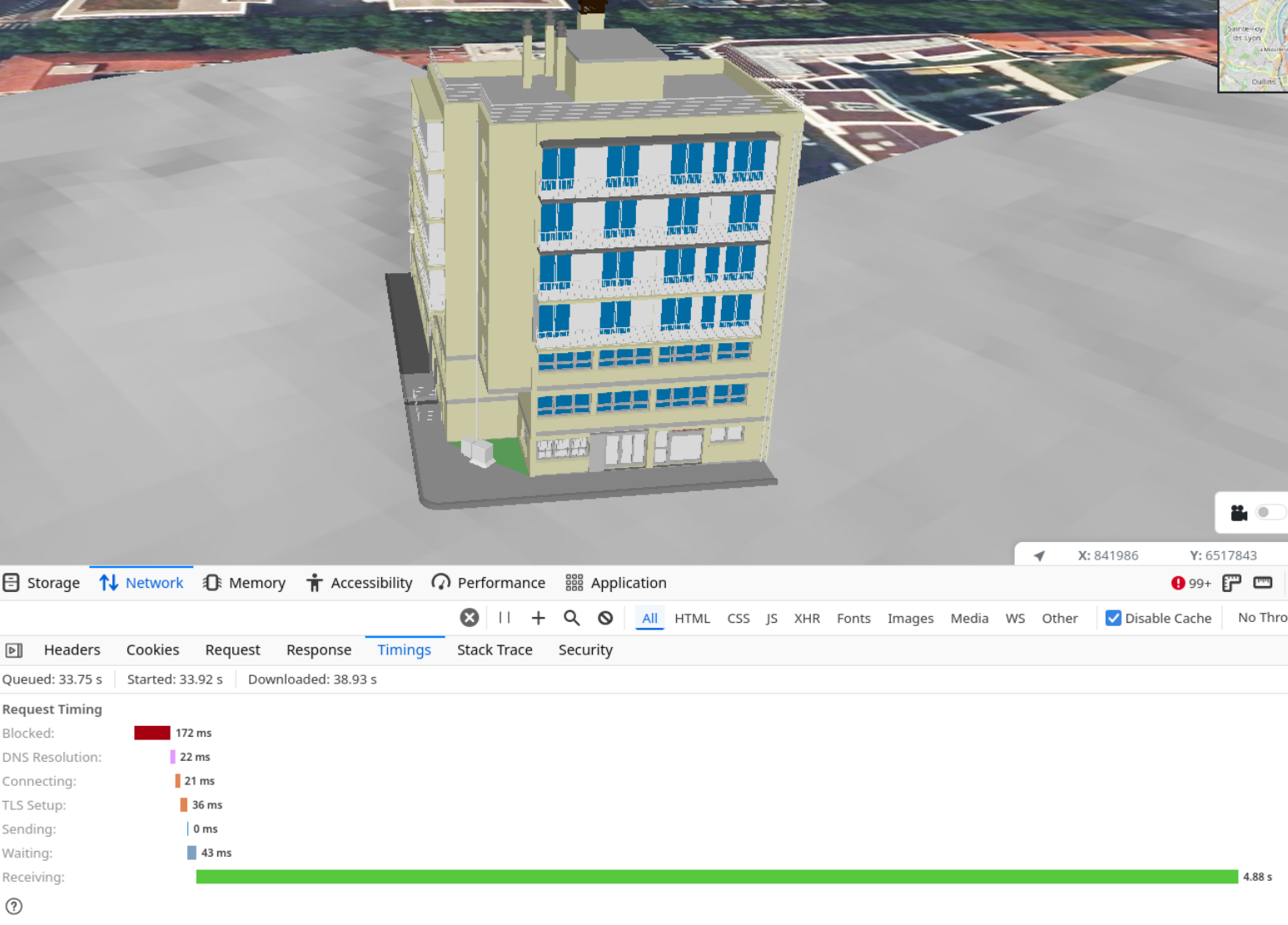
Affichage d’une maquette BIM au format IFC avec Giro3D
En guise de transition avec la partie suivante, dédiée à la segmentation sémantique, on notera également le support de la classification sémantique dans le viewer 3D ( [https:]] ).
Segmentation sémantique 3DEn guise de dernière partie impactante, notons enfin les avancées en matière de segmentation sémantique 3D, qui ont permis à Oslandia de se positionner sur cette technologie via une implémentation de l’algorithme KPConv. Nous avons choisi de travailler à partir de l’implémentation en Pytorch proposée par Hugues Thomas, et lui avons apporté un certain nombre de fonctionnalité pertinentes dans le cadre de IASBIM, via un fork ( [https:]] ). Cela nous a conduit à produire nos premières inférences sur des jeux de données exploités pendant IASBIM ( [https:]] ), ainsi qu’une feuille de route pour les prochaines étapes sur ce sujet !
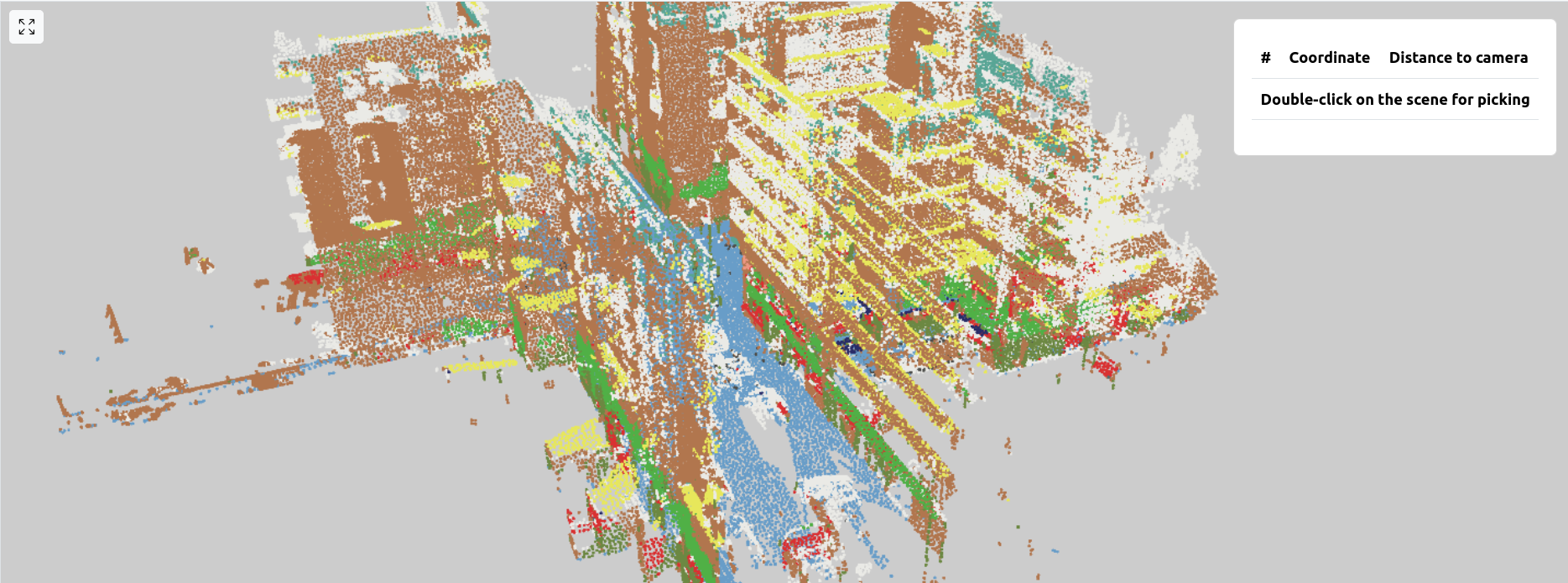
Exemple de prédiction par KPConv en contexte outdoor, on note les murs en marron, le sol en bleu, les avancées de toiture en jaune, notamment
Pour aller plus loinSi vous désirez en savoir plus sur IASBIM, vous pourrez retrouver quelques informations supplémentaires sur le blog dédié au projet ( [https:]] ).
Vous êtes intéressés par les interactions entre modèles 3D et maquettes BIM, ou par la visualisation web de données 3D de manière plus générale ? N’hésitez pas à nous contacter via infos@oslandia.com pour en savoir plus !


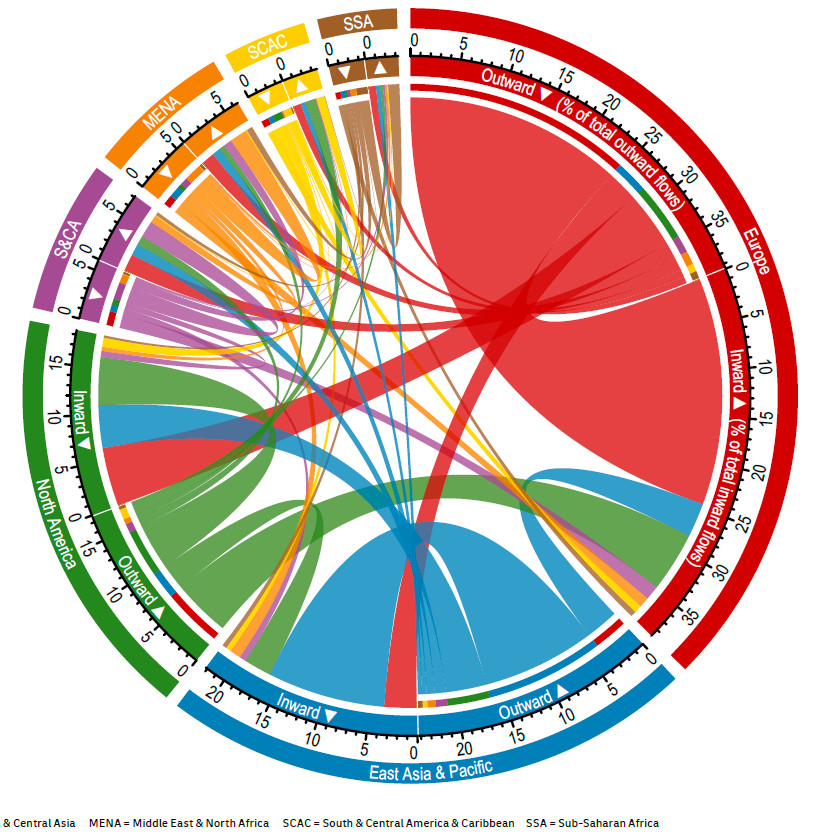
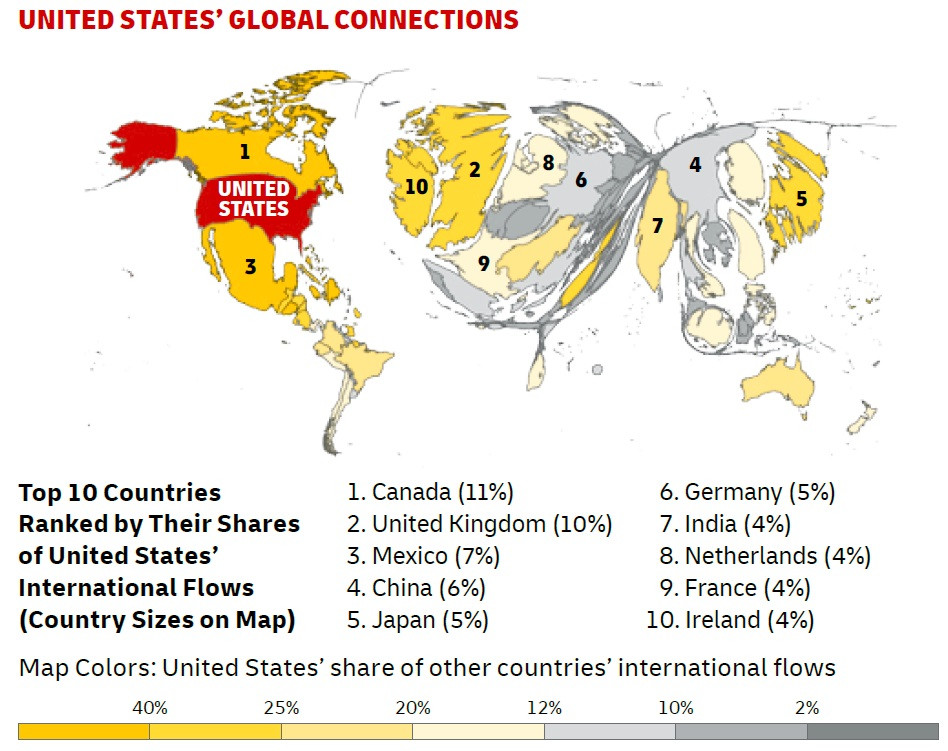
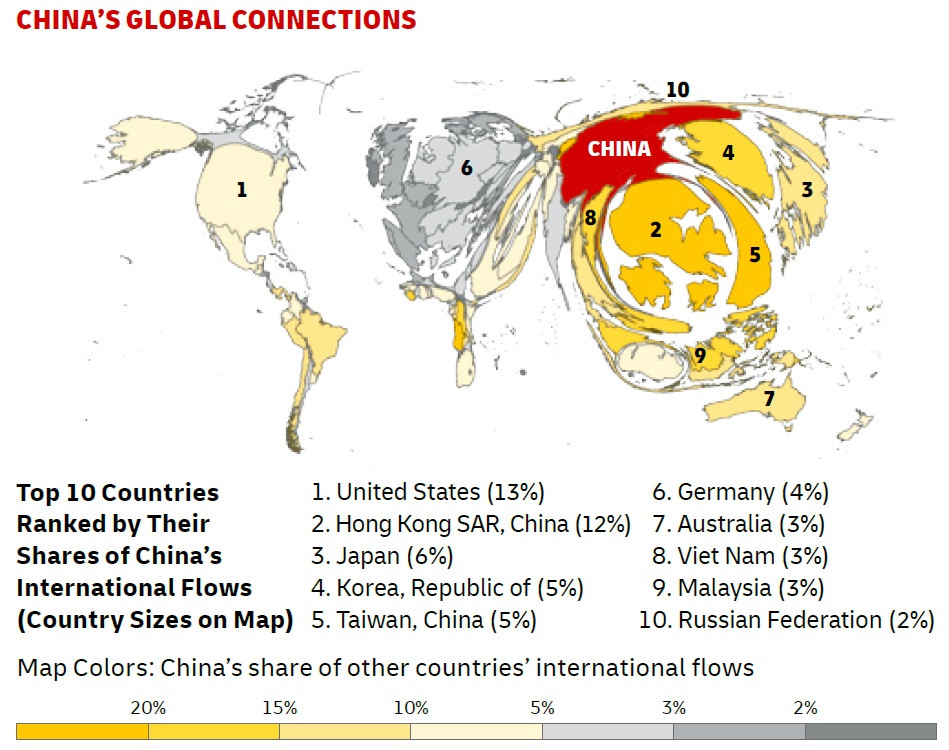
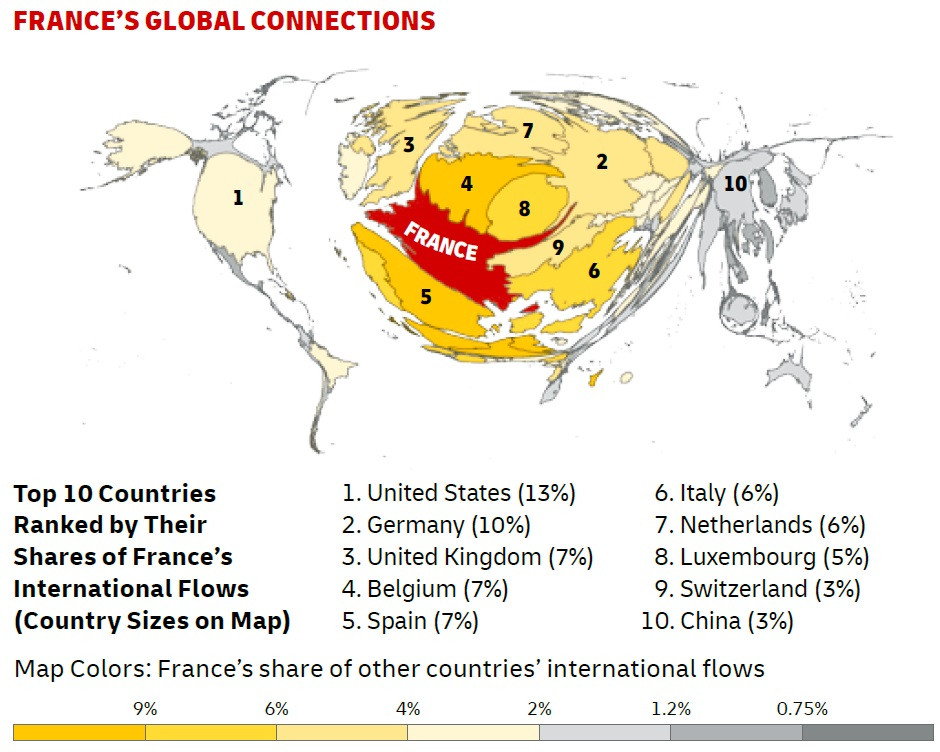
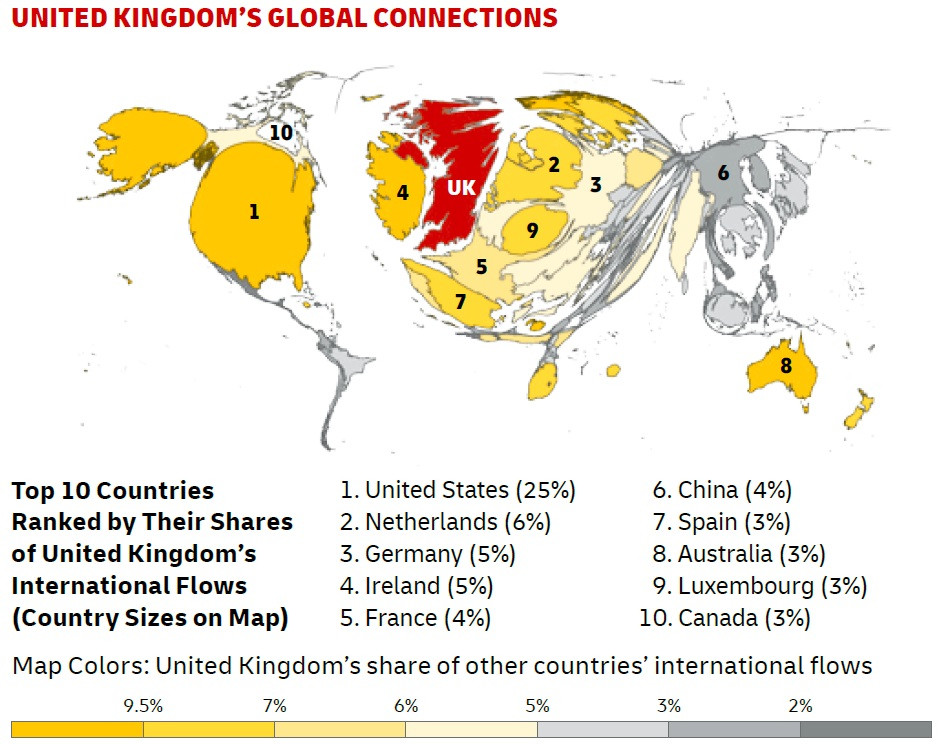
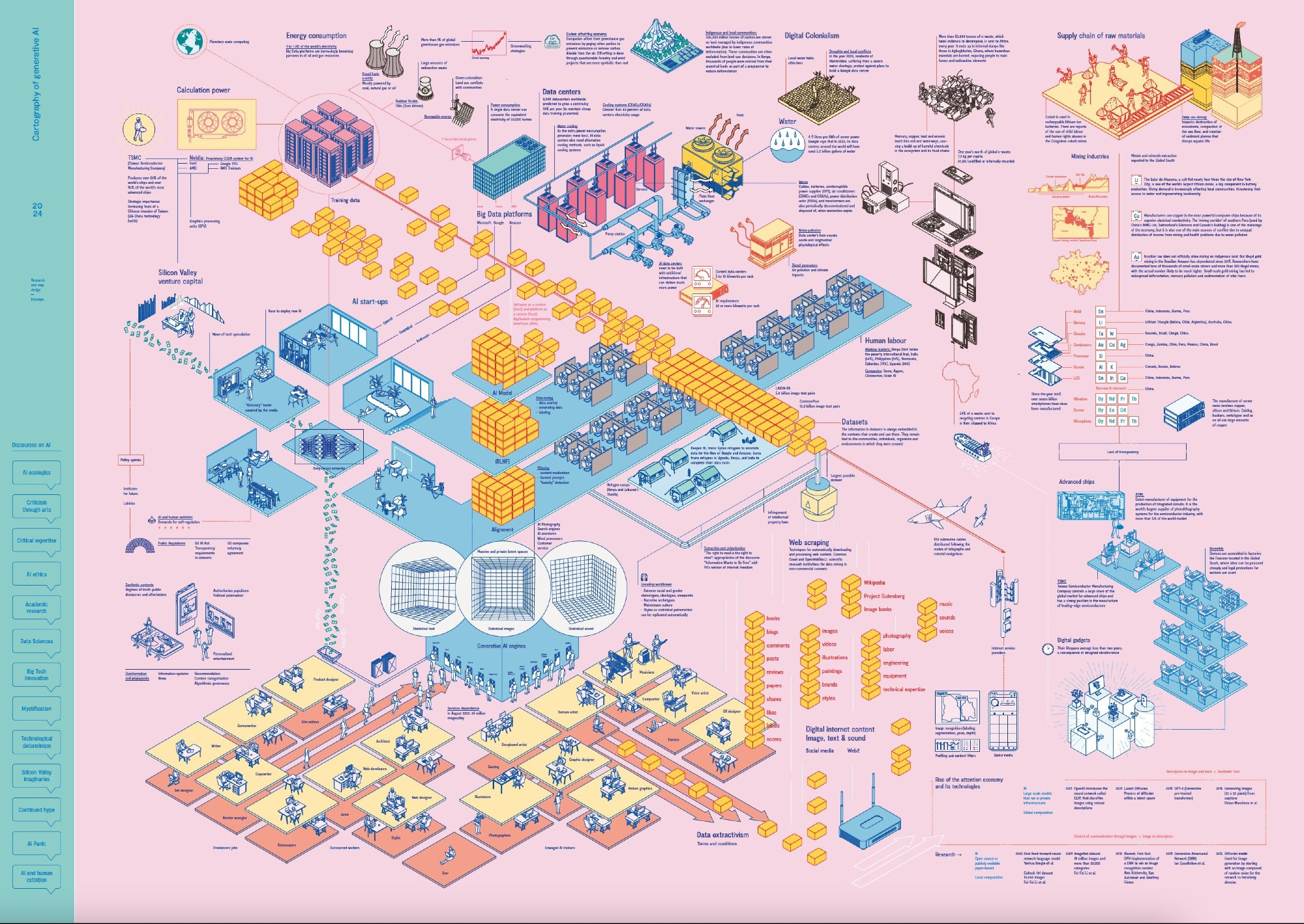
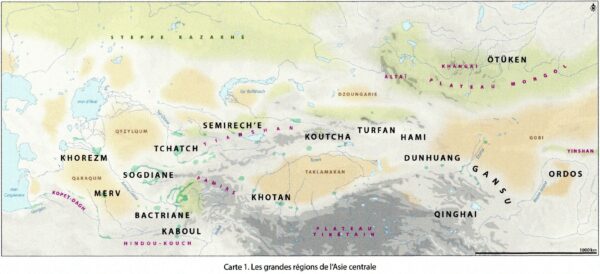
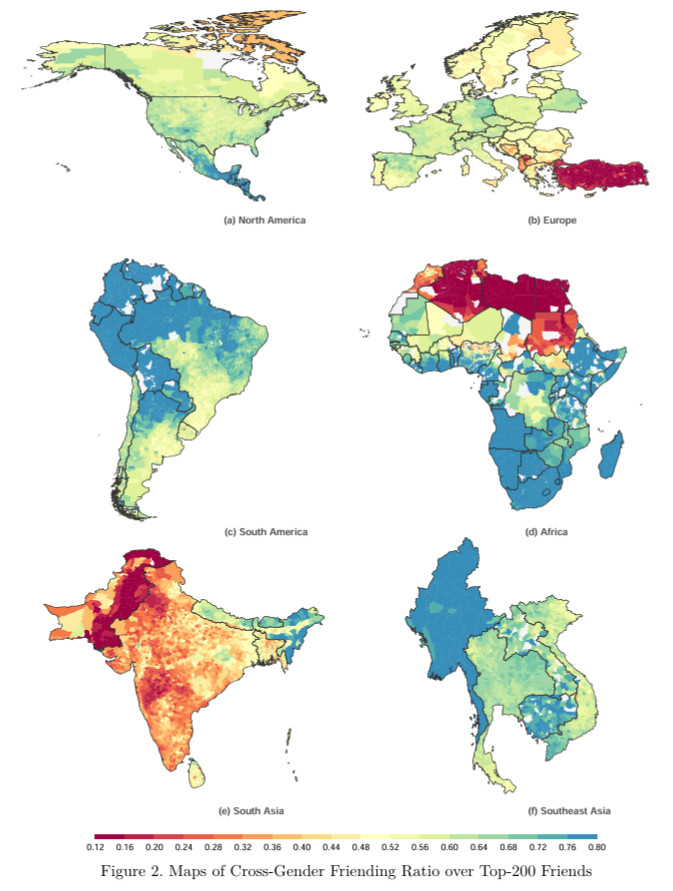
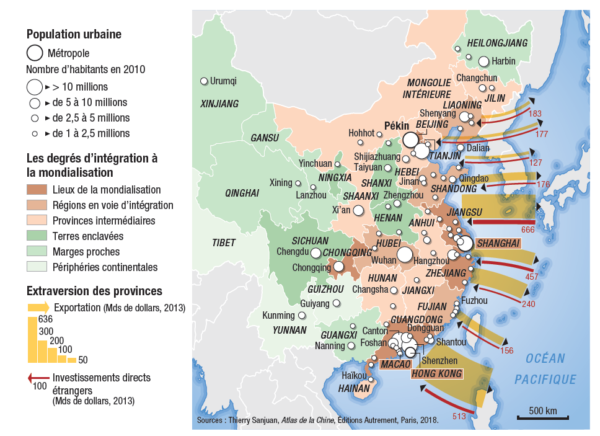
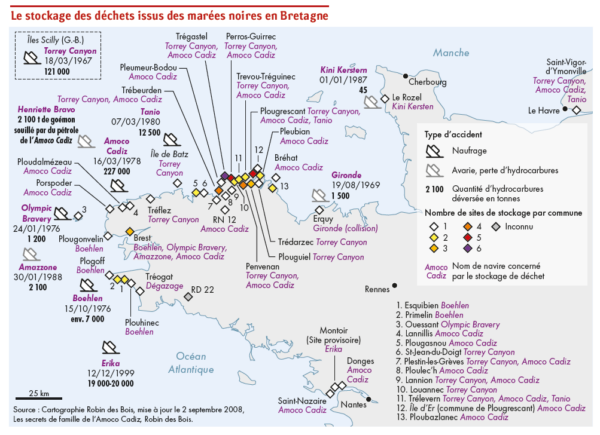
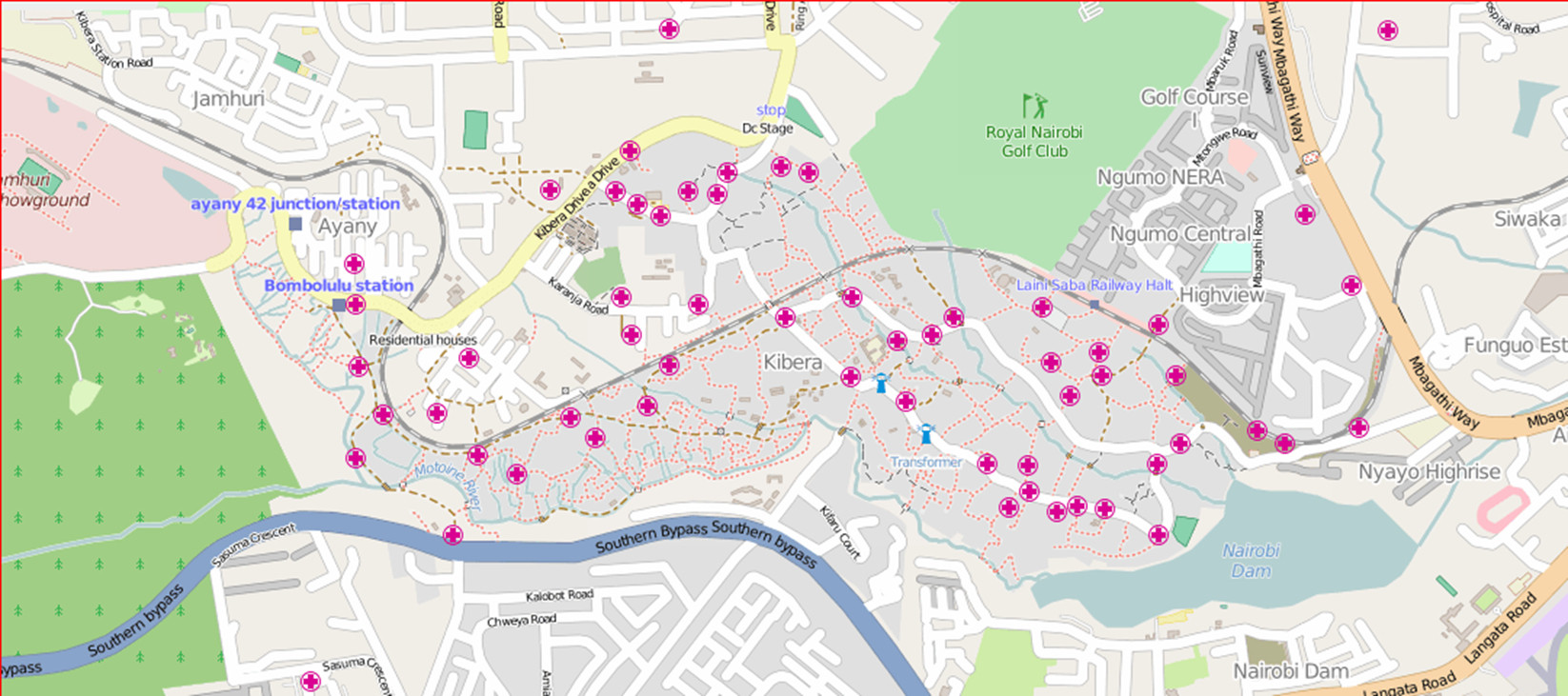
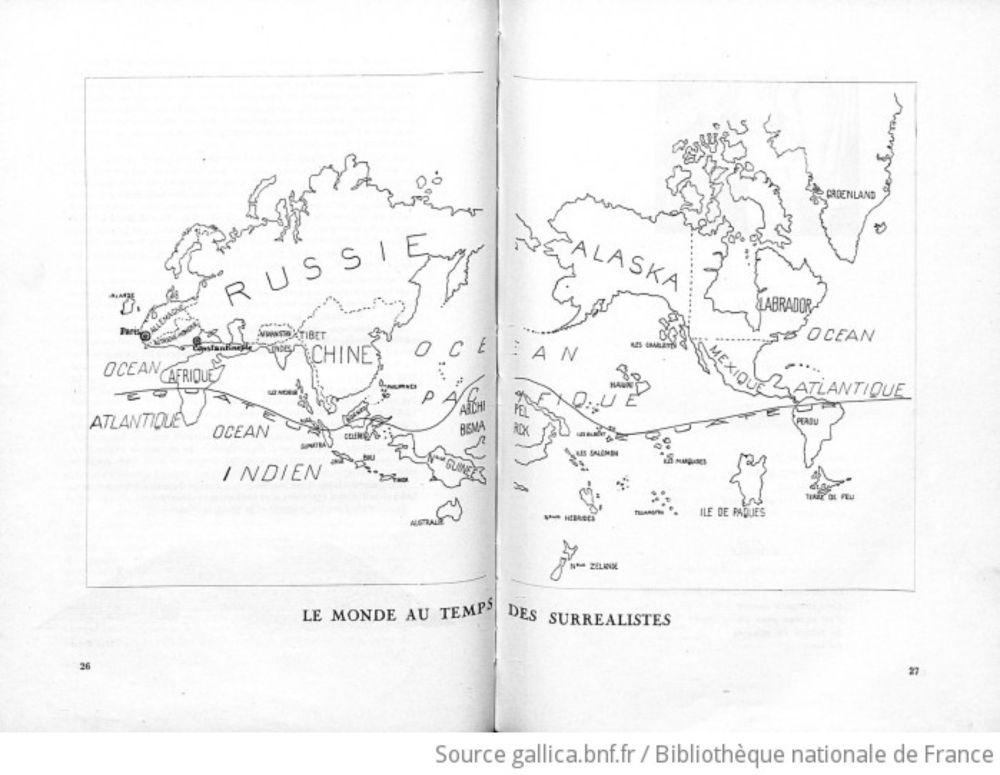

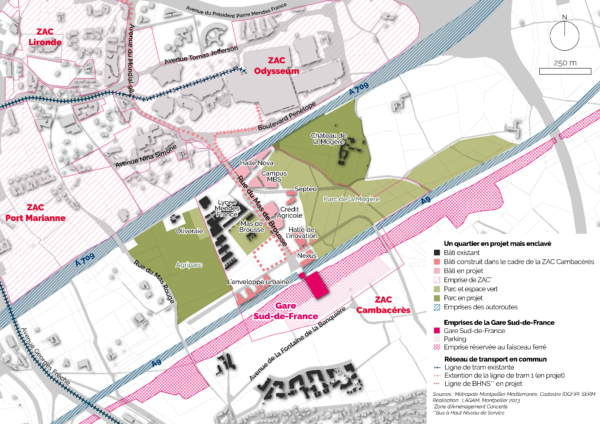
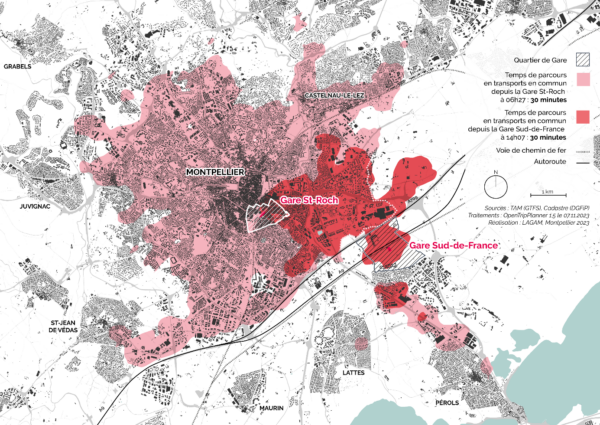
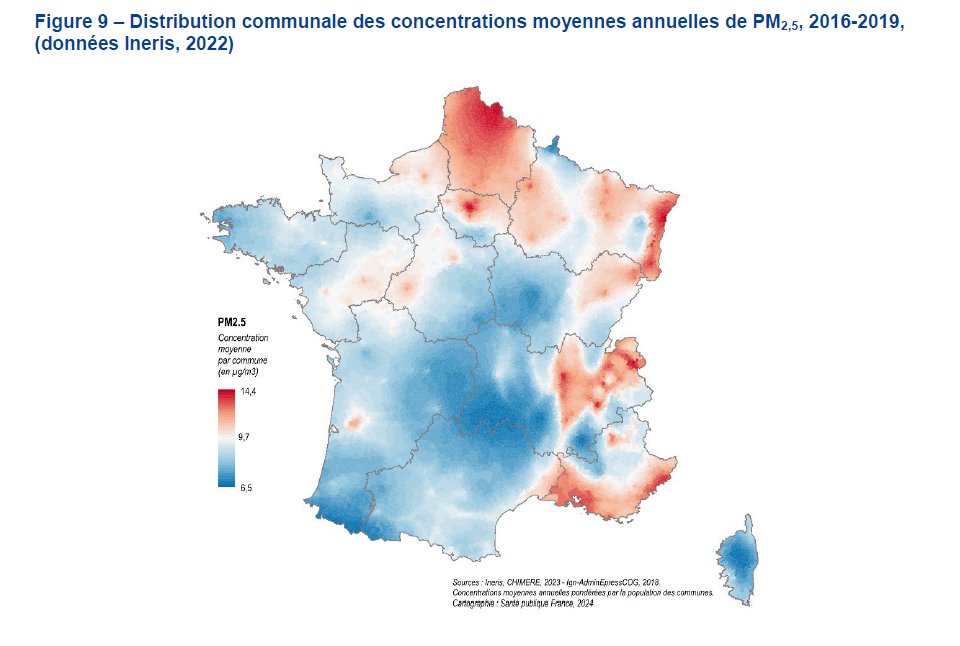
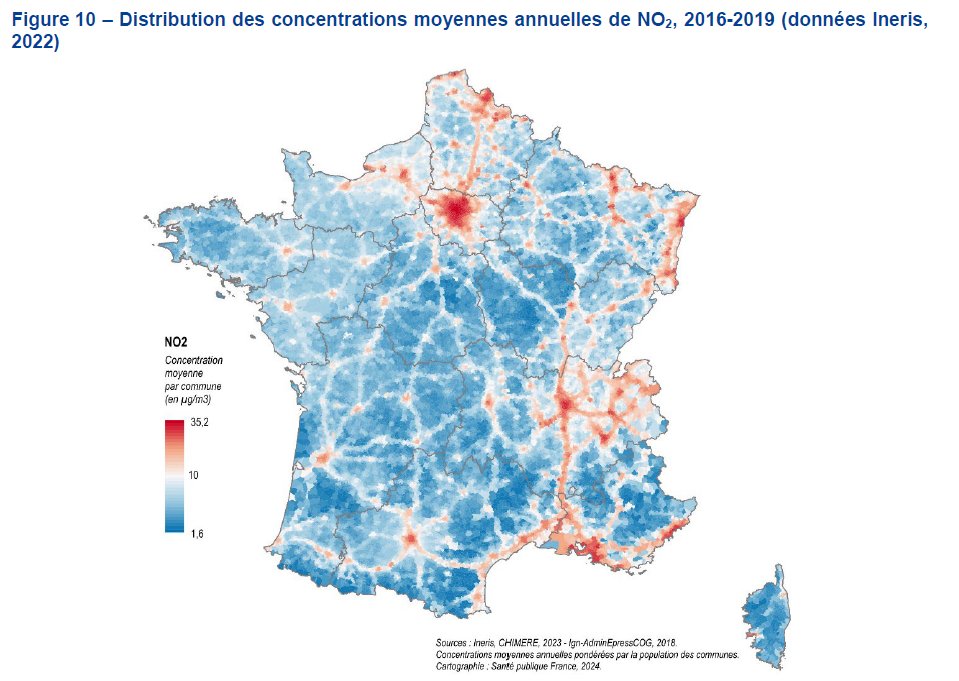

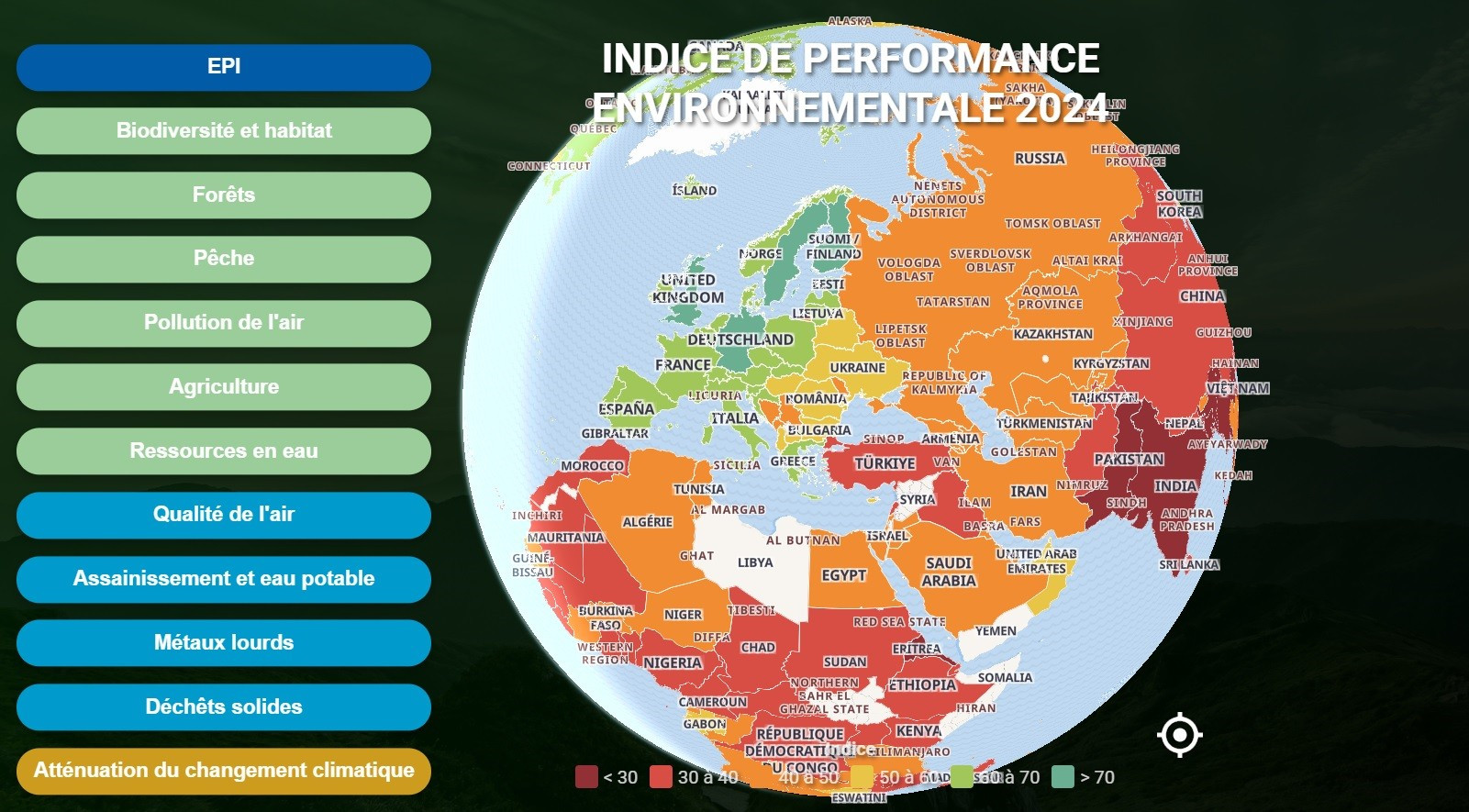
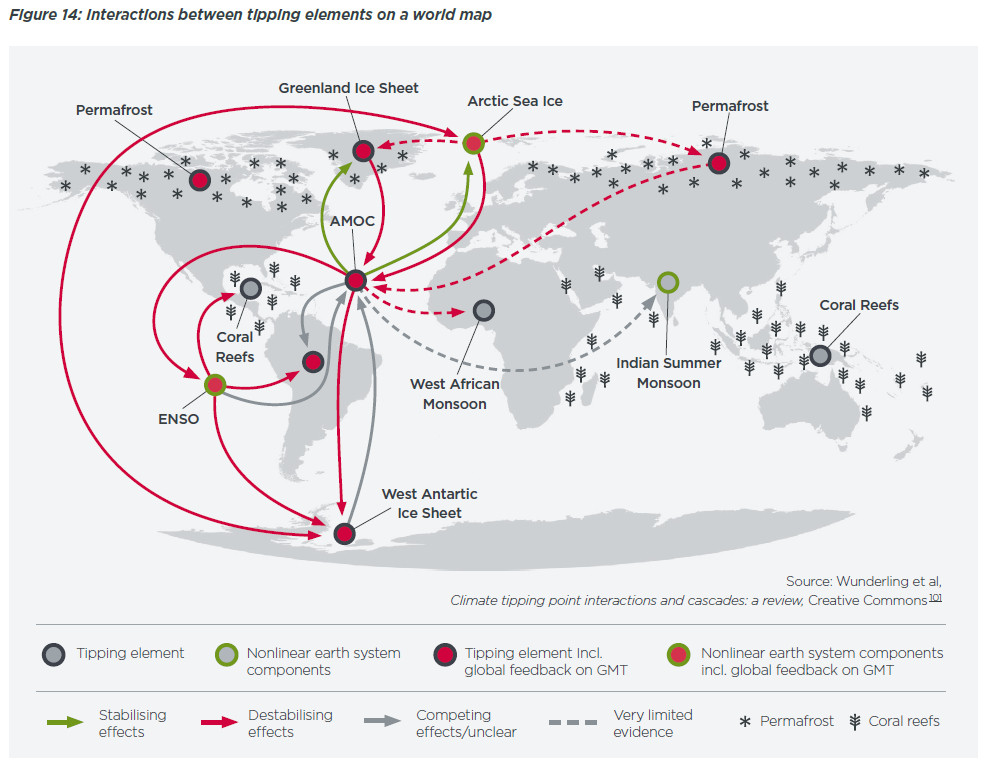
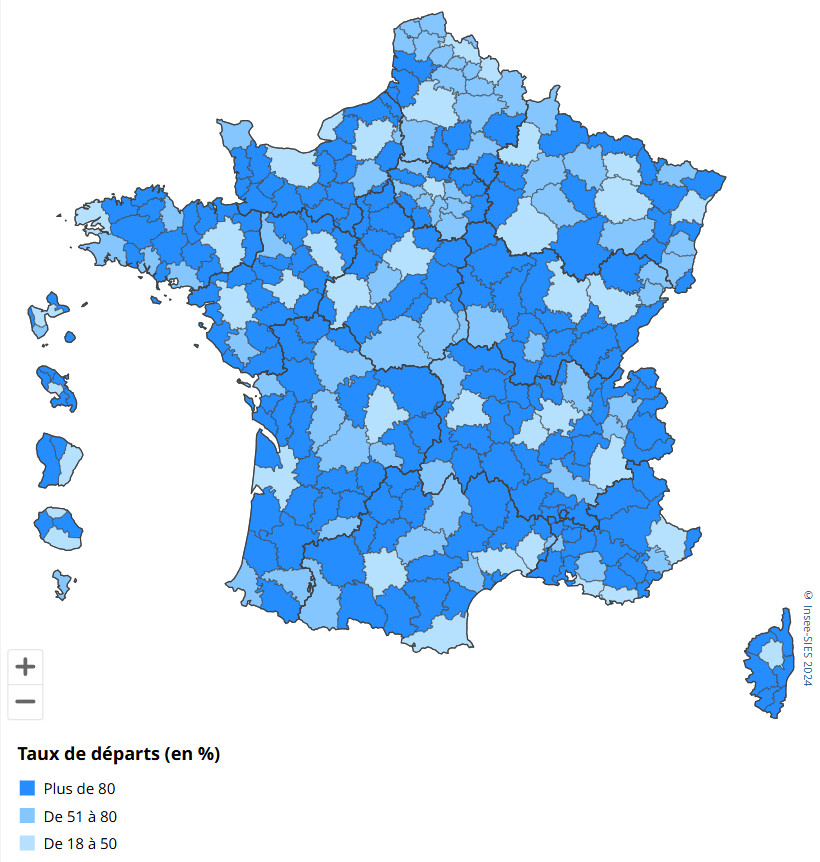

 EN
EN




